|
| |
|
|
 |
|
Microalgues : une stratégie inédite pour capter le carbone |
|
|
| |
|
| |
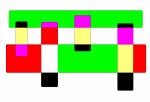
Microalgues : une stratégie inédite pour capter le carbone
Les microalgues, minuscules mais essentielles au bon fonctionnement du climat, viennent de livrer un nouveau secret. Une équipe de scientifiques dirigée par le BIAM (CEA/CNRS/Aix-Marseille Université) a découvert que deux processus clés de la photosynthèse – le mécanisme de concentration du CO2 et la photorespiration – fonctionnent main dans la main, et non en opposition comme on le pensait jusqu’à présent. Une découverte cruciale pour mieux comprendre les flux de carbone en lien avec le changement climatique et qui pourrait bénéficier à la bioéconomie.
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2025
Les microalgues, ces minuscules organismes photosynthétiques, jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat en absorbant près de la moitié du dioxyde de carbone (CO?) atmosphérique entrant annuellement dans les écosystèmes. Par le biais de la photosynthèse, elles fixent le CO? et le transforment en biomasse, en utilisant la lumière comme source d’énergie. Cependant, à l’échelle des temps géologiques, lorsque le CO? s’est fait plus rare, des mécanismes de concentration en CO2 sont apparus chez ces organismes afin de limiter la photorespiration. Pourtant, les mécanismes précis permettant cette adaptation restaient jusqu’ici mal compris.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Mutations et réparation de l'ADN |
|
|
| |
|
| |

Mutations et réparation de l'ADN
La molécule d'ADN subit en permanence des attaques physiques, chimiques ou biologiques. Plusieurs systèmes de réparation veillent sur l'intégrité du patrimoine génétique.
Publié le 25 janvier 2018
LES DIFFÉRENTS TYPES DE MUTATIONS,
LES AGENTS MUTAGÈNES
Les mutations génétiques
Au moment de la division, la cellule déclenche le processus de réplication de l’ADN pour en obtenir une copie. De temps en temps, le système produit quelques erreurs : ce sont les mutations. Le plus souvent, elles sont sans conséquence, puisqu’il y a 98 % de chances qu’elles tombent dans une partie du génome qui ne code pas pour la synthèse d’une protéine (ADN non-codant).
D’autres mutations, en revanche, peuvent modifier la composition ou la quantité d’une protéine et être à l’origine d’une maladie génétique. Parmi les différents types de mutations, certaines sont ponctuelles avec perte, addition, ou substitution d’une seule base. Mais elles peuvent aussi concerner des zones plus larges et occasionner de plus grandes perturbations.
Les agents mutagènes
D’autres sources, environnementales ou liées aux activités de l’Homme, peuvent également modifier l’ADN. Les facteurs mutagènes sont biologiques, physiques ou chimiques. La Nature s’est dotée d’agents particulièrement efficaces, les virus, dont certains peuvent tuer. Les rayons UV, X et la radioactivité sont des agents physiques à la méthode radicale : ils cassent la molécule d’ADN. Quant aux agents mutagènes chimiques, ils sont légions ; par exemple : le benzopyrène, présent dans la fumée de cigarette, le trichloréthylène, utilisé comme solvant dans les pressings...
Stress cellulaire et réponse aux agressions
Autonome, la cellule n'en dépend pas moins de son environnement, des cellules qui l'entourent et du milieu dans lequel elle vit. À chaque minute, elle défend son équilibre et son intégrité. Elle fait face aux situations de stress grâce à des voies de signalisation qui lui permettent d'identifier son agresseur et de vérifier l'intégrité de son système. Selon l'importance des dommages, elle décide alors de se réparer ou de se donner la mort.
Les signaux d'alerte
Par quoi une cellule peut-elle être stressée ? Une infection virale ou bactérienne, des produits toxiques, des rayonnements (UV, ionisants, rayons X…), des mutations génétiques, le manque d'eau ou de nutriments… La cellule contrôle un très grand nombre d'informations qu'elle reçoit de son environnement et de son propre système. Sa survie dépend de sa capacité à s'informer de façon continue. Quand les signaux témoignent d'un problème, par exemple des cassures double-brin dues à des rayonnements ionisants, un système d'alerte se déclenche. Les voies de signalisation sont nombreuses, complexes et encore peu connues.
La réparation de l'ADN
Lorsque la cellule a évalué les dégâts comme modérés, une voie de réparation, spécifique pour chaque type de dommage, est activée. Dans le cas de cassures double-brin par exemple, des protéines se chargent de la réparation. Mais cela peut parfois générer des mutations et mener jusqu'à une instabilité génétique et au développement d'un cancer. Pour étudier ces mécanismes de réparation, il existe un modèle tout à fait intéressant : la bactérie Deinococcus deserti.
Elle tolère des doses très élevées de radiations gamma et UV et de longues périodes de déshydratation extrême. Cette extrême tolérance est liée à la réparation très efficace de dommages massifs de l'ADN, notamment des cassures double-brin qui sont létales chez la plupart des organismes. Un ensemble de processus, à la fois actifs (réparation efficace de l'ADN) et passifs (super-compaction de l'ADN, protection des protéines contre l'oxydation) contribuent à sa radio-tolérance.
La mort programmée
Une cellule se sacrifie pour l'organe et l'organisme. En cas de réparation difficile ou impossible, elle déclenche son apoptose. Cette mort cellulaire, contrairement à la nécrose, est programmée. Elle se déroule suivant un enchaînement de phénomènes complexes : la chromatine se condense et la cellule se fragmente en corps dits apoptotiques qui sont ensuite détruits. Les étapes de déclenchement sont contrôlées par 3 gènes et les différentes phases de la destruction cellulaire seraient contrôlées par une dizaine d'autres. Que se passe-t-il en cas de dysfonctionnement de ce processus ? L'équilibre entre croissance et mort cellulaire est rompu, l'intégrité de l'organisme n'est plus assurée. Dans le cas d'une prolifération des cellules néfastes, l'organisme peut développer un cancer. La stimulation de l'apoptose, quant à elle, peut conduire l'organisme à se retourner contre lui-même. C'est le cas pour le Sida qui affaiblit par pyroptose accrue des lymphocytes TCD4, diminue les défenses immunitaires de l'organisme et prépare un terrain favorable à des maladies opportunistes.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LA QUESTION DE L'EAU ... |
|
|
| |
|
| |

2050 au risque de l’eau
La prospective est un exercice difficile et ceux qui s’y risquent ont toute chance d’être démentis par la suite des temps. C’est pourtant un exercice nécessaire s’il est vrai que gouverner c’est prévoir. Cela peut être enfin l’occasion d’une réflexion sur notre propre avenir et, de fait, la génération née en 1989, aujourd’hui âgée de vingt ans et dont la vie active se déroulera sur les quarante prochaines années, assumera pour le meilleur comme pour le pire l’état de la planète en 2050. C’est à cette génération qu’est proposée dans les pages qui suivent, une réflexion sur les problèmes que posera la gestion de l’eau dans un futur qui n’est pas trop lointain. Sans être exclusive, cette question de l’eau n’en revêt pas moins une importance vitale puisqu’elle conditionne à l’échelle planétaire des problèmes allant de l’alimentation à la géopolitique en passant par l’hygiène et l’urbanisme, le tout conditionné par la maîtrise de l’eau au moyen de diverses techniques. La question est de savoir si ces multiples problèmes pourront être résolus.
QUELS SONT LES ELEMENTS D’UNE PROSPECTIVE ?
Il y a dans toute prospective des éléments fiables, en l’occurrence la dynamique du peuplement et d’autres incertains comme le changement climatique. La marge d’incertitude résultante n’est cependant pas telle qu’il ne soit possible de dégager quelques lignes de force.
La croissance démographique inégalement répartie
La donnée la plus süre est d’ordre démographique. Au début du XIXe siècle, alors que les partisans de Malthus soutenaient que la terre était trop peuplée, l’humanité comptait 1 milliard d’individus, puis 2 milliards en 1930, 4 milliards en 1974, et nous sommes à ce jour 6,7 milliards sur terre. Observons qu’il a fallu 130 ans pour le premier doublement contre 45 ans pour le second, de sorte qu’un simple calcul de probabilité laisserait entendre qu’un troisième doublement portant l’effectif humain à 8 milliards d’individus aurait déjà dû se produire. Si donc, il y a croissance continue, il apparaît du moins que le rythme se ralentit et que les démographes s’accordent pour évaluer la charge humaine en 2050, à quelque 8-10 milliards d’individus plutôt qu’à 12 milliards comme le prévoyaient il y a de cela une vingtaine d’années les démographes.
La cause de ce ralentissement tient non pas aux guerres ou aux famines comme le prédisait Malthus (la démographie historique insiste sur le phénomène dit du « retour du guerrier dans ses foyers » qui tend à combler la perte démographique consécutive aux faits de guerre) mais à une diminution assez répandue de la fécondité dans les pays riches et dans certains pays en voie de transition rapide : dans la Tunisie prise à titre d’exemple, le taux de natalité est passé entre 1987 et 2007, de 29°/°° à 17°/°°. Il est vrai qu’à l’inverse, certains pays maintiennent des taux de natalités élevés avec des taux de mortalité en baisse, aussi bien en Afrique subsaharienne (50°/°° et 18°/°° au Mali), qu’au Moyen-Orient (Afghanistan 48°/°° et 20°/°°) ou en Asie du Sud-est (Philippines 28°/°° et 5°/°°). C’est donc dans ces pays pauvres d’Afrique subsaharienne ou d’Asie méridionale que se fera la croissance de la population mondiale dans les années à venir
On observe également que si la population de nombreux pays souffre de sous-nutrition (moins de 2400 calories par jour), les cas de famine avérée sont exceptionnels alors qu’ils étaient encore nombreux dans les années trente. On peut donc espérer une stabilisation des effectifs de la population mondiale vers le milieu du XXIe siècle sans évoquer le spectre de la famine ou des massacres de type Pol Pot. Ceci dit, si certains pays arrivent à contrôler de façon relative le rythme de leur croissance démographique comme la Chine et dans une moindre mesure l’Inde, d’autres pays verront leur population s’accroître jusqu’à doubler en trente ans, notamment au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne et dans l’Asie du Sud-est.
Les incertitudes du changement climatique
Les données relatives à l’évolution du climat sont, quoiqu’on en dise, beaucoup moins sûres. En admettant que le réchauffement climatique dans les prochaines décennies soit avéré, ses impacts ne sont pas pour autant évidents. Selon certains climatologues patentés, la majeure partie de la France deviendrait dans un avenir pas trop lointain, aussi sèche que l’est actuellement le sud de l’Espagne, cependant que la vigne prospérerait en Grande-Bretagne et que la Suède deviendrait une riche terre à blé. Selon d’autres, la fusion des inlandsis glaciaires modifierait le parcours des eaux chaudes de la dérive nord-atlantique ce qui provoquerait un sérieux refroidissement aux latitudes moyennes, celles de l’Europe précisément. Les seuls phénomènes avérés et susceptibles d’être de longue durée portent sur les risques liés aux émissions de CO2 ainsi que sur un léger relèvement du niveau moyen des mers (Paskoff et al.2003). Mais alors que les pronostics portaient initialement sur un relèvement dépassant le mètre, il ne semble pas qu’une telle valeur puise être atteinte.
Parmi les variables en balance, figure la fonction régulatrice de la biomasse forestière. Il faut savoir que si toutes les forêts régulent l’écoulement des précipitations et favorisent la percolation dans les nappes phréatiques, les grandes forêts des régions chaudes et humides, bassins de l’Amazone, du Congo et des grands fleuves de l’Asie des moussons fonctionnent comme des machines évaporatoires et fournissent une part importante des précipitations dans les zones sahéliennes et tempérées. Or l’exploitation incontrôlée de ces forêts peut compromettre à terme leurs fonctions régulatrices et modifier le régime des pluies aux latitudes tempérées.
Il existe enfin une certitude concernant la gestion des ressources en eau puisque la demande croîtra au moins en fonction de la croissance démographique, cela d’autant plus que les besoins d’une partie importante de la population mondiale sont loin d’être satisfaits.
ABONDANCE ET PENURIE EN 2009
Les situations observées actuellement permettent dans une certaine mesure d’augurer d’un avenir plus ou moins lointain. Bien entendu, des ruptures d’équilibre plus ou moins fortes peuvent toujours survenir et déjouer les pronostics les mieux fondés, mais les tendances lourdes méritent d’être prises en compte. Dès 1972, un groupe de scientifiques rassemblés dans le Club de Rome (Mesarovitch et Pestel 1972) avait attiré l’attention du public sur la raréfaction prévisible de nombreuses ressources naturelles, soit par épuisement des gisements ce qui est le cas du pétrole, soi par usure notamment celle des sols, soit enfin par inadéquation entre l’offre et la demande ce qui est le cas de l’eau. Observons qu’à partir de ces prémisses, les auteurs avaient prévu un collapsus planétaire, synonyme d’épouvantables catastrophes dès 1980. Le cadrage temporel de cette analyse prospective s’est avéré faux mais le questionnement posé reste d’actualité et conditionne certaines prises de position politiques comme le protocole de Tokyo pour la réduction des effets de serre.
L’évaluation de l’adéquation des ressources en eau à la population repose sur deux notions conventionnelles au terme desquelles il y a satisfaction si les ressources globales d’un pays donné dépassent le seuil des 1000 m3 par personne et par an, contrainte si la balance s’établit entre 500 et 1 000 m3, pénurie si les ressources sont inférieures à 500 m3 par personne et par an . Dans la réalité, ce classement suscite quelques critiques : d’une part l’espace de certains pays comme les Etats-Unis, le Mexique, l’Algérie, l’Australie, le Brésil ou le Chili est partagé entre des régions bien arrosées et des régions désertiques, le cas emblématique étant celui du Brésil où l’Amazonie déserte reçoit des pluies abondantes, alors que le Ceara dans le Nord-est du pays, souffre de sécheresses chroniques. Dans cette perspective, la situation des pays du Maghreb, arrosés de façon irrégulière (450 m3/h/a) pour l’Algérie) est plus inquiétante que celle d’un pays riche et peu peuplé comme l’Arabie saoudite (96 m3/h/an) où il ne pleut pratiquement jamais mais où l’argent du pétrole permet d’installer des usines de distillation d’eau de mer. Sur un autre registre, la pénurie apparente de Singapour (145 m3/h/an) doit être nuancée par la proximité de la Malaisie qui dispose de ressources surabondantes. A l’autre extrémité de l’échelle des valeurs, deux grands ensembles septentrionaux correspondant au Canada (91 000 m3/h/an) et à la Russie-Sibérie sont peu peuplés mais disposent d’importantes ressources. Il en va de même dans la zone équatoriale, pour l’Amazonie, le Venezuela et le Congo-Zaïre (218 000 m3/h/an) A l’échelle de l’Europe, on retrouve des situations tout aussi contrastées puisque la Croatie dispose de 23.000 m3 par personne et par an contre 130 m3 à Malte. Il faut enfin faire état de l’inégal accès à l’eau : les Israéliens ne disposent que de 250 m3/h/an mais, sur le même territoire la situation des Palestiniens est bien pire, avec 41 m3/h/an.
Les notions de contrainte et de pénurie doivent être en tout état de cause nuancées en fonction d’un double critère. Celui de la richesse bien entendu, qui permet à certains pays de compenser leurs déficiences soit par l’achat d’eau à l’étranger, soit par le recours à de vastes usines de désalinisation couplées à des centrales nucléaires. En 2008, la plus récente de ces usines a été inaugurée pour la desserte de la ville d’Alger. Celui de l’accès aux technologies de pointe dans les pays disposant de fortes équipes de chercheurs. Le cas le plus intéressant sur ce rapport est celui d’Israël qui a mis au point non seulement des cultivars peu exigeants en eau mais aussi des méthodes d’irrigation valorisant au mieux de faibles ressources, comme l’irrigation au goutte-à-goutte. A cela s’ajoute une politique de recyclage des eaux usées avec utilisation des eaux régénérées pour l’irrigation et la pisciculture.
L’EAU ET LA CRISE TROPHIQUE DE 2009 A 2050
Le défi de la nourriture
Sachant que la population mondiale se sera accrue d’au moins 3 milliards d’habitants en 2050, le principal défi qui se posera à l’échelle de la planète sera d’ordre trophique. Le problème ne se posera pas pour les pays riches et de haute technicité dont la croissance démographique est stabilisée, Europe, Amérique du Nord, Russie, Argentine et Australie. A l’autre extrémité de la chaîne des valeurs, se situent des pays dont la population connaîtra une forte croissance comme le Congo-Zaïre ou la Côte d’Ivoire dont les populations auront triplé en trente ans. Si l’on ajoute à cette donnée de base le fait qu’une bonne partie de leurs populations ne dispose pas actuellement d’apports alimentaires satisfaisants et en postulant que les besoins de ces mêmes populations auront évolué, certains experts comme Philippe Collomb (Collomb, 1999) estiment que pour assurer une ration alimentaire quotidienne de 2 400 calories à chaque habitant de ces pays, il faudrait multiplier par 10 les niveaux de production actuels. Il s’agit nommément de pays situés dans l’Afrique subsaharienne Angola, Burundi, Congo-Zaïre, Ethiopie, Ghana, Libéria, Niger, Nigéria, Malawi, Mozambique, Rwanda et Tchad. Il se pourrait que ce calcul théorique s’avère excessif, mais ces mêmes calculs faits pour d’autres pays comme ceux du Maghreb, pourtant en situation de pénurie, sont trop encourageants pour que l’on puisse les négliger : il suffira de doubler – ce qui est techniquement possible - les productions actuelles de denrées alimentaires pour satisfaire à la demande d’une population qui aura doublé. D’autres pays comme Cuba (1,2) ou la Chine (1,9) atteindront à la satisfaction de la demande intérieure sans trop de difficultés au vu de leurs marges de progrès. Peut-on en dire autant de l’Inde (3,3) où la Révolution verte a déjà atteint ses limites ? Et que dire des Etats du Sahel ou de l’Asie du Sud-est qui sans atteindre aux excès de certains pays africains devraient tout de même quadrupler le niveau actuel de leur production agricole ? Bref, l’échéance de 2050, banale pour l’ensemble des pays riches, ne laisse pas d’inquiéter pour l’ensemble de la planète.
Avantages et limites de l’agriculture irriguée
Comment se pose la question de l’eau dans ce contexte, le problème étant de savoir si le recours à l’irrigation pourra résoudre la question alimentaire ? Dans les pays de climat tempéré, l’agriculture pluviale suffit en théorie à la croissance des plantes et l’irrigation joue sans plus un rôle de régulation. Mais dès que les saisons sèches atteignent une certaine durée et que la hauteur des précipitations est insuffisante, l’agriculture pluviale n’autorise que de maigres récoltes, blé dur méditerranéen, sorgho ou mil africain. Seule, l’irrigation permet alors d’étoffer la gamme des plantes cultivées, d’en assurer le cycle végétatif et d’accroître les rendements. Dans le centre des Etats-Unis, le rendement du maïs passe de 5 t/ha en agriculture pluviale à 11 t/ha en système irrigué et les écarts de rendement sont encore plus forts pour le blé dur ou le sorgho. Dans l’Afrique sahélienne, l’irrigation permet de substituer aux faibles rendements du mil (0,8t/ha), la culture du blé ou du maïs, plus nourrissants et aux rendements plus élevés.
Ces données expliquent le succès de l’irrigation et le passage de 50 millions d’hectares irrigués en 1950 à 280 millions d’hectares en 2005 (dont 160 millions d’hectares pour l’Asie) pour un total de 1,6 milliards d’hectares de terre cultivés à cette date. Un tel rythme de croissance ne pourra pas se maintenir longtemps et aucun expert (M. Griffon, 2006) ne s’engage sur la probabilité de voir un jour les 600 millions d’hectares irrigables à l’échelle mondiale, équipés et exploités, soit pour des raisons de financement et de techniques et, soit pour des raisons politiques. Mais il est certains que les surfaces irriguées continueront à croître dans les années à venir, et avec elles les équipements lourds notamment la construction de puissants barrages de retenue.
Du moins existe-t-il d’incontestables marges de croissance en Asie des moussons, Afrique équatoriale, Amériques et Russie, alors que ces marges sont pratiquement nulles pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (World Water Council 2006). En fait ces données restent aléatoires en fonction de trois considérants. Se pose au premier chef, la difficile évaluation des ressources contenues dans les nappes aquifères dont certaines sont fossiles (Libye) et d’autres en voie d’épuisement (Texas). Se pose également le problème de la destruction des sols irrigués soit par manque de drainage, soit par salinisation de sols trop arrosés et sujets à une forte évaporation. Ce phénomène affecte aussi bien des pays de vieille tradition hydraulique comme l’Egypte, que des pays neufs comme l’Australie. Se pose enfin le problème des méthodes d’arrosage. Le plus répandu, l’arrosage gravitaire a une faible efficience puisque les cultures valorisent au mieux 10% de l’eau apportée. L’arrosage par aspersion permette de porter ce taux à 30% et il peut même atteindre 60% avec les techniques de goutte-à-goutte. Des appareils d’arrosage sophistiqués, permettant d’économiser l’eau pourraient aider à résoudre bien des problèmes dans les pays affectés par des pénuries. Malheureusement, ces appareils sont d’un coût élevé et leur maintenance exige des moyens qui ne sont pas accessibles aux pays pauvres. L’hypothèse d’une meilleure utilisation de l’eau dans les pays pauvres ne peut donc être retenue.
Des alternatives contestées
Il existe des marges peu peuplées et disposant d’importantes disponibilités en eau et en sols de bonne qualité. C’est notamment le cas du Canada qui dispose de 5 000 km3 et de la Sibérie ave 3 000 km3. Mieux, un éventuel changement climatique réchauffant les zones tempérées froides, ferait de ces régions des terroirs plus fertiles que la Beauce française ou le Middle-west américain. Mais ces grands ensembles actuellement vides ne pourraient accueillir d’éventuels migrants, qu’au prix de grands investissements en infrastructures de communication et d’urbanisme. Il n’est au demeurant nullement avéré que les gouvernements et les populations des Etats correspondants soient prêts à accueillir des foules de migrants pauvres pour mettre ces terres neuves en exploitation.
Une autre alternative souvent évoquée, consisterait à détourner une partie des disponibilités en eau des pays d’abondance vers des pays déficitaires (Lasserre, 2005). C’est déjà ce qui se passe en Espagne où un Plan National Hydraulique prévoit – ou plus exactement prévoyait car ce plan est contesté – le transfert d’une partie des eaux du versant atlantique bien arrosé vers le versant méditerranéen qui manque d’eau pour ses cultures de fruits et légumes vendus dans toute l’Europe. Un projet d’apport complémentaire porte sur le transfert des eaux du Rhône vers la Catalogne. De leur côté les Italiens peaufinent l’idée d’un transfert par canalisation sous-marine, de l’Albanie vers l’Italie méridionale. Hors d’Europe, il existe bien d’autres projets du même ordre : du Vaal vers la région de Johannesburg en Afrique du Sud ; en Chine, du haut Irtych et de l’Ili vers le bassin du Tarim ce qui poserait de sérieux problèmes au Kazakhstan qui, au-delà de la frontière utilise massivement les eaux de ces cours d’eau ; de l’Irtych vers la mer d’Aral ; de la baie d’Hudson vers les Grands lacs américains.
En fait ces projets qui défrayeront la chronique dans les années à venir suscitent de multiples réserves les unes d’ordre social ou politique, les autres d’ordre environnemental. De façon générale, les habitants et usagers des bassins hydrographiques où s’opèrent les prélèvements, manifestent une forte opposition. Les riverains du Rio Lerma dont les eaux sont dérivées vers Mexico, ont rompu à plusieurs reprises, la canalisation principale qui doit être gardée en permanence par l’armée. En Espagne, les Aragonais opposés au transfert vers le Sud-est se sont identifiés aux eaux de l’Ebre qui sont « le sang de la terre et notre propre sang » et la « lucha por l’agua » s’est faite si violente, que le projet initial a été fortement revu à la baisse. Le projet de transfert des eaux des fleuves Nelson et Churchill depuis la baie d’Hudson vers les Grands Lacs et de là vers l’Ouest et le Sud des Etats-Unis pose un double problème : problème d’ordre technique et financier tout d’abord, car il faudrait construire toute une chaînes d’usines de pompage ; problème d’ordre politique également puisque les volumes prélevés passeraient du Canada et plus précisément du Québec vers les Etats-Unis. Les Québécois invoquent leur droit de contrôle sur leurs eaux, alors que les Etats-Unis soutiennent que dans le cadre de l’ALENA (le traité de libre échange de l’Amérique du Nord), les eaux du continent sont un bien commun offert à tous. Finalement, d’anciens transferts comme le transfert des eaux du Sacramento vers la Californie du Sud et Los Angeles, sont maintenant remis en cause par les groupements d’écologistes.
Sur le plan environnemental, le projet le plus ancien et le plus discuté reste celui du transfert des eaux, soit 27 km3 par an, de l’Ob-Irtych vers la mer d’Aral et même vers la Caspienne. Le projet est déjà ancien, puisqu’il remonte dans sa première version (Plan Davidov) à l’époque stalinienne avant d’être relancé en 2002 dans le cadre de discussions préalables entre le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan et la Russie. Sur le plan environnemental, l’Aral retrouverait ses dimensions passées, mais la diminution des débits apportés à l’Océan arctique accroîtrait les risques de pollution dans une région fragile, augmenterait la salinité des eaux par apport compensatoire en provenance de l’Atlantique et pourrait finalement perturber le climat de la Sibérie et la dynamique de l’inlandsis. Sur le plan politique, l’apport d’eau dans des régions semi-arides relancerait les projets de mise en valeur par le coton ou même par des céréales, mais les pays bénéficiaires de ces apports se trouveraient sous la dépendance de la Russie, unique fournisseur d’eau. Autant dire que l’Empire russe serait reconstitué.
Au bonheur des riches
Qu’il s’agisse d’agriculture pluviale ou d’irrigation, le fait est que les plantes exigent de l’eau. Consommer du blé (ou de la luzerne transformée en bœuf) revient à consommer ou à transporter de l’eau sous forme de céréales ou de viande : il faut (FAO 1999) 1 100 litres d’eau pour produire un kilo de blé, 5 000 litres pour produire un kilo de riz ou encore 13 500 litres pour produire un kilo de viande de bœuf (mais seulement 4 600 litres pour produire un kilo de porc). Certains pays exportent donc de l’eau alors que d’autres en importent sous forme de denrées alimentaires. Encore faut-il payer ces importations et la hausse du cours des céréales à l’automne 2007, suite à de mauvaises récoltes en Amérique du Sud et en Australie a sensiblement modifié les courants de marchandises au détriment de pays pauvres incapables de suivre la hausse des cours. Il se pourrait, les aléas climatiques aidant, que ces déséquilibres dans les courants d’exportation tendent à s’aggraver.
Face à l’instabilité avérée ou menaçante des marchés, la meilleure des parades pour les pays qui manquent de terre ou d’eau, consiste à acquérir des territoires productifs dans des pays étrangers. De fait, depuis quelques années les achats de terre à l’échelle internationale se sont multipliés et tout laisse entendre que le mouvement ira en progressant dans les décennies à venir : la Chine contrôle maintenant plus de 2 millions d’hectares de terres irrigables à Madagascar et en Afrique du Sud-est (Mozambique, Tanzanie, Kenya) ainsi qu’au Mali. Le Japon investit à la fois aux Philippines, en Australie et au Brésil, l’Arabie saoudite et les Emirats s’intéressent à l’Egypte, au Soudan et, dans une moindre mesure à l’Angola.
Le cas de la Libye est caractéristique de ce type de montage. Certes, le pompage des nappes sahariennes a permis d’acheminer des eaux fossiles jusque dans la zone côtière qui concentre l’essentiel de la population. Mais ces eaux trop chargées de sels se prêtent mal à l’agriculture et, de toute façon, l’incertitude demeure sur la capacité des nappes sahariennes dont on ne sait si elles seront épuisées en 30 ans ou en 300 ans. Ce contexte explique une politique contractuelle menée quelque peu en Egypte mais surtout au Mali, où la Libye développe actuellement un projet gigantesque de 200 000 hectares irrigués à partir du Niger dans la région du delta intérieur avec un programme portant sur du riz, de la canne à sucre et de l’élevage bovin (Brondeau 2009). Une société mixte, la Malibya met ce plan en œuvre mais sur le terrain, les Libyens apportent les capitaux, le travail est exécuté par une entreprise chinoise, la Chine Geo-Engineering Corporation qui emploie des techniciens et ouvriers chinois, et les paysans maliens sont priés de s’établir sur d’autres terres qui seront peut être aménagées dans un avenir non déterminé. Certains Maliens frustrés parlent d’un retour du colonialisme. Il existe d’autres projets de création de périmètres irrigués financés par des apports extérieurs qui feraient du Mali le grenier à riz de l’Afrique occidentale. Simple détail, il n’est pas sûr que les débits du Niger, même régularisés par des retenues, puissent satisfaire à la demande.
Dès maintenant mais surtout dans l’avenir, se pose et se posera le problème de la substitution des biocarburants au pétrole. D’importantes étendues de terres actuellement cultivées à des fins agro-alimentaires pourraient donc être transférées vers le secteur énergétique, cela au profit des pays capables de payer ce carburant et au détriment des échanges de denrée alimentaires.
Pauvreté et dépendance
Les achats de terre et d’eau des pays riches se faisant pour partie dans des pays peu peuplés comme l’Australie mais pour l’essentiel dans des pays pauvres comme Madagascar ou le Mali on assiste à travers la question des approvisionnements mondiaux à une distorsion des ressources et des moyens entre pays riches et pauvres. Cette distorsion qui va croissant peut aboutir à des situations de dépendance qui ne sont pas toujours perçues dans leur dimension globale, ainsi qu’en témoigne le cas de l’Egypte.
La population égyptienne est passée de 31 millions d’habitants en 1970, à 78 millions en 2008. Dans le même laps de temps, l’Egypte a consenti des efforts considérables pour accroître sa production agricole avec, pour principal vecteur la construction du grand barrage et de la retenue d’Assouan qui a permis à la fois la conquête de terres nouvelles et le passage d’une récolte annuelle à un système de culture continu donnant jusqu’à trois récoltes par an. Ces efforts n’ont pas suffi et l’Egypte ne produit plus que 40% du blé qu’elle consomme. Or le pain représente jusqu’à 60% du régime alimentaire de la grande masse de la population. Le surplus vient essentiellement des Etats-Unis avec des apports complémentaires du Canada et de la France. Même en faisant abstraction des fluctuations du marché, l’Egypte n’est pas à même de payer ses importations de céréales, tout comme la population n’est pas à même de payer le pain à son juste prix, d’où l’obligation pour l’Etat de subventionner le circuit de la boulangerie alors qu’il ne peut pas payer ses importations. Une telle situation ne peut se maintenir pour partie que par l’importation de blé américain offert au titre d’un programme alimentaire et pour partie par l’annulation régulière des dettes contractées auprès de divers fournisseurs. Cette situation qui n’a pas empêché en 2007 et en 2008, l’apparition d’émeutes du pain, entraîne vis-à-vis des Etats-Unis une situation de dépendance. Que se passerait-il si les dons américains venaient à cesser ? Et quelle puissance pourrait prendre le relais ? Cette dépendance de fait explique le maintien des relations apparemment apaisées entre l’Egypte et Israël et la modération de l’Egypte dans les conflits du Moyen-Orient. Mais cette politique définie par contrainte au niveau gouvernemental est perçue de façon très négative par la rue. D’où la progression des mouvements intégristes défenseurs de la dignité égyptienne mais confinés dans une opposition à la fois violente et larvée par la question du pain venu de l’étranger. Combien de temps une telle situation pourra-t-elle durer ? Savoir au demeurant si l’Egypte restera un cas d’exception ou si les situations de dépendance alimentaires se multiplieront dans les décennies à venir ?
L’EAU ET L’AVENIR DES VILLES
L’eau n’est évidemment qu’une composante parmi d’autres dans la question urbaine telle qu’elle se posera dans les décennies à venir. Mais c’est à travers cette composante que peuvent être posés quelques uns des problèmes majeurs que devra affronter la planète.
L’impossible gestion des grandes métropoles des pays pauvres
A l’échelle planétaire, on comptait onze villes de plus d’1 million d’habitants en 1900, elles sont 378 et regroupent 1,6 milliard d’habitants en 2009. Combien seront-elles en 2050 ? Si l’on estime qu’en 2050 (Brinkhoff, 2007), 65% des hommes vivront dans des villes, la notion même de ville tend à se modifier. Comment définir dès à présent la population de Paris ? S’agit-il de la population de la ville ou de l’agglomération soit une variation de 2,5 à 10,6 millions d’habitants. Il en va de même pour bien d’autres villes et les experts estiment que Tokyo compte maintenant 33,8 millions d’habitants, puisque l’agglomération englobe Yokohama et Kawasaki. En dépit de ces marges d’incertitude, il est certain que les villes des pays riches ne connaîtront pas une croissance marquée pour deux raisons, l’une d’ordre démographique puisque leur population ne croîtra que par le biais de l’immigration, l’autre parce que ces pays disposent de réseaux urbains bien étoffés, de sorte qu’une éventuelle croissance se répartirait sur de nombreuses agglomérations. Il n’en ira pas de même dans les pays dits en voie de développement ou même dans les nouveaux pays industriels qui ne comptent que peu de villes, aux équipements souvent déficitaires, ce qui suppose une concentration des investissements et des populations migrantes dans un petit nombre de métropoles. Dans ces pays, les rares villes et surtout les villes capitales attireront la masse des excédents de population rurale, paysans sans terre ou ruinés par des crises climatiques ou autres dont les effets seront démultipliés par la pauvreté générale. Cette attraction urbaine s’explique déjà très simplement par le fait que les aides internationales sont concentrées dans les rares métropoles et que dans ces mêmes métropoles, les gouvernements font tout pour éviter les émeutes de la faim.
Ne généralisons pas. Certains gouvernements soutiennent le dynamisme des villes moyennes pour éviter la croissance excessive de leurs villes capitales. C’est notamment le cas de l’Algérie ou cette politique sera confortée dans les années à venir par l’achèvement de la transition démographique. Ailleurs, certaines métropoles verront leur population stagner ou même diminuer faute d’être attractives. C’est le cas de Calcutta, alors que la population de Myumbai (Bombay) qui compte déjà 22 millions d’habitants approchera des 30 millions d’habitants, chiffre atteint ou même dépassé par Mexico à l’horizon 2030. En Afrique, Lagos qui compte déjà 11 millions d’habitants aura doublé ce chiffre avant 2015 et le triplera à l’horizon 2050. Dakar qui abrite déjà dans une nébuleuse urbaine aux contours mal définis de près de 3 millions d’habitants en comptera au moins 5 millions à cette même date et Abidjan en rassemblera sans doute davantage.
Faute de moyens, ces très grandes villes qui n’auront d’autre objectif que de garantir la survie de leurs habitants, offriront le spectacle d’une étonnante dégradation centrifuge entre les centres villes regroupant les organes politiques et les instances économiques, les quartiers périphériques aux équipements insuffisants et des zones d’habitat spontané dépourvues d’infrastructures. Ces discontinuités se retrouvent dans les problèmes liés à l’eau, à commencer par celui de la desserte. De façon générale, ce qu’on peut appeler les beaux quartiers où sont concentrés ministères et ambassades bénéficient d’un approvisionnement continu et suffisant. Suivant une dégradation progressive à partir ce centre se succèdent, les immeubles ou les maisons qui reçoivent l’eau quelques heures par jour puis quelques heures de temps à autre et finalement, les quartiers où l’eau s’achète à des camions ravitailleurs qui remplissent des réservoirs de fortune. En fin de chaîne, des marchands des rues et des acheteurs qui remplissent quelques bouteilles de plastique. Dans ce système, plus vous êtes pauvre et plus vous payez cher une eau chichement distribuée et d’une qualité souvent douteuse. .
Certes, des efforts sont faits et l’on peut citer à titre d’exemple, l’installation en 2008, d’une usine de distillation d’eau de mer à Alger, ce qui va réduire les problèmes d’accès à l’eau. Mais cette abondance nouvelle met en évidence la vétusté d’un réseau de distribution où les pertes en ligne dépassent la moitié des volumes acheminés. Encore faut-il préciser qu’Alger dispose d’un réseau d’égout ce qui n’est pas le cas du Caire où les eaux usées s’infiltrent dans le sol et imbibent la base des immeubles dont certains finissent par s’écrouler.
Les choses ne peuvent que s’aggraver à proportion de la croissance urbaine dans les années à venir. On verra donc se multiplier dans des quartiers d’habitat spontané à la voierie inexistante, des habitations faites de matériaux de récupération avec des points d’eau rares ou inexistants. Au gré des saisons la poussière et la boue alterneront et leurs habitants, migrants peu au fait des pratiques urbaines, poseront de multiples problèmes allant de l’hygiène à la police des rues.
Les villes des pays riches n’échapperont pas aux problèmes de l’eau
Les métropoles des pays riches ne connaissent pas ou du moins pas encore de tels problèmes, sauf à les laisser se concentrer dans de lointains quartiers périphériques. Mais leur approvisionnement se fait de plus en plus difficile.
En Europe, le cas d’Athènes est exemplaire, puisqu’après avoir détourné les eaux du lac Iliki elle a entamé une série de captures en direction de l’ouest en s’appropriant au détriment des usagers locaux, les eaux du Kilissos puis du Mornos. On programme déjà pour les années 2030, le détournement de l’Aheloos et des eaux qui se jettent dans la mer Ionienne, le tout au détriment de programmes d’irrigation.
Aux Etats-Unis, les tensions sont encore plus fortes dans la région qui court entre Los Angeles et San Diego. Dans un premier temps, ce sont les syndicats d’irrigation qui ont détourné les eaux de la Sierra Nevada et des lacs Mono et Tahoe. Mais depuis quelques années – et ce mouvement tendra à s’amplifier dans l’avenir – ce sont les villes qui rachètent aux agriculteurs leurs droits d’eau, de sorte que de façon progressive, les beaux vergers de Californie vont laisser la place aux paysages originaux, faits de maigres taillis ravagés par les incendies. Face à cette évolution, les mouvements écologistes prônent une réduction du phénomène urbain et un changement de comportement chez les usagers. Il est vrai qu’ils auront fort à faire puisque les consommations urbaines atteignent des niveaux qui exigent une remise en ordre, le maximum étant atteint par Las Vegas avec 1 000 m3 par personne et par an.
Une conclusion s’impose donc : dans les prochaines décennies, la part de l’eau consommée par le secteur agricole ne pourra que diminuer, même en Egypte où la part de l’agriculture est déjà passée de 85 à 73%.
L’EAU ET LA SANTE
Il est certain que les surfaces irriguées vont s’accroître dans les années à venir, ce qui posera des problèmes de santé imparfaitement résolus à ce jour dans les pays chauds, notamment la malaria qui prolifère au fur et à mesure des nouveaux équipements. La bilharziose, affection qui attaque le système digestif par les larves ou les formes adultes de minuscules coquillages, les bulimes, a pu être éradiquée dans certains pays comme la Chine. Le parasite se transmet dans sa forme adulte par les pores de la peau dans l’eau des rizières ou des champs irrigués et par le biais de l’urine (celle des hommes et celle des animaux) contenant des larves ou carçaires. Ces parasites peuvent être éliminés de plusieurs façons dont la plus simple est d’empêcher bêtes et gens d’uriner dans les canaux d’irrigation ou d’obliger les travailleurs à porter des bottes et des gants les isolant de l’eau contaminée. Une autre solution consiste à immerger dans les canaux des sachets de sulfate de cuivre, substance qui tue les parasites. Las, dans bien des pays, les canaux, les rizières ou les moindres nappes d’eau servent de lieux d’aisance et le port de bottes et de gants excède les moyens financiers des agriculteurs. Dans l’avenir, la solution passera comme en Chine, par quelques moyens financiers et surtout par l’éducation. Les témoignages que l’on peut recueillir ici ou là montrent qu’il y a fort à faire.
Les villes des pays pauvres concentrent bien d’autres risques à commencer par le choléra qui est la maladie des eaux sales et par la fièvre jaune qui est une maladie des villes où l’eau stagne dans les rues faute d’égouts et de latrines.
Il se pourrait que dans l’avenir, plusieurs de ces affections gagnent les pays riches, à commencer par le choléra qui pourrait bien faire sa réapparition dans les quartiers d’habitat spontané où s’entassent les immigrants les plus pauvres. Le changement climatique, en fait la succession d’éts assez chauds pour favoriser le cycle biologique de certaines variétés d’anophèles pourrait introduire le cycle de la malaria dans les pays actuellement situés en climat tempéré. Le phénomène déjà observé à l’état sporadique, peut être facilité par les déplacements de masse : un moustique peut voyager en avion.
LE RISQUE ENVIRONNEMENTAL
La maîtrise de l’eau, qu’il s’agisse de la gérer en tant que ressource ou de s’en protéger en tant que risque, est à l’origine de la plupart des grands travaux de notre temps et il semble que cette maîtrise sera l’une des préoccupations majeures dans le futur proche ou lointain. Sans qu’il soit possible de traiter dans ce bref aperçu l’ensemble des problèmes en cause, il est possible de mettre en évidence trois problèmes majeurs.
La récupération de terres nouvelles par drainage, que ce soit à des fins urbaines (e.g. drainage de la lagune de Tunis) ou à des fins de production agricole (e.g. drainage des lacs Poianghu, Taïhu et autres en Chine) n’est pas sans provoquer de sérieux impacts et cela à toutes les échelles y compris celle du moindre ruisseau traversant une ville : les marais comme les lits majeurs des rivières retiennent les eaux en excès en cas de crues et les restituent en périodes d’étiage. Récupérer ces terres a pour conséquence un renforcement des crues et une aggravation des étiages.
La construction d’ouvrages de retenue pour assurer l’irrigation, la fourniture d’énergie ou le ravitaillement urbain, engendrent de multiples impacts sans même évoquer le problème des populations délogées : perte d’eau par évaporation sur les retenues et dégradation de la qualité de l’eau par désoxygénation ; comblement progressif des retenues et aggravation des phénomènes d’érosion à l’aval, recul des littoraux faute d’apports sédimentaires, ce problème étant particulièrement grave dans les deltas.
L’usage de l’eau pour l’irrigation peut entraîner la salinisation des sols, l’épuisement des nappes aquifères et la modification des systèmes de drainage. En ville, se posent de multiples problèmes surtout dans les pays pauvres où une partie importante des populations n’a pas accès à l’eau.
DES CONFLITS AUX GUERRES DE L’EAU
Les guerres telles que les avaient définies les chancelleries ne sont plus de saison. Elles sont larvées, opposent souvent des groupes distincts à l’intérieur de pays aux contours définis arbitrairement comme l’Irak ou le Soudan. Elles ne sont pas toujours distinctes des conflits qui vont de la simple dispute à la violence avérée, le glissement d’un extrême à l’autre étant toujours possible. Dans cette configuration, l’eau est actuellement à l’origine de conflits plus ou moins avérés mais qui peuvent faire l’objet d’arbitrages ou de compromis. Mais dans les cas limites, il y a bien dès maintenant des guerres larvées qui iront sans doute en se multipliant. Présents ou futurs, ces conflits tant aux échelles nationales qu’internationales, s’articulent autour de quatre thèmes : utilisation de la ressource, rive gauche-rive droite, amont-aval et conflits à l’échelle d’un bassin fluvial.
Conflits d’usage
Les conflits entre les divers usages de l’eau sont les plus répandus, les moins perçus aussi parce qu’ils opposent le plus souvent usages urbains et usages agricoles comme en Grèce ou en Californie et que ceux-ci sont sacrifiés à ceux-là, le ravitaillement urbain étant dans tous les cas de figure prioritaire. Ils sont en tout cas promis à un riche avenir, soit du fait de la concentration des hommes et dans les villes ce qui sera le cas des pays pauvres, soit du fait de l’accroissement de la consommation dans les pays riches (Bethemont, 2000). La Tunisie offre un cas emblématique de ces problèmes avec la construction d’un aqueduc qui devrait transporter de l’eau du Nord assez bien arrosé, vers le Sud dont le développement agricole est entravé par le manque d’eau. Mais cet aqueduc passe par Tunis et la ville laisse passer de moins en moins d’eau vers les Hautes steppes et la région de Sfax, ce qui engendre une tension interrégionale qui va s’aggravant.
Conflits entre deux rives
Les conflits entre rive gauche et rive droite relèvent de plusieurs logiques dont la plus simple tient à la hauteur des digues sur l’une et l’autre rive. Dans le Val de Loire, les digues situées en région rurale sont un peu plus basses et plus fragiles que celles qui protègent les villes. Les Vals inondables sont théoriquement frappés d’interdiction d’urbanisme mais en fait, ces contraintes sont souvent oubliées et la prolifération d’habitats tolérés mais non protégés entraînera de sérieux conflits lors de la prochaine crue centennale. Un problème identique se retrouve dans la plaine du Po ou il se double de tensions politiques. Enfin, dans la Chine du Nord, le Houang-Ho chargé de limon ne cesse d’exhausser sont lit et cette tendance qui a déjà engendré des catastrophes mémorables dans le passé se manifestera dans un futur encore indéterminé au détriment d’une rive sacrifiée à l’autre.
Les lits des fleuves servent souvent de frontières sans que cela porte fatalement à conséquence, mais la situation devient conflictuelle dès lors que les deux groupes riverains ne partagent pas une même culture. Au niveau le plus simple, les zones de contestation peuvent être soustraites à tout aménagement par accord tacite comme dans le cas du delta de l’Evros que se disputent la Grèce et Turquie. D’autres cas comme celui du fleuve Sénégal sont plus lourds de tension, car ce fleuve sépare deux Etats dont l’un se proclame arabe et l’autre négro-africain, l’un de culture nomade et l’autre de culture sédentaire. Il en est déjà résulté des conflits violents qui risquent de se reproduire dans l’avenir. Parmi les autres fleuves-frontières sujets à conflit, l’Amour entre Chine et Russie. Se pose enfin le cas du Rio Grande qui fixe la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, frontière qui ne suffit pas à arrêter le flot des migrants clandestins venus de toute l’Amérique du Centre et du Sud.
Conflits amont-aval et à l’échelle des bassins versants
Les conflits amont-aval sont de loin les plus fréquents, les régions amont contrôlant l’essentiel des débits alors que les besoins sont généralement plus importants dans les régions aval.
Certains de ces conflits ont pu être réglés de façon à peu près satisfaisante comme dans le cas du Colorado dont les eaux ont été progressivement accaparées par les Etats-Unis de sorte que seules des eaux rares et polluées passaient la frontière avec le Mexique. C’est seulement en 1944, que les Etats-Unis ont consenti à garantir un débit continu de 35 m3, ce qui est bien peu comparé aux 700 m3 mesurés au début du XXe siècle. Il est vrai que depuis cette date, les Etats-Unis ont fait des efforts considérables pour épurer ces rares eaux qui passent la frontière.
Il n’en va pas toujours de même et certains aménagements en cours sont lourds de conflits à venir. Ainsi des eaux du Tigre et de l’Euphrate que les Turcs ont longtemps regardé couler au profit des Syriens et des Irakiens. Tout a changé avec la mise en chantier en 1989 du GAP (Guneydogu Anadolu Projesi), projet doublement intéressant puisque d’une part il permet au prétexte de grands aménagements (22 barrages, 19 centrales électriques, 1,7 millions d’hectares à irriguer) de déplacer et contrôler des populations kurdes indociles, et que d’autre part il permet aux Turcs d’afficher leur suprématie face aux Syriens et aux Irakiens dont les dotations en eau sont déjà réduites et le seront encore plus dans les années à venir. Jusqu’à ce jour, le GAP a pu se réaliser sans que les Syriens et les Irakiens puissent réagir, puisque ces deux pays étaient déclarés hostiles par les Etats-Unis, alors que la Turquie était l’un des piliers de l’OTAN. Mais qu’en sera-t-il dans un futur proche, lorsque ces deux pays dits hostiles seront réintégrés dans la communauté des nations ? Il y a là un casus belli plein d’avenir.
L’avenir du Nil n’est pas moins inquiétant. Longtemps, ses eaux ont été utilisées par les seuls Egyptiens et point n’est besoin de rappeler qu’à défaut des eaux du Nil, l’Egypte serait un désert. Les choses se sont peu à peu modifiées à partir du moment où les colonisateurs anglais ont introduit à la fin du XIXe siècle, la culture du coton dans le Soudan et qu’ils ont soustraits à cette fin 4 km3 d’eau en ne laissant aux Egyptiens que 70 km3. Depuis, le Soudan a porté de façon unilatérale en 1959, sa dotation à 18,5 km3. Les Egyptiens ont réagi en créant le grand barrage d’Assouan qui stocke et régularise les débits du fleuve. Mais cette parade risque fort de s’avérer inefficace face à l’entrée en lice de nouveaux compétiteurs dont l’Ethiopie qui n’utilise que 0,3% des débits du fleuve alors que son territoire fournit 86% des débits mesurés à Khartoum. L’Egypte assure que la réalisation du programme éthiopien de 1,5 millions d’hectares irrigués, bien que justifié par la pauvreté et le dynamisme démographique de ce pays, constituerait un casus belli. Mais dans le même temps d’autres Etats riverains du Nil, Ouganda, Kenya, Tanzanie, font également état de vastes projets de périmètres irrigués. Certains experts essaient de concilier ces multiples contradictions en proposant le drainage des vastes marais qui jouent le rôle de machines évaporatoires dans le haut bassin (Bahr el Ghazal, Sudd, Machar) ce qui permettrait de récupérer jusqu’à 40 km3 avec toutefois quelques impacts : l’assèchement des marais détruirait les zones d’hivernage des oiseaux qui estivent en Europe, ce qui constituerait une catastrophe écologique majeure. On observe également que le canal du Jongleï qui devrait acheminer les eaux drainées du Sud vers le Nord, permettrait incidemment de faire naviguer des canonnières qui, venues du Nord mettraient rapidement fin au conflit qui oppose le Nord et le Sud du Soudan. De fait, les premiers travaux de creusement du canal du Jongleï ont été détruits à plusieurs reprises… Les guerres de l’eau ont déjà commencé.
Parmi les autres zones de conflit, figurent l’Asie centrale où les Etats d’amont ont multiplié les surfaces irriguées en asséchant la mer d’Aral et enfin le delta du Gange régulé dans sa branche occidental par le barrage de Farakka. Cet ouvrage situé juste à l’amont de la frontière avec le Bengladesh, permet aux Indiens de dériver une partie des débits en direction de Calcutta et du bras de l’Hooghly qui tend à dépérir. Incidemment, ce barrage permet d’alimenter les périmètres d’irrigation indiens en cas de sécheresse, au détriment des zones irriguées du Bengladesh. Mais en période de crue, il permet d’envoyer les débits excédentaires dans ce même pays, ce qui assure la protection de Calcutta. Observons incidemment que le rapport des forces armées se situe dans un rapport de un à dix en faveur de l’Inde. Cela suffira-t-il à assurer une paix armée dans les années à venir ?
Le Jourdain, un cas limite
Ce petit fleuve endoréique déverse en théorie 0,57 km3/an dans la Mer Morte, ce qui donne en Israël, une maigre dotation d’environ 250 m3/an/hab. mais seulement 41 m3/h/an pour les habitants des Territoires palestiniens. Cette situation discriminatoire a déjà suscité de nombreux conflits qui ne peuvent qu’empirer. Rappelons que si Israël est le principal utilisateur des eaux du Jourdain, il ne contrôle que 23% de l’écoulement annuel, le reste provenant de sources situées au Liban et en Syrie. La précarité induite par cette situation a déjà été à l’origine de l’occupation temporaire du Sud-Liban et a justifié l’occupation du Golan au terme du conflit israélo-syrien. Incidemment, la frontière entre Israël et la Jordanie passe non pas par le centre du lac de Tibériade mais par sa rive orientale ce qui permet d’en contrôler l’écoulement et de dériver ses eaux. Sur le plan intérieur, la discrimination à l’accès de l’eau repose sur une législation élaborée depuis 1947, au terme de laquelle : le forage des puits profonds est soumis à autorisation mais seuls les Israéliens bénéficient de celles-ci ; la consommation d’eau est fixée selon des quotas discriminatoires assortis d’amendes en cas de dépassement quotas qui n’affectent que les Palestiniens ; les puits et sources des Palestiniens « absents » sont confisqués ; l’eau est facturée à un prix élevé mais les agriculteurs israéliens bénéficient de subventions.
Dans un pays où l’eau constitue un constant sujet de préoccupation, il est certain qu’une telle situation bien visible dans le paysage avec le contraste entre les terres irriguées israéliennes et les terres sèches palestiniennes, engendre de fortes rancœurs, avivées par des faits tels que la santé des enfants de Gaza qui, contraints de boire une eau saumâtre, souffrent de calculs rénaux.
Cette situation intolérable pour les Palestiniens est-elle durable ? Guerre et Paix pourrait être l’une des clés de lecture de ce tableau : suprématie par la force affirmée par la création de colonies légales ou sauvages en Cisjordanie ; guerre larvée sous des formes telles que l’Intifada ou « guerre des ventres » qui fait que la population palestinienne s’accroît plus vite que la population juive en dépit d’une forte immigration de celle-ci ; Paix si, comme le demandent certains Israéliens, l’égalité des droits à l’eau contribuait à réduire les tensions et conflits actuels. En 2009, le fléau de la balance penche nettement vers la Guerre, une guerre qui ne dit pas son nom mais qui pourrait être exemplaire et prémonitoire des rapports entre riches et pauvres, dans un futur proche.
Big brother et les contradictions du droit international
Les conflits y compris ceux qui peuvent générer des luttes armées ne sont pas forcément inéluctables. En témoigne le partage des eaux de l’Indus entre l’Inde et le Pakistan. Le vaste réseau d’irrigation aménagé à l’époque de la domination anglaise a été rescindé par le tracé des frontières entre les deux nouveaux Etats et tout laissait entendre que cette situation allait déclencher un conflit armé dès 1947. Au terme de multiples contestations, les Etats-Unis ont proposé et imposé leur arbitrage en 1960 en posant en principe que les canaux d’irrigation pouvaient traverser la frontière sans détournement abusif de l’amont. La garantie d’un Etat fort et le soutien de la Banque mondiale font que le partage ainsi institué n’est pas remis en cause en dépit d’autres conflits entre les deux Etats. On objectera toutefois que la résolution de ce conflit résulte de l’intervention d’une tierce puissance en position de force. Est-ce une indication pour la résolution des conflits futurs ?
Il s’agit en tout état de cause, d’un cas d’exception mais les principes d’un Droit de l’Eau, avancés en 1966 par l’Association du Droit International (principes d’Helsinki) n’ont jamais pu être mis en œuvre faute de cohérence entre des positions bien tranchées : pour certains experts, la priorité d’usage doit être donnée aux premiers utilisateurs ; pour d’autres, il convient de définir les principes d’un partage équitable entre les divers usages et les divers pays riverains. On voit tout de suite ce qu’impliquent ces positions pour le Nil : dans un cas l’Egypte monopoliserait toute d’eau du fleuve ; dans l’autre, son économie et sa survie seraient remis en cause par un quelconque partage. L’une et l’autre solution sont inacceptables pour l’une ou l’autre des parties en cause. On retrouve peu ou prou les mêmes contradictions sur d’autres fleuves
Lire la suite ...dans LIEN.
VIDEO |
| |
|
| |
|
 |
|
Ces plantes qui envahissent le monde |
|
|
| |
|
| |

Ces plantes qui envahissent le monde
Ces plantes qui envahissent le monde
06.12.2023, par Marie Privé
Hippopotame au milieu de jacinthes d’eau, au parc Kruger (Afrique du Sud). La jacinthe d'eau, originaire d'Amérique du Sud, fait partie des espèces végétales exotiques les plus envahissantes dans le monde.
Tonino De Marco / Biosphoto
Partager
Moins médiatisées que les espèces animales invasives, les plantes exotiques envahissantes n’en sont pas moins féroces et se révèlent de redoutables concurrentes pour les plantes locales. Avec à la clé, des impacts négatifs sur les écosystèmes.
À Marseille, il n’y a pas que les touristes qui ont colonisé les Calanques. Une autre menace, plus insidieuse, vient elle aussi peser sur l’équilibre en péril de cet écosystème du pourtour méditerranéen. Des plantes exotiques originaires d’autres continents – griffe de sorcière, figuier de Barbarie ou encore agave d’Amérique –, ont tellement proliféré sur le sol des Calanques qu’elles menacent des plantes plus petites, fragiles et endémiques telles que l’emblématique astragale de Marseille. De 2017 à 2022, ce sont 200 tonnes de ces plantes exotiques envahissantes qui ont ainsi dû être arrachées au cours de coûteuses opérations d’éradication, mobilisant de nombreux scientifiques, entreprises spécialisées, bénévoles… et même, un hélicoptère !
Une conséquence de la mondialisation
Moins médiatisées que les espèces animales exotiques envahissantes – frelon asiatique et moustique tigre en tête –, les espèces végétales exotiques envahissantes n’en constituent pas moins une vraie menace pour les écosystèmes planétaires. Sur les dix espèces exotiques envahissantes les plus répandues dans le monde, listées dans le rapport que la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le « Giec de la biodiversité », vient de consacrer aux espèces exotiques envahissantes1 (lire plus bas), sept sont d’ailleurs des plantes, comme le lantanier, le robinier faux-acacia ou la jacinthe d’eau.

Très prisée dans les jardins pour ses qualités de couvre-sol, la griffe de sorcière originaire d'Amérique du Sud a colonisé tout le littoral français, mais aussi les côtes de Galice, en Espagne (notre photo).
Mar / stock.adobe.com
Partager
En France métropolitaine, la liste des plantes exotiques envahissantes ne cesse de s’allonger : l’hélianthe en forêt de Fontainebleau (Île-de-France), la jussie dans les zones humides, l’herbe de la pampa avec ses plumeaux blancs désormais si répandue dans l’Hexagone que les fleuristes l’ont adoptée dans leurs bouquets, la renouée du Japon, ou encore la fameuse griffe de sorcière très prisée des jardiniers pour ses qualités de couvre-sol et qu’on peut désormais observer des côtes méditerranéennes jusqu’à la pointe du Finistère. Des espèces dont les origines se situent respectivement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud (pour la jussie et l’herbe de la pampa), en Asie orientale et en Afrique du Sud.
En Polynésie française, 70 % de la surface de l'île de Tahiti est envahie par Miconia calvescens. Aussi surnommé le « cancer vert », le miconia a été retrouvé en Martinique en 2017, puis en Guadeloupe en 2020.
Certaines plantes exotiques ont une telle capacité à proliférer et à envahir les milieux où elles sont introduites qu’elles sont même qualifiées de « super envahissantes ». Les territoires d’outre-mer sont particulièrement touchés par ces espèces très performantes : « en Polynésie française, 70 % de la surface de Tahiti est envahie par Miconia calvescens, un arbre originaire d'Amérique centrale et du Sud », témoigne Céline Bellard, chercheuse CNRS au laboratoire Écologie, systématique et évolution2. Surnommé le « cancer vert », le miconia a été retrouvé plus récemment en Martinique en 2017, puis en Guadeloupe en 2020, menaçant l’équilibre fragile de ces écosystèmes insulaires.
Comment ces végétaux ont-ils atterri si loin de leur milieu d’origine ? L’introduction de ces plantes exotiques est intimement liée aux déplacements intercontinentaux effectués par les colons européens à partir du XVe siècle. « C’est ni plus ni moins l'héritage de Christophe Colomb, souligne Jonathan Lenoir, écologue, chercheur CNRS au laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés3. Les explorateurs ont ramené des espèces indigènes d’Amérique en Europe, et à l’inverse, ceux qui sont partis s’installer dans les colonies ont exporté là-bas les plantes qu’ils affectionnaient. »
La mondialisation, l’industrie, le commerce, l’agriculture et les nombreux déplacements internationaux ont fait le reste et expliquent le nombre croissant de plantes exotiques introduites à travers le monde au fil du temps, avec une nette accélération depuis les années 1970. « On a introduit ces végétaux en masse dans les jardins, les villes, sur les ronds-points, le long des routes, raconte Laurence Affre, écologue à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale4 (IMBE), parce qu’ils sont jolis, avec leurs couleurs et leurs formes inhabituelles. » C’est précisément ce qui est arrivé avec le miconia, introduit en 1937 à Tahiti comme plante ornementale dans un jardin botanique privé, ou avec la jussie, une plante aquatique ramenée en France entre 1820 et 1830 pour décorer des bassins d’agréments.

Griffe de sorcière et figuier de barbarie (gravures). Les premières plantes exotiques ont été ramenées des territoires d'Amérique par les explorateurs à partir du XVᵉ siècle.
akg-images / Florilegius (S. Watts, d’après S.A. Drake dans «The Botanical Register» by Edwards Sydenham, 1835 ; Hannah Zeller, «Wild Flowers of the Holy Land», 1876)
Partager
Quand les plantes prennent la route
Le caractère « utile » de certaines plantes explique aussi leur introduction. « Lorsqu’il y avait encore une activité militaire sur l’île de Bagaud (aujourd’hui partie intégrante du Parc national de Port-Cros, dans le Var), au XIXe siècle, l’armée y a initialement introduit les griffes de sorcière – devenues envahissantes – car celles-ci produisent des rameaux rampants avec des racines qui s’enfoncent dans le sol, ce qui permet de le stabiliser et de diminuer l’érosion », poursuit Laurence Affre.
Une fois introduites dans un nouveau milieu, les plantes exotiques ne se contentent pas de « rester plantées là ». Elles disposent en effet d’un large arsenal de vecteurs de dispersion pour « s’échapper » et parcourir des distances parfois très longues.
Problème : une fois introduites dans un nouveau milieu, les plantes exotiques ne se contentent pas de « rester plantées là ». Contrairement à ce que suggère l’expression, les plantes se déplacent ! Elles disposent en effet d’un large arsenal de vecteurs de dispersion pour « s’échapper » et parcourir des distances parfois très longues. Les graines issues de leur reproduction peuvent ainsi être transportées par les humains, sous les semelles de leurs chaussures ou les pneus de leurs véhicules, mais aussi par les animaux via leur pelage ou leurs déjections, par le vent ou encore par l’eau.
En ce qui concerne les plantes exotiques envahissantes, leur mobilité est d’autant plus rapide que les milieux naturels ont subi des perturbations liées aux activités humaines mais aussi naturelles (feux de forêt, tempêtes), devenues plus fréquentes en raison du changement climatique. On dit même qu’elles empruntent les routes pour se propager plus vite ! « Lorsque l’on construit une route, on rase tout et on détruit l’habitat indigène, explique Jonathan Lenoir. C’est cette remise à zéro qui permet aux plantes exotiques envahissantes de s’exprimer et de progresser beaucoup plus facilement que dans un écosystème indemne et compétitif. » C’est particulièrement vrai en montagne où, à cause du changement climatique, les plantes – toutes espèces confondues – ont tendance à migrer en altitude pour retrouver des températures plus fraîches.

Garde nature portant des feuilles de "Miconia calvescens" dans la forêt humide de Nouvelle-Calédonie.
Nicolas-Alain Petit / Biosphoto
Partager
Or, si 6 % « seulement » des plantes exotiques introduites hors de leur territoire d’origine deviennent envahissantes, d’après l’IPBES leur propagation a un impact bien réel sur la biodiversité dont on commence à prendre toute la mesure. Les espèces végétales exotiques envahissantes provoquent notamment « une dégradation des écosystèmes, avec une diminution de l'abondance des plantes indigènes et une modification importante des caractéristiques du sol », détaille Laurence Affre. Avec ses feuilles gigantesques, Miconia calvescens a ainsi la capacité d'étouffer complètement la végétation environnante, qui ne parvient plus à capter la lumière. « On assiste alors à la formation de forêts composées exclusivement de miconia qui détruisent l’habitat des espèces endémiques et les menacent d’extinction, en Polynésie et dans les Antilles notamment », indique Céline Bellard.
En forêt de Compiègne, le cerisier tardif modifie le fonctionnement de la forêt au détriment des plantes indigènes.
Ces plantes peuvent même aller jusqu’à modifier le fonctionnement de l’écosystème lui-même. « En forêt de Compiègne (Hauts-de-France), raconte Jonathan Lenoir, on s’est ainsi rendu compte que le cerisier tardif (originaire d’Amérique du Nord) était capable de court-circuiter le fonctionnement naturel de la forêt en modifiant le cycle de l’azote pour se l’accaparer, au détriment des plantes indigènes de l’écosystème. »
À la différence des espèces animales exotiques envahissantes, dont les impacts sur les territoires d’accueil sont plus immédiats, les plantes ont la particularité de générer des impacts à retardement, ce qui rend leurs dégâts d’autant plus compliqués à évaluer. « Ce que l’on observe aujourd’hui n’est peut-être que la partie visible de l’iceberg, s’inquiète Jonathan Lenoir, car il existe un retard de réponse important entre l’introduction d’une espèce et son premier impact visible. » Un délai de latence accentué par le fait que les graines peuvent rester jusqu’à plusieurs décennies en état de dormance dans le sol, jusqu’à ce que les conditions leur soient favorables pour germer (chaleur, pluie, perturbations). Ce que les écologues appellent la « banque de graines du sol » rend d’autant plus délicate leur éradication : une opération d’arrachage pratiquée une année ne suffira pas à prévenir le retour de la plante invasive les années suivantes.
Reproduction et développement plus efficaces
C’est que les végétaux transportés hors de leur milieu d’origine disposent d’avantages redoutables sur les plantes locales : lorsqu’ils sont introduits dans une nouvelle région géographique, ils se retrouvent dépourvus des ennemis présents dans leur aire d’origine et qui limitaient leur population. Sans les espèces animales herbivores, les agents pathogènes ou les parasites contre lesquels elles devaient lutter, « ces plantes peuvent allouer davantage de ressources à leur développement et à leur reproduction, contrairement aux plantes indigènes qui doivent toujours utiliser une partie de leur énergie pour combattre leurs ennemis traditionnels », explique Laurence Affre.
Les végétaux exotiques introduits dans une nouvelle région disposent d’avantages redoutables sur les plantes locales : les ennemis qui limitaient leur population dans leur aire d’origine en sont absents.
L’absence de coévolution entre les plantes exotiques et les espèces indigènes du milieu dans lequel elles ont été introduites, que celles-ci soient végétales ou animales, est fondamentale pour comprendre comment certaines plantes exotiques parviennent à concurrencer les plantes natives. « Au sein d’un écosystème, on a toujours observé des comportements envahissants, observe Jonathan Lenoir. Mais il parvient généralement à s’autoréguler pour rétablir le cycle : les espèces ayant coévolué les unes avec les autres, elles ont développé une dynamique naturelle, une sorte de mécanisme de contrôle qui permet de revenir à une situation d’équilibre dans la communauté indigène. »
En revanche, lorsqu’une plante exotique est introduite, les espèces autochtones se retrouvent dans une situation de « naïveté » face à cette nouvelle plante : n’ayant pas coévolué ensemble, les espèces indigènes n’ont pas pu développer les armes biologiques pour se défendre ou se protéger si jamais cette nouvelle plante devient envahissante. C’est particulièrement vrai dans les territoires insulaires qui, avec leurs écosystèmes clos et isolés, sont particulièrement vulnérables aux invasions biologiques : le nombre de plantes exotiques y dépasserait désormais le nombre de plantes indigènes sur plus d’un quart des îles dans le monde, selon l’IPBES !
Une réglementation insuffisante
Face à ce constat préoccupant, les leviers d’action semblent encore insuffisants. Côté législation, les mesures se révèlent disparates : 83 % des pays sont dépourvus de réglementation nationale spécifique sur les espèces exotiques envahissantes. Ils sont néanmoins de plus en plus nombreux à établir des listes de contrôle et des bases de données officielles répertoriant ces espèces (196 pays en 2022). L’Union européenne a mis en place en 2014 une liste réglementaire des espèces jugées préoccupantes (88 à ce jour, dont 41 plantes) et soumises à des restrictions strictes de détention, d’importation, de vente ou de culture. Mais le nombre d’espèces concernées par cette liste est trop faible, déplorent les scientifiques. « On est encore loin des politiques fermes de certains États insulaires comme la Nouvelle-Zélande, où l’on doit nettoyer ses chaussures à l’aéroport pour éviter le transport de graines, mais on progresse », regrette Céline Bellard.

La méthode d'éradication la plus efficace reste l'arrachage, comme ici dans l'île de Bagaud (Var) où une scientifique élimine un tapis de griffes de sorcière.
Élise Buisson
Partager
Les moyens de lutte contre les plantes exotiques envahissantes se sont fortement développés et affinés au cours de la dernière décennie. Pour éradiquer les plantes qui posent problème, l’arrachage reste la méthode la plus commune : « C’est efficace mais ça demande beaucoup de travail, concède Élise Buisson, chercheuse à l’IMBE et coordinatrice scientifique d’un programme ayant permis l’éradication des griffes de sorcière sur l’île de Bagaud. En raison de la banque de graines en dormance dans le sol, on doit revenir chaque année pour arracher de nouveau les nouvelles germinations qui font surface. » Pour maximiser les chances de réussite, rien n’est laissé au hasard : « Après avoir étudié le milieu, nous avons opté pour un protocole d’arrachage qui consistait à extraire non seulement les rameaux lignifiés, mais aussi leur litière (très riche en graines) », explique la chercheuse. L’éradication des griffes de sorcière a eu un effet significatif et positif sur la richesse et le recouvrement en plantes indigènes des communautés végétales du littoral et de l’intérieur de l’île.
Aujourd’hui encore, on trouve des plantes exotiques reconnues comme envahissantes en vente libre dans les jardineries françaises, comme l’arbre aux papillons ou la luzerne arborescente.
Plus complexes et chronophages, les techniques de lutte biologique font aussi partie des solutions explorées par la recherche, même si l’introduction de nouvelles espèces fait toujours peser un risque sur les écosystèmes… La colonisation de Miconia calvescens a par exemple pu être ralentie à Tahiti par l’introduction d’un champignon pathogène au début des années 2000.
Lutter contre les plantes envahissantes doit enfin passer par une nécessaire prise de conscience de la société, au-delà du seul cercle des spécialistes. « Il faut sensibiliser le grand public, qui doit comprendre pourquoi il ne faut pas introduire certaines espèces dans de nouveaux milieux, et surtout informer les décideurs politiques pour qu’ils agissent à la hauteur des dommages causés par les invasions biologiques », insiste Laurence Affre, qui regrette qu’aujourd’hui encore, on trouve des plantes exotiques reconnues comme envahissantes en vente libre dans les jardineries françaises, comme l’arbre aux papillons ou la luzerne arborescente...

Très à la mode dans les années 1970, notamment dans les habitats pavillonnaires, l’herbe de la pampa s’est « échappée » des jardins et se retrouve désormais sur tout le territoire français.
Guy Thouvenin / Robert Harding Heritage via AFP
Partager
À l’issue de la COP15 sur la diversité biologique de Kunming-Montréal, en décembre 2022, 188 gouvernements ont convenu de réduire d’au moins 50 % d’ici à 2030 l’introduction et l’implantation d’espèces exotiques envahissantes prioritaires. Un accord aussi ambitieux qu’essentiel face à l’urgence de la situation. Mais qui doit maintenant être suivi d’effets. ♦
------------------------------------------------------------------------------
Espèces exotiques envahissantes : l’IPBES tire la sonnette d’alarme
« Les espèces exotiques envahissantes (EEE) constituent une menace mondiale majeure pour la nature, les économies, la sécurité alimentaire et la santé humaine. » Ces mots alarmistes, employés en préambule du rapport sur les EEE publié le 4 septembre
(link is external)
dernier par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le « Giec de la biodiversité », sont loin d’avoir été choisis au hasard. Ils font face à un constat sans appel : « Ces espèces ont un rôle majeur dans 60 % des extinctions de plantes et d’animaux dans le monde, avec des coûts annuels dépassant désormais les 423 milliards de dollars. » Les espèces exotiques envahissantes peuvent être des animaux (vertébrés et invertébrés), comme le rat noir ou la fourmi d’Argentine, des micro-organismes, comme le champignon chytride, ou encore des plantes, comme le faux mimosa ou le ricin commun. Le rapport, rédigé par 86 experts de 49 pays sur la base de quatre ans et demi de travaux, constitue l’évaluation la plus complète jamais réalisée au sujet des espèces exotiques envahissantes, passant au crible à la fois leurs causes, leur diversité, leurs impacts et les solutions à mettre en place pour limiter les dégâts. ♦
À lire et à voir sur notre site
Espèces envahissantes : une catastrophe écologique et économique
COP15, un sommet pour enrayer la crise de la biodiversité
Notes
* 1.
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/publication-du-rapport-de-lipbes-sur-...(link is external)
* 2.
Unité CNRS/AgroParisTech/Université Paris-Saclay.
* 3.
Université de Picardie Jules Verne.
* 4.
Unité CNRS/Aix-Marseille Université/Avignon Université/IRD.
06.12.2023, par Marie Privé
Hippopotame au milieu de jacinthes d’eau, au parc Kruger (Afrique du Sud). La jacinthe d'eau, originaire d'Amérique du Sud, fait partie des espèces végétales exotiques les plus envahissantes dans le monde.
Tonino De Marco / Biosphoto
Partager
Moins médiatisées que les espèces animales invasives, les plantes exotiques envahissantes n’en sont pas moins féroces et se révèlent de redoutables concurrentes pour les plantes locales. Avec à la clé, des impacts négatifs sur les écosystèmes.
À Marseille, il n’y a pas que les touristes qui ont colonisé les Calanques. Une autre menace, plus insidieuse, vient elle aussi peser sur l’équilibre en péril de cet écosystème du pourtour méditerranéen. Des plantes exotiques originaires d’autres continents – griffe de sorcière, figuier de Barbarie ou encore agave d’Amérique –, ont tellement proliféré sur le sol des Calanques qu’elles menacent des plantes plus petites, fragiles et endémiques telles que l’emblématique astragale de Marseille. De 2017 à 2022, ce sont 200 tonnes de ces plantes exotiques envahissantes qui ont ainsi dû être arrachées au cours de coûteuses opérations d’éradication, mobilisant de nombreux scientifiques, entreprises spécialisées, bénévoles… et même, un hélicoptère !
Une conséquence de la mondialisation
Moins médiatisées que les espèces animales exotiques envahissantes – frelon asiatique et moustique tigre en tête –, les espèces végétales exotiques envahissantes n’en constituent pas moins une vraie menace pour les écosystèmes planétaires. Sur les dix espèces exotiques envahissantes les plus répandues dans le monde, listées dans le rapport que la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le « Giec de la biodiversité », vient de consacrer aux espèces exotiques envahissantes1 (lire plus bas), sept sont d’ailleurs des plantes, comme le lantanier, le robinier faux-acacia ou la jacinthe d’eau.
En France métropolitaine, la liste des plantes exotiques envahissantes ne cesse de s’allonger : l’hélianthe en forêt de Fontainebleau (Île-de-France), la jussie dans les zones humides, l’herbe de la pampa avec ses plumeaux blancs désormais si répandue dans l’Hexagone que les fleuristes l’ont adoptée dans leurs bouquets, la renouée du Japon, ou encore la fameuse griffe de sorcière très prisée des jardiniers pour ses qualités de couvre-sol et qu’on peut désormais observer des côtes méditerranéennes jusqu’à la pointe du Finistère. Des espèces dont les origines se situent respectivement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud (pour la jussie et l’herbe de la pampa), en Asie orientale et en Afrique du Sud.
En Polynésie française, 70 % de la surface de l'île de Tahiti est envahie par Miconia calvescens. Aussi surnommé le « cancer vert », le miconia a été retrouvé en Martinique en 2017, puis en Guadeloupe en 2020.
Certaines plantes exotiques ont une telle capacité à proliférer et à envahir les milieux où elles sont introduites qu’elles sont même qualifiées de « super envahissantes ». Les territoires d’outre-mer sont particulièrement touchés par ces espèces très performantes : « en Polynésie française, 70 % de la surface de Tahiti est envahie par Miconia calvescens, un arbre originaire d'Amérique centrale et du Sud », témoigne Céline Bellard, chercheuse CNRS au laboratoire Écologie, systématique et évolution2. Surnommé le « cancer vert », le miconia a été retrouvé plus récemment en Martinique en 2017, puis en Guadeloupe en 2020, menaçant l’équilibre fragile de ces écosystèmes insulaires.
Comment ces végétaux ont-ils atterri si loin de leur milieu d’origine ? L’introduction de ces plantes exotiques est intimement liée aux déplacements intercontinentaux effectués par les colons européens à partir du XVe siècle. « C’est ni plus ni moins l'héritage de Christophe Colomb, souligne Jonathan Lenoir, écologue, chercheur CNRS au laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés3. Les explorateurs ont ramené des espèces indigènes d’Amérique en Europe, et à l’inverse, ceux qui sont partis s’installer dans les colonies ont exporté là-bas les plantes qu’ils affectionnaient. »
La mondialisation, l’industrie, le commerce, l’agriculture et les nombreux déplacements internationaux ont fait le reste et expliquent le nombre croissant de plantes exotiques introduites à travers le monde au fil du temps, avec une nette accélération depuis les années 1970. « On a introduit ces végétaux en masse dans les jardins, les villes, sur les ronds-points, le long des routes, raconte Laurence Affre, écologue à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale4 (IMBE), parce qu’ils sont jolis, avec leurs couleurs et leurs formes inhabituelles. » C’est précisément ce qui est arrivé avec le miconia, introduit en 1937 à Tahiti comme plante ornementale dans un jardin botanique privé, ou avec la jussie, une plante aquatique ramenée en France entre 1820 et 1830 pour décorer des bassins d’agréments.
akg-images / Florilegius (S. Watts, d’après S.A. Drake dans «The Botanical Register» by Edwards Sydenham, 1835 ; Hannah Zeller, «Wild Flowers of the Holy Land», 1876)
Partager
Quand les plantes prennent la route
Le caractère « utile » de certaines plantes explique aussi leur introduction. « Lorsqu’il y avait encore une activité militaire sur l’île de Bagaud (aujourd’hui partie intégrante du Parc national de Port-Cros, dans le Var), au XIXe siècle, l’armée y a initialement introduit les griffes de sorcière – devenues envahissantes – car celles-ci produisent des rameaux rampants avec des racines qui s’enfoncent dans le sol, ce qui permet de le stabiliser et de diminuer l’érosion », poursuit Laurence Affre.
Une fois introduites dans un nouveau milieu, les plantes exotiques ne se contentent pas de « rester plantées là ». Elles disposent en effet d’un large arsenal de vecteurs de dispersion pour « s’échapper » et parcourir des distances parfois très longues.
Problème : une fois introduites dans un nouveau milieu, les plantes exotiques ne se contentent pas de « rester plantées là ». Contrairement à ce que suggère l’expression, les plantes se déplacent ! Elles disposent en effet d’un large arsenal de vecteurs de dispersion pour « s’échapper » et parcourir des distances parfois très longues. Les graines issues de leur reproduction peuvent ainsi être transportées par les humains, sous les semelles de leurs chaussures ou les pneus de leurs véhicules, mais aussi par les animaux via leur pelage ou leurs déjections, par le vent ou encore par l’eau.
En ce qui concerne les plantes exotiques envahissantes, leur mobilité est d’autant plus rapide que les milieux naturels ont subi des perturbations liées aux activités humaines mais aussi naturelles (feux de forêt, tempêtes), devenues plus fréquentes en raison du changement climatique. On dit même qu’elles empruntent les routes pour se propager plus vite ! « Lorsque l’on construit une route, on rase tout et on détruit l’habitat indigène, explique Jonathan Lenoir. C’est cette remise à zéro qui permet aux plantes exotiques envahissantes de s’exprimer et de progresser beaucoup plus facilement que dans un écosystème indemne et compétitif. » C’est particulièrement vrai en montagne où, à cause du changement climatique, les plantes – toutes espèces confondues – ont tendance à migrer en altitude pour retrouver des températures plus fraîches.
Or, si 6 % « seulement » des plantes exotiques introduites hors de leur territoire d’origine deviennent envahissantes, d’après l’IPBES leur propagation a un impact bien réel sur la biodiversité dont on commence à prendre toute la mesure. Les espèces végétales exotiques envahissantes provoquent notamment « une dégradation des écosystèmes, avec une diminution de l'abondance des plantes indigènes et une modification importante des caractéristiques du sol », détaille Laurence Affre. Avec ses feuilles gigantesques, Miconia calvescens a ainsi la capacité d'étouffer complètement la végétation environnante, qui ne parvient plus à capter la lumière. « On assiste alors à la formation de forêts composées exclusivement de miconia qui détruisent l’habitat des espèces endémiques et les menacent d’extinction, en Polynésie et dans les Antilles notamment », indique Céline Bellard.
En forêt de Compiègne, le cerisier tardif modifie le fonctionnement de la forêt au détriment des plantes indigènes.
Ces plantes peuvent même aller jusqu’à modifier le fonctionnement de l’écosystème lui-même. « En forêt de Compiègne (Hauts-de-France), raconte Jonathan Lenoir, on s’est ainsi rendu compte que le cerisier tardif (originaire d’Amérique du Nord) était capable de court-circuiter le fonctionnement naturel de la forêt en modifiant le cycle de l’azote pour se l’accaparer, au détriment des plantes indigènes de l’écosystème. »
À la différence des espèces animales exotiques envahissantes, dont les impacts sur les territoires d’accueil sont plus immédiats, les plantes ont la particularité de générer des impacts à retardement, ce qui rend leurs dégâts d’autant plus compliqués à évaluer. « Ce que l’on observe aujourd’hui n’est peut-être que la partie visible de l’iceberg, s’inquiète Jonathan Lenoir, car il existe un retard de réponse important entre l’introduction d’une espèce et son premier impact visible. » Un délai de latence accentué par le fait que les graines peuvent rester jusqu’à plusieurs décennies en état de dormance dans le sol, jusqu’à ce que les conditions leur soient favorables pour germer (chaleur, pluie, perturbations). Ce que les écologues appellent la « banque de graines du sol » rend d’autant plus délicate leur éradication : une opération d’arrachage pratiquée une année ne suffira pas à prévenir le retour de la plante invasive les années suivantes.
Reproduction et développement plus efficaces
C’est que les végétaux transportés hors de leur milieu d’origine disposent d’avantages redoutables sur les plantes locales : lorsqu’ils sont introduits dans une nouvelle région géographique, ils se retrouvent dépourvus des ennemis présents dans leur aire d’origine et qui limitaient leur population. Sans les espèces animales herbivores, les agents pathogènes ou les parasites contre lesquels elles devaient lutter, « ces plantes peuvent allouer davantage de ressources à leur développement et à leur reproduction, contrairement aux plantes indigènes qui doivent toujours utiliser une partie de leur énergie pour combattre leurs ennemis traditionnels », explique Laurence Affre.
Les végétaux exotiques introduits dans une nouvelle région disposent d’avantages redoutables sur les plantes locales : les ennemis qui limitaient leur population dans leur aire d’origine en sont absents.
L’absence de coévolution entre les plantes exotiques et les espèces indigènes du milieu dans lequel elles ont été introduites, que celles-ci soient végétales ou animales, est fondamentale pour comprendre comment certaines plantes exotiques parviennent à concurrencer les plantes natives. « Au sein d’un écosystème, on a toujours observé des comportements envahissants, observe Jonathan Lenoir. Mais il parvient généralement à s’autoréguler pour rétablir le cycle : les espèces ayant coévolué les unes avec les autres, elles ont développé une dynamique naturelle, une sorte de mécanisme de contrôle qui permet de revenir à une situation d’équilibre dans la communauté indigène. »
En revanche, lorsqu’une plante exotique est introduite, les espèces autochtones se retrouvent dans une situation de « naïveté » face à cette nouvelle plante : n’ayant pas coévolué ensemble, les espèces indigènes n’ont pas pu développer les armes biologiques pour se défendre ou se protéger si jamais cette nouvelle plante devient envahissante. C’est particulièrement vrai dans les territoires insulaires qui, avec leurs écosystèmes clos et isolés, sont particulièrement vulnérables aux invasions biologiques : le nombre de plantes exotiques y dépasserait désormais le nombre de plantes indigènes sur plus d’un quart des îles dans le monde, selon l’IPBES !
Une réglementation insuffisante
Face à ce constat préoccupant, les leviers d’action semblent encore insuffisants. Côté législation, les mesures se révèlent disparates : 83 % des pays sont dépourvus de réglementation nationale spécifique sur les espèces exotiques envahissantes. Ils sont néanmoins de plus en plus nombreux à établir des listes de contrôle et des bases de données officielles répertoriant ces espèces (196 pays en 2022). L’Union européenne a mis en place en 2014 une liste réglementaire des espèces jugées préoccupantes (88 à ce jour, dont 41 plantes) et soumises à des restrictions strictes de détention, d’importation, de vente ou de culture. Mais le nombre d’espèces concernées par cette liste est trop faible, déplorent les scientifiques. « On est encore loin des politiques fermes de certains États insulaires comme la Nouvelle-Zélande, où l’on doit nettoyer ses chaussures à l’aéroport pour éviter le transport de graines, mais on progresse », regrette Céline Bellard.
La méthode d'éradication la plus efficace reste l'arrachage, comme ici dans l'île de Bagaud (Var) où une scientifique élimine un tapis de griffes de sorcière.
Les moyens de lutte contre les plantes exotiques envahissantes se sont fortement développés et affinés au cours de la dernière décennie. Pour éradiquer les plantes qui posent problème, l’arrachage reste la méthode la plus commune : « C’est efficace mais ça demande beaucoup de travail, concède Élise Buisson, chercheuse à l’IMBE et coordinatrice scientifique d’un programme ayant permis l’éradication des griffes de sorcière sur l’île de Bagaud. En raison de la banque de graines en dormance dans le sol, on doit revenir chaque année pour arracher de nouveau les nouvelles germinations qui font surface. » Pour maximiser les chances de réussite, rien n’est laissé au hasard : « Après avoir étudié le milieu, nous avons opté pour un protocole d’arrachage qui consistait à extraire non seulement les rameaux lignifiés, mais aussi leur litière (très riche en graines) », explique la chercheuse. L’éradication des griffes de sorcière a eu un effet significatif et positif sur la richesse et le recouvrement en plantes indigènes des communautés végétales du littoral et de l’intérieur de l’île.
Aujourd’hui encore, on trouve des plantes exotiques reconnues comme envahissantes en vente libre dans les jardineries françaises, comme l’arbre aux papillons ou la luzerne arborescente.
Plus complexes et chronophages, les techniques de lutte biologique font aussi partie des solutions explorées par la recherche, même si l’introduction de nouvelles espèces fait toujours peser un risque sur les écosystèmes… La colonisation de Miconia calvescens a par exemple pu être ralentie à Tahiti par l’introduction d’un champignon pathogène au début des années 2000.
Lutter contre les plantes envahissantes doit enfin passer par une nécessaire prise de conscience de la société, au-delà du seul cercle des spécialistes. « Il faut sensibiliser le grand public, qui doit comprendre pourquoi il ne faut pas introduire certaines espèces dans de nouveaux milieux, et surtout informer les décideurs politiques pour qu’ils agissent à la hauteur des dommages causés par les invasions biologiques », insiste Laurence Affre, qui regrette qu’aujourd’hui encore, on trouve des plantes exotiques reconnues comme envahissantes en vente libre dans les jardineries françaises, comme l’arbre aux papillons ou la luzerne arborescente...
Très à la mode dans les années 1970, notamment dans les habitats pavillonnaires, l’herbe de la pampa s’est « échappée » des jardins et se retrouve désormais sur tout le territoire français.
Guy Thouvenin / Robert Harding Heritage via AFP
Partager
À l’issue de la COP15 sur la diversité biologique de Kunming-Montréal, en décembre 2022, 188 gouvernements ont convenu de réduire d’au moins 50 % d’ici à 2030 l’introduction et l’implantation d’espèces exotiques envahissantes prioritaires. Un accord aussi ambitieux qu’essentiel face à l’urgence de la situation. Mais qui doit maintenant être suivi d’effets. ♦
------------------------------------------------------------------------------
Espèces exotiques envahissantes : l’IPBES tire la sonnette d’alarme
« Les espèces exotiques envahissantes (EEE) constituent une menace mondiale majeure pour la nature, les économies, la sécurité alimentaire et la santé humaine. » Ces mots alarmistes, employés en préambule du rapport sur les EEE publié le 4 septembre
(link is external)
dernier par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le « Giec de la biodiversité », sont loin d’avoir été choisis au hasard. Ils font face à un constat sans appel : « Ces espèces ont un rôle majeur dans 60 % des extinctions de plantes et d’animaux dans le monde, avec des coûts annuels dépassant désormais les 423 milliards de dollars. » Les espèces exotiques envahissantes peuvent être des animaux (vertébrés et invertébrés), comme le rat noir ou la fourmi d’Argentine, des micro-organismes, comme le champignon chytride, ou encore des plantes, comme le faux mimosa ou le ricin commun. Le rapport, rédigé par 86 experts de 49 pays sur la base de quatre ans et demi de travaux, constitue l’évaluation la plus complète jamais réalisée au sujet des espèces exotiques envahissantes, passant au crible à la fois leurs causes, leur diversité, leurs impacts et les solutions à mettre en place pour limiter les dégâts. ♦
À lire et à voir sur notre site
Espèces envahissantes : une catastrophe écologique et économique
COP15, un sommet pour enrayer la crise de la biodiversité
Notes
* 1.
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/publication-du-rapport-de-lipbes-sur-...(link is external)
* 2.
Unité CNRS/AgroParisTech/Université Paris-Saclay.
* 3.
Université de Picardie Jules Verne.
* 4.
Unité CNRS/Aix-Marseille Université/Avignon Université/IRD.
DOCUMENT CNRS LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
