|
| |
|
|
 |
|
QU'EST-CE QUE LA RÃALITÃ VIRTUELLE ? |
|
|
| |
|
| |

QU'EST-CE QUE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ?
Nouveaux smartphones, casques de réalité virtuelle… aujourd’hui, tout le monde connaît de près ou de loin la réalité virtuelle. Elle permet de s’immerger, grâce à un ensemble de technologies, dans une reproduction numérique du monde réel ou dans un monde imaginaire. La réalité virtuelle est présente dans des domaines très variés allant du cinéma à la recherche, en passant par les jeux vidéo et l’industrie. Quelles sont les technologies associées à la réalité virtuelle ? Quels sont ses enjeux dans l’industrie et la recherche ? L’essentiel sur… la réalité virtuelle.
QU'EST-CE QUE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ?
La réalité virtuelle s’appuie sur un ensemble de technologies qui immergent une personne dans une reproduction numérique du monde réel ou dans un monde imaginaire. Plus le nombre de sens mobilisés est important – la vue, l’ouïe et le toucher – et plus l’immersion est efficace.
Grâce à différents outils comme des lunettes stéréoscopiques (le même type de lunettes que pour regarder des films en 3D) ou un casque immersif, l’utilisateur peut se déplacer dans un environnement plus ou moins sophistiqué, en 3D. Il peut vivre également une expérience interactive en manipulant virtuellement des objets, jusqu’à en ressentir le poids et la texture. L’expérience peut être enrichie par des manettes, gants, volants ou autres interfaces haptiques, pour des interactions plus complexes. Toutes ces interactions avec l’environnement virtuel ont lieu en temps réel.
Au-delà des scènes visibles en images de synthèse, l’immersion peut intégrer un avatar, qui évolue dans la scène au gré des intentions de son utilisateur. Toutes ces performances sont rendues possibles grâce à d’importants développements logiciels et algorithmiques qui permettent de restituer fidèlement l’environnement et de simuler finement les interactions entre les différents objets de la scène virtuelle au millimètre et à quelques millisecondes près.
RÉALITÉ VIRTUELLE,
AUGMENTÉE ET MIXTE, KÉSAKO ?
La réalité virtuelle est l’ensemble des technologies qui permettent une immersion dans une reproduction numérique du monde réel ou dans un monde imaginaire.
La réalité augmentée permet d’incruster, superposer à la scène réelle d’un flux vidéo capté par une caméra, des images virtuelles fixes ou animées en temps réel. Il existe déjà de telles applications dans le tourisme : monuments et restaurants sont ainsi montrés sous leur apparence d’il y a 500 ans ou décrits sur l’écran des smartphones en temps réel.
Un cran supplémentaire sera franchi avec la réalité mixte : il sera possible d’interagir avec un objet virtuel (personnages, objets, machines…) incrusté dans la captation vidéo de la scène réelle. Par exemple, on pourra étudier et valider l’utilisation d’un robot grâce à son avatar virtuel au stade de la conception, tout en le pilotant dans un environnement industriel réel.
L'HISTOIRE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE EN QUELQUES DATES CLÉS
La réalité virtuelle apparaît dans les années 50, d’abord dans le domaine du cinéma. Depuis, les progrès dans le domaine du numérique – logiciel, graphisme, algorithme, optimisation des capacités de calcul - ont permis de développer les technologies de réalité virtuelle dans de nombreux secteurs de l’économie. Aujourd’hui, la mise sur le marché de casques de réalité virtuelle (ou casques VR) permet aux industriels et au grand public des expériences immersives beaucoup plus accessibles.
Années 50-60
L’ancêtre de la réalité virtuelle est le Sensorama. Cette machine, imaginée en 1956, puis créée en 1962 par Morton Leonard Heilig, cinéaste, philosophe et documentariste permettait à son utilisateur de regarder un film en s’immergeant dans un univers 3D, comme s’il y était. La particularité de cette machine était qu’elle pouvait stimuler différents sens comme la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat. Cette machine est restée au stade de prototype car sa production aurait coûté trop cher.
En 1963, Ivan Sutherland, ingénieur en informatique, écrit un programme informatique nommé Sketchpad. Ce logiciel est considéré comme l’ancêtre des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), aujourd’hui utilisés par tous ceux qui font de la 3D. Pour cette invention, Ivan Sutherland reçoit en 1988 le prix Turing, qui récompense une personne ayant contribué à la communauté informatique avec une importance technique majeure et durable.
De 1965 à 1968, Ivan Sutherland, et son étudiant Bob Sproull, développent un nouveau moyen de visualiser des images de synthèse : l’Ultimate Display, ou Épée de Damoclès. L’Épée de Damoclès était un casque avec détecteur de mouvement intégré. Il porte ce nom en raison du bras mécanique nécessaire pour traquer les mouvements de la tête.
Années 80-90
En 1984, le CEA et l’IRISA créent le premier système de réalité virtuelle à retour d’efforts dans le cadre du grand programme national de recherche en automatique, ARA. Il s’agissait d’utiliser en temps réel des modèles 3D de l’environnement d’un robot téléopéré. Une première dans le domaine de la recherche.
Parallèlement, Jaron Lanier, chercheur en informatique, et Thomas Zimmerman, l’inventeur du gant sensitif, fondent VPL Research en 1985, une société pionnière dans le domaine de réalité virtuelle. Ensemble, ils inventent plusieurs moyens d’explorer la réalité virtuelle dont le « Dataglove » en 1987, ou « gant de données ». Ce gant comporte des capteurs et permet à un utilisateur de saisir un objet virtuel et de le manipuler, en numérisant en temps réel les mouvements de la main. La société va également développer les premiers casques de réalité virtuelle de la NASA, le casque VIEW. Ce dernier permettait d’immerger les astronautes dans diverses situations spatiales et de les entraîner. Ce casque était accompagné d'une combinaison qui permettait un suivi complet des mouvements du corps.
L’expression « réalité virtuelle » fut proposée et utilisée pour la première fois en 1989, par Jaron Lanier, fondateur de la société VPL Research.
En 1995, le CEA propose au monde industriel le premier système de simulation de poste de travail robotisé à retour d’efforts en bénéficiant des avancées dans le domaine des calculateurs qui ont permis de représenter des environnements complexes en 3D et surtout en temps réel.
Ces avancées majeures ont permis de donner naissance à une véritable école française de réalité virtuelle industrielle qui, à partir du début des années 2000, a commencé à pénétrer les bureaux d’étude de tous les grands groupes industriels dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile.
Aujourd'hui
Les progrès réalisés dans le domaine informatique améliorent toujours plus le réalisme et les interactions en temps réel de la réalité virtuelle. Parmi les innovations de rupture, la démocratisation des casques VR permet de réaliser des expériences immersives à moindre coût. En effet, il y a encore quelques années, le cave ou la salle immersive était l’unique moyen de réaliser de telles expériences. Mais ce moyen reste onéreux et lourd à mettre en œuvre. La réalité virtuelle est dans une phase de « révolution » et nombre de promesses sont encore à explorer.
LES OBJECTIFS DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Pour répondre aux besoins et aux envies des industriels et du grand public, les moyens se déploient sans cesse pour rendre la réalité virtuelle encore plus performante et permettre davantage d’interactions.
En améliorant les technologies de réalité virtuelle, les chercheurs poursuivent plusieurs objectifs :
* Voir et manipuler des objets imaginaires : les chercheurs et les utilisateurs peuvent laisser libre cours à leur créativité, et ainsi trouver des réponses à des questionnements qui étaient impossibles à résoudre sans réalité virtuelle.
* Vérifier et valider les concepts, les process, les produits avant la réalisation d’un prototype. Tester une maquette numérique avant de passer à une maquette réelle permet d’économiser du temps et de l’argent.
* Former à de nombreux métiers nécessite d’acquérir le « geste parfait » et les interfaces haptiques (bras articulés, manettes, gants, certains casques VR) participent à cet entraînement, par exemple pour des opérations de peinture, de pilotage d’avion, de chirurgie… voire d’apprentissage en auto-école. La réalité virtuelle peut également aider à soigner les phobies : l’immersion à l’aide des casques de réalité virtuelle permet à des personnes atteintes de phobies, comme la peur de l’avion ou la peur des araignées, de dépasser leur peur. Ils sont aussi de précieux outils pour apprendre à réagir aux situations de crise et à divers aléas.
* Étudier et diagnostiquer les postes de travail, établir leur cotation ergonomique, c’est-à-dire évaluer les postures des membres, du cou, et du tronc selon une grille d’observation. Les chercheurs peuvent, grâce à la réalité virtuelle, évaluer la pénibilité des tâches, repérer les postures pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques, et ainsi les prévenir. La réalité virtuelle permet aussi de déterminer si un geste humain est possible, compte tenu des contraintes de l’environnement où il sera réalisé et de mettre en place une éventuelle assistance cobotique.
* Simuler le réel pour assurer la sécurité d’une activité.
LES DOMAINES D'APPLICATION DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
L'usine du futur
Le recours croissant au numérique est devenu incontournable pour optimiser l’outil de production, dès sa conception, mais aussi simuler la réalisation de tâches ou superviser le fonctionnement des robots. La réalité virtuelle et la réalité augmentée contribuent ainsi de façon croissante à la formation industrielle et à l’apprentissage de certaines techniques de maintenance.
Parmi les industries intéressées par les technologies de réalité virtuelle, de grands constructeurs automobiles et, pour la partie grand public, des concepteurs de salles d'arcade et de jeux vidéo avec lesquels sont menés des projets collaboratifs de serious game. Certaines sociétés spécialisées dans les outils d'évaluation HSE (Hygiène – Sécurité - Environnement) ont montré comment la cotation ergonomique pouvait contribuer à modifier le design d'un poste de travail.
Démantèlement nucléaire
La réalité virtuelle est utilisée par les acteurs de la filière nucléaire pour notamment intervenir en milieu « hostile ». Dans le cadre de projets de démantèlement nucléaire, les équipes peuvent utiliser des solutions logicielles (salle de réalité virtuelle 3D immersive) et technologiques (équipements téléopérés sur une maquette réelle à l’échelle 1) pour les aider à concevoir, tester et optimiser les scénarios de démantèlement. Concrètement, la salle immersive reconstitue en trois dimensions les chantiers de démantèlement à réaliser grâce à un robot, ainsi qu’une reproduction « image » du robot lui-même.
Un poste complet de téléopération (bras haptique à retour d’effort, baies de contrôle-commande...) similaire à ceux utilisés sur le terrain, permet aux téléopérateurs de se former ainsi que de tester les capacités du robot. Au-delà de la formation des opérateurs, la simulation et la modélisation sont très utiles pour préparer les interventions et définir les dispositifs de radioprotection nécessaires.
Recherche fondamentale
La réalité virtuelle intéresse aussi la recherche fondamentale. Par exemple, dans le domaine de la santé ou de l'archéologie, l'utilisation de la réalité virtuelle procure de nouvelles capacités de visualisation et d'interaction pour modéliser de nouvelles molécules ou se mettre 'à hauteur' de nos ancêtres dans leur environnement reconstitué.
Loisirs
Les casques de réalité virtuelle sont de plus en plus utilisés pour les loisirs : jeux vidéo, audiovisuel pour permettre aux usagers une immersion toujours plus proche de la réalité.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
L'ESSENTIEL SUR... La réalité virtuelle |
|
|
| |
|
| |

L'ESSENTIEL SUR...
La réalité virtuelle
Publié le 12 décembre 2017
Nouveaux smartphones, casques de réalité virtuelle… aujourd’hui, tout le monde connaît de près ou de loin la réalité virtuelle. Elle permet de s’immerger, grâce à un ensemble de technologies, dans une reproduction numérique du monde réel ou dans un monde imaginaire. La réalité virtuelle est présente dans des domaines très variés allant du cinéma à la recherche, en passant par les jeux vidéo et l’industrie. Quelles sont les technologies associées à la réalité virtuelle ? Quels sont ses enjeux dans l’industrie et la recherche ? L’essentiel sur… la réalité virtuelle.
QU'EST-CE QUE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ?
La réalité virtuelle s’appuie sur un ensemble de technologies qui immergent une personne dans une reproduction numérique du monde réel ou dans un monde imaginaire. Plus le nombre de sens mobilisés est important – la vue, l’ouïe et le toucher – et plus l’immersion est efficace.
Grâce à différents outils comme des lunettes stéréoscopiques (le même type de lunettes que pour regarder des films en 3D) ou un casque immersif, l’utilisateur peut se déplacer dans un environnement plus ou moins sophistiqué, en 3D. Il peut vivre également une expérience interactive en manipulant virtuellement des objets, jusqu’à en ressentir le poids et la texture. L’expérience peut être enrichie par des manettes, gants, volants ou autres interfaces haptiques, pour des interactions plus complexes. Toutes ces interactions avec l’environnement virtuel ont lieu en temps réel.
Au-delà des scènes visibles en images de synthèse, l’immersion peut intégrer un avatar, qui évolue dans la scène au gré des intentions de son utilisateur. Toutes ces performances sont rendues possibles grâce à d’importants développements logiciels et algorithmiques qui permettent de restituer fidèlement l’environnement et de simuler finement les interactions entre les différents objets de la scène virtuelle au millimètre et à quelques millisecondes près.
RÉALITÉ VIRTUELLE,
AUGMENTÉE ET MIXTE, KÉSAKO ?
La réalité virtuelle est l’ensemble des technologies qui permettent une immersion dans une reproduction numérique du monde réel ou dans un monde imaginaire.
La réalité augmentée permet d’incruster, superposer à la scène réelle d’un flux vidéo capté par une caméra, des images virtuelles fixes ou animées en temps réel. Il existe déjà de telles applications dans le tourisme : monuments et restaurants sont ainsi montrés sous leur apparence d’il y a 500 ans ou décrits sur l’écran des smartphones en temps réel.
Un cran supplémentaire sera franchi avec la réalité mixte : il sera possible d’interagir avec un objet virtuel (personnages, objets, machines…) incrusté dans la captation vidéo de la scène réelle. Par exemple, on pourra étudier et valider l’utilisation d’un robot grâce à son avatar virtuel au stade de la conception, tout en le pilotant dans un environnement industriel réel.
L'HISTOIRE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE EN QUELQUES DATES CLÉS
La réalité virtuelle apparaît dans les années 50, d’abord dans le domaine du cinéma. Depuis, les progrès dans le domaine du numérique – logiciel, graphisme, algorithme, optimisation des capacités de calcul - ont permis de développer les technologies de réalité virtuelle dans de nombreux secteurs de l’économie. Aujourd’hui, la mise sur le marché de casques de réalité virtuelle (ou casques VR) permet aux industriels et au grand public des expériences immersives beaucoup plus accessibles.
Années 50-60
L’ancêtre de la réalité virtuelle est le Sensorama. Cette machine, imaginée en 1956, puis créée en 1962 par Morton Leonard Heilig, cinéaste, philosophe et documentariste permettait à son utilisateur de regarder un film en s’immergeant dans un univers 3D, comme s’il y était. La particularité de cette machine était qu’elle pouvait stimuler différents sens comme la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat. Cette machine est restée au stade de prototype car sa production aurait coûté trop cher.
En 1963, Ivan Sutherland, ingénieur en informatique, écrit un programme informatique nommé Sketchpad. Ce logiciel est considéré comme l’ancêtre des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), aujourd’hui utilisés par tous ceux qui font de la 3D. Pour cette invention, Ivan Sutherland reçoit en 1988 le prix Turing, qui récompense une personne ayant contribué à la communauté informatique avec une importance technique majeure et durable.
De 1965 à 1968, Ivan Sutherland, et son étudiant Bob Sproull, développent un nouveau moyen de visualiser des images de synthèse : l’Ultimate Display, ou Épée de Damoclès. L’Épée de Damoclès était un casque avec détecteur de mouvement intégré. Il porte ce nom en raison du bras mécanique nécessaire pour traquer les mouvements de la tête.
Années 80-90
En 1984, le CEA et l’IRISA créent le premier système de réalité virtuelle à retour d’efforts dans le cadre du grand programme national de recherche en automatique, ARA. Il s’agissait d’utiliser en temps réel des modèles 3D de l’environnement d’un robot téléopéré. Une première dans le domaine de la recherche.
Parallèlement, Jaron Lanier, chercheur en informatique, et Thomas Zimmerman, l’inventeur du gant sensitif, fondent VPL Research en 1985, une société pionnière dans le domaine de réalité virtuelle. Ensemble, ils inventent plusieurs moyens d’explorer la réalité virtuelle dont le « Dataglove » en 1987, ou « gant de données ». Ce gant comporte des capteurs et permet à un utilisateur de saisir un objet virtuel et de le manipuler, en numérisant en temps réel les mouvements de la main. La société va également développer les premiers casques de réalité virtuelle de la NASA, le casque VIEW. Ce dernier permettait d’immerger les astronautes dans diverses situations spatiales et de les entraîner. Ce casque était accompagné d'une combinaison qui permettait un suivi complet des mouvements du corps.
L’expression « réalité virtuelle » fut proposée et utilisée pour la première fois en 1989, par Jaron Lanier, fondateur de la société VPL Research.
En 1995, le CEA propose au monde industriel le premier système de simulation de poste de travail robotisé à retour d’efforts en bénéficiant des avancées dans le domaine des calculateurs qui ont permis de représenter des environnements complexes en 3D et surtout en temps réel.
Ces avancées majeures ont permis de donner naissance à une véritable école française de réalité virtuelle industrielle qui, à partir du début des années 2000, a commencé à pénétrer les bureaux d’étude de tous les grands groupes industriels dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile.
Aujourd'hui
Les progrès réalisés dans le domaine informatique améliorent toujours plus le réalisme et les interactions en temps réel de la réalité virtuelle. Parmi les innovations de rupture, la démocratisation des casques VR permet de réaliser des expériences immersives à moindre coût. En effet, il y a encore quelques années, le cave ou la salle immersive était l’unique moyen de réaliser de telles expériences. Mais ce moyen reste onéreux et lourd à mettre en œuvre. La réalité virtuelle est dans une phase de « révolution » et nombre de promesses sont encore à explorer.
LES OBJECTIFS DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Pour répondre aux besoins et aux envies des industriels et du grand public, les moyens se déploient sans cesse pour rendre la réalité virtuelle encore plus performante et permettre davantage d’interactions.
En améliorant les technologies de réalité virtuelle, les chercheurs poursuivent plusieurs objectifs :
* Voir et manipuler des objets imaginaires : les chercheurs et les utilisateurs peuvent laisser libre cours à leur créativité, et ainsi trouver des réponses à des questionnements qui étaient impossibles à résoudre sans réalité virtuelle.
* Vérifier et valider les concepts, les process, les produits avant la réalisation d’un prototype. Tester une maquette numérique avant de passer à une maquette réelle permet d’économiser du temps et de l’argent.
* Former à de nombreux métiers nécessite d’acquérir le « geste parfait » et les interfaces haptiques (bras articulés, manettes, gants, certains casques VR) participent à cet entraînement, par exemple pour des opérations de peinture, de pilotage d’avion, de chirurgie… voire d’apprentissage en auto-école. La réalité virtuelle peut également aider à soigner les phobies : l’immersion à l’aide des casques de réalité virtuelle permet à des personnes atteintes de phobies, comme la peur de l’avion ou la peur des araignées, de dépasser leur peur. Ils sont aussi de précieux outils pour apprendre à réagir aux situations de crise et à divers aléas.
* Étudier et diagnostiquer les postes de travail, établir leur cotation ergonomique, c’est-à-dire évaluer les postures des membres, du cou, et du tronc selon une grille d’observation. Les chercheurs peuvent, grâce à la réalité virtuelle, évaluer la pénibilité des tâches, repérer les postures pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques, et ainsi les prévenir. La réalité virtuelle permet aussi de déterminer si un geste humain est possible, compte tenu des contraintes de l’environnement où il sera réalisé et de mettre en place une éventuelle assistance cobotique.
*
Simuler le réel pour assurer la sécurité d’une activité.
LES DOMAINES D'APPLICATION DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
L'usine du futur
Le recours croissant au numérique est devenu incontournable pour optimiser l’outil de production, dès sa conception, mais aussi simuler la réalisation de tâches ou superviser le fonctionnement des robots. La réalité virtuelle et la réalité augmentée contribuent ainsi de façon croissante à la formation industrielle et à l’apprentissage de certaines techniques de maintenance.
Parmi les industries intéressées par les technologies de réalité virtuelle, de grands constructeurs automobiles et, pour la partie grand public, des concepteurs de salles d'arcade et de jeux vidéo avec lesquels sont menés des projets collaboratifs de serious game. Certaines sociétés spécialisées dans les outils d'évaluation HSE (Hygiène – Sécurité - Environnement) ont montré comment la cotation ergonomique pouvait contribuer à modifier le design d'un poste de travail.
Démantèlement nucléaire
La réalité virtuelle est utilisée par les acteurs de la filière nucléaire pour notamment intervenir en milieu « hostile ». Dans le cadre de projets de démantèlement nucléaire, les équipes peuvent utiliser des solutions logicielles (salle de réalité virtuelle 3D immersive) et technologiques (équipements téléopérés sur une maquette réelle à l’échelle 1) pour les aider à concevoir, tester et optimiser les scénarios de démantèlement. Concrètement, la salle immersive reconstitue en trois dimensions les chantiers de démantèlement à réaliser grâce à un robot, ainsi qu’une reproduction « image » du robot lui-même.
Un poste complet de téléopération (bras haptique à retour d’effort, baies de contrôle-commande...) similaire à ceux utilisés sur le terrain, permet aux téléopérateurs de se former ainsi que de tester les capacités du robot. Au-delà de la formation des opérateurs, la simulation et la modélisation sont très utiles pour préparer les interventions et définir les dispositifs de radioprotection nécessaires.
Recherche fondamentale
La réalité virtuelle intéresse aussi la recherche fondamentale. Par exemple, dans le domaine de la santé ou de l'archéologie, l'utilisation de la réalité virtuelle procure de nouvelles capacités de visualisation et d'interaction pour modéliser de nouvelles molécules ou se mettre 'à hauteur' de nos ancêtres dans leur environnement reconstitué.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Caractéristiques des diverses énergies |
|
|
| |
|
| |
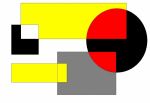
Caractéristiques des diverses énergies
Puissance, "perte" en chaleur, capacité de renouvellement… Ces caractéristiques déterminent l'usage que nous faisons des différentes énergies.
Publié le 1 juillet 2012
*
Bien que l’énergie soit une seule et même grandeur physique, ses diverses formes présentent des caractéristiques très différentes. Dans la pratique, le choix de tel ou tel type d’énergie dépendra donc du but poursuivi. Pour un objectif donné, par exemple produire de l’énergie électrique, il est essentiel, selon les circonstances, de peser le pour et le contre de chaque solution envisageable, et les critères de choix sont multiples.
ÉNERGIES DILUÉES OU CONCENTRÉES
De même qu’un billet de 50 euros permet d’acheter la même quantité de marchandises que 50 pièces de 1 euro, certaines formes d’énergie sont concentrées sous un volume beaucoup plus faible que d’autres. On peut de ce point de vue distinguer trois catégories, qui correspondent aux trois types de forces identifiées précédemment.
L’énergie de gravitation
L’énergie de gravitation n’est appréciable que si des masses considérables sont en jeu. On a vu que 1 kg d’eau tombant de 100 m ne fournit que 981 J (voir chapitre “Les diverses formes d'énergie”, paragraphe “Énergie de gravitation”) et que 1 kWh vaut 3 600 000 J (voir chapitre “Qu'est-ce que l'Énergie ?”, paragraphe “La puissance”). Pour libérer seulement 1 kWh, il faut faire chuter (3 600 000 J/981 J/kg) soit 3,67 t d’eau de 100 m. Les centrales hydroélectriques sont donc peu efficaces de ce point de vue. Les énergies mécaniques apparaissant dans notre vie courante ont aussi des ordres de grandeur très faibles. L’énergie cinétique d’une voiture pesant 1 tonne roulant à 100 km/h n’est que de 0,1 kWh.
La nature ne nous permet de convertir qu’une fraction de chaleur en une autre forme d’énergie.
Énergies calorifique, électrique, radiative et chimique
Dans la catégorie intermédiaire figurent les énergies calorifique, électrique, radiative et chimique, qui, pour les usages courants, se mesurent en nombres de l’ordre du kWh par kg de matière. Il faut fournir 0,1 kWh pour faire fondre 1 kg de glace, 0,7 kWh pour vaporiser 1 kg d’eau à 100 °C. Les appareils électroménagers consomment une puissance électrique comprise entre 0,1 et 5 kW. La combustion de 1 kg de pétrole ou de gaz fournit environ 12 kWh. Un homme élabore de l’énergie biochimique, provenant des aliments digérés et de l’air respiré. Il l’utilise pour maintenir sa température à 37 °C et exercer ses activités ; la puissance correspondante est de 100 W au repos, de 500 W en pleine activité physique.
On peut prendre conscience de l’écart qui sépare ces deux premières catégories d’énergie en notant que, si l’énergie mécanique d’un œuf tombant du sommet de la tour Eiffel était entièrement transformée en chaleur et utilisée pour échauffer l’œuf, sa température n’augmenterait que de 0,7 °C.
La catégorie intermédiaire des énergies diluées ou concentrées regroupe les énergies calorifique, électrique, radiative et chimique. Exemple : la combustion de pétrole ou de gaz. © PhotoDisc
Le calcul de l'énergie totale
Dans le Soleil, 1 kg d’hydrogène produit 180 millions de kWh. Pour des énergies aussi considérables, on vérifie la célèbre relation d’Einstein E = mc2, qui exprime que l’énergie totale d’un corps est proportionnelle à sa masse, nouvelle propriété d’équivalence ; mais le coefficient est énorme, puisque la vitesse c de la lumière vaut 300 000 km/s. De la sorte, une masse de seulement 1 mg équivaut à 25 000 kWh ; dans une centrale nucléaire, la transformation de 1 kg d’uranium naturel en d’autres éléments diminue l’énergie nucléaire du combustible de 100 000 kWh, et donc sa masse de 4 mg.
Les énergies renouvelables sont celles qui nous parviennent directement ou indirectement, du Soleil, du vent…
L’énergie nucléaire
L’énergie nucléaire est de loin une forme d’énergie beaucoup plus concentrée, puisque 1 kg d’uranium naturel fournit une quantité de chaleur de 100 000 kWh dans une centrale électrique courante, alors que 1 kg de charbon fournit en brûlant 8 kWh. C’est pourquoi on ne manipule que d’assez faibles masses de combustible nucléaire pour la production d’électricité : une centrale électronucléaire d’une puissance de 1 000 MW électriques (109 W) consomme 27 tonnes d’uranium enrichi par an, le quart de son chargement, alors qu’une centrale thermique de même puissance consomme 1 500 000 tonnes de pétrole par an. En fait, on ne sait extraire industriellement qu’une assez faible part de l’énergie nucléaire emmagasinée dans la matière. Dans le Soleil, 1 kg d’hydrogène produit, par réactions nucléaires le transformant en hélium, 180 millions de kWh.
LA DÉGRADATION
L’expérience montre qu’un système physique livré à lui-même tend à devenir spontanément de plus en plus désordonné. Parmi les diverses formes de l’énergie, la chaleur correspond à des mouvements désordonnés des molécules. Au contraire, les autres formes d’énergie, que l’on peut qualifier de “nobles”, sont ordonnées à l’échelle microscopique. Elles ont donc tendance à se changer en chaleur. Ce phénomène est appelé la dissipation, et l’on dit que la chaleur est une forme dégradée de l’énergie.
Il est facile de produire de la chaleur à partir d’une quantité équivalente d’énergie noble, par exemple dans des fours et chaudières, électriques ou à combustion, ou des capteurs solaires pour chauffe-eau. Mais les transformations inverses sont impossibles. Si l’on dispose d’une certaine quantité de chaleur, on ne peut pas la convertir intégralement en énergie mécanique, électrique ou chimique à l’aide d’un appareil qui fonctionnerait en cycle fermé, en revenant périodiquement à son état initial. Cette “interdiction” constitue l’une des grandes lois de la physique, confirmée par d’innombrables expériences : la nature ne nous autorise à convertir en une autre forme d’énergie qu’une fraction de la chaleur disponible, et elle impose à cette fraction de ne pas dépasser une certaine valeur maximale. C’est ce qui limite le rendement des turbines à vapeur dans les centrales électriques, des moteurs de voiture et d’avion, et de tous les engins délivrant de l’énergie mécanique à partir de l’énergie calorifique d’un gaz chaud.
La chaleur apparaît souvent comme une “perte” lorsqu’on manie les autres formes d’énergie (sauf, bien entendu, si l’on a en vue le chauffage domestique ou industriel). Afin d’exploiter l’énergie nucléaire ou l’énergie chimique dans une centrale électrique ou une automobile, on commence par produire de la chaleur par réaction nucléaire ou chimique ; seule une partie de cette chaleur peut ensuite être reconvertie en énergie électrique ou mécanique. La situation la plus favorable est celle de la conversion directe d’énergie mécanique en énergie électrique, et vice versa. Mais même dans ce cas, il est difficile en pratique d’éviter de détourner une part de ces énergies nobles vers de la chaleur. Si l’arbre d’un moteur entraîne celui d’un alternateur, le premier transforme de l’énergie électrique en énergie mécanique, et c’est l’alternateur qui reconvertit celle-ci en énergie électrique. Mais on récupère au total moins d’énergie électrique qu’on n’en a fourni ; la différence consiste en un dégagement de chaleur par effet joule, dans les bobinages ou par frottement, dans les paliers, impossible à éliminer totalement.
Cette équivalence entre les énergies est comparable à celle qui existe entre des monnaies convertibles, 1 dollar valant par exemple 0,98 euro. La dissipation en chaleur joue alors le rôle des frais bancaires qui nous empêchent de recouvrer le montant initial si nous changeons des euros en dollars, puis ceux-ci à nouveau en euros. La valeur comme l’énergie sont bien conservées au total, mais pas pour nous.
LE STOCKAGE
L’énergie électrique peut être emmagasinée dans des accumulateurs, sous forme d’énergie chimique. Mais la décharge d’un accumulateur fournit moins d’énergie électrique que sa charge, car les réactions électrochimiques s’accompagnent d’une assez forte dégradation en chaleur. De plus, les accumulateurs sont coûteux et lourds, puisqu’ils n’emmagasinent que 0,1 kWh par kg, ce qui est, avec le prix, la principale entrave au développement de la voiture électrique.
Nos besoins en puissance électrique varient avec l’heure, en croissant par exemple rapidement le soir ; et les centrales nucléaires ont du mal à suivre ces changements. Étant donné la faiblesse des pertes de chaleur dans les échanges électromécaniques, on a imaginé d’utiliser les barrages non seulement comme sources d’énergie hydroélectrique, mais aussi comme réservoirs d’énergie. En heures creuses, l’eau est pompée du bas du barrage vers la retenue par emploi d’énergie électronucléaire, et en heures de pointe, cette eau redescend, actionne les turbines de l’usine et l’on récupère de l’électricité. Puisque cette forme de stockage passe par de l’énergie mécanique, elle nécessite de brasser de fortes masses d’eau, plusieurs tonnes par kWh emmagasiné.
Les carburants, chimiques ou nucléaires, emmagasinent efficacement de l’énergie. Mais nous ne savons, en pareil cas, récupérer celle-ci que sous forme de chaleur.
LE TRANSPORT DE L'ÉNERGIE
La relative facilité de stockage et aussi de transport sur de grandes distances du charbon, du pétrole et du gaz a été l’un des facteurs primordiaux du développement de l’industrie depuis deux siècles. L’essor de l’automobile repose aussi sur la possibilité d’emporter avec soi assez de carburant pour parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Mais l’électricité est la seule forme d’énergie susceptible d’être à la fois transformée en quasi-totalité en n’importe laquelle des autres, et transportée au loin en grande quantité à un coût relativement faible. Les pertes de chaleur dans les lignes à haute tension et les transformateurs atteignent cependant 8%.
LES RÉSERVES
On distingue les énergies fossiles des énergies renouvelables. Les premières reposent sur l’exploitation de minéraux et combustibles formés durant l’histoire de la Terre et n’existant qu’en quantités limitées. En tenant compte de l’évolution des consommations, et de l’espoir de découvrir de nouveaux gisements, on peut estimer les réserves mondiales à quelques dizaines d’années pour le pétrole, à une centaine d’années pour le gaz ou l’uranium, à quelques siècles pour le charbon. Le développement de techniques comme celles des surgénérateurs suffirait cependant à multiplier nos réserves en énergie nucléaire par un facteur supérieur à 100.
Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont celles qui nous parviennent directement ou indirectement du Soleil, qui nous envoie en permanence son rayonnement. Il s’agit des énergies solaire, hydraulique, éolienne (celle du vent), mais aussi de l’énergie chimique qui s’accumule dans les végétaux utilisables comme combustibles (bois, déchets, alcool). La puissance totale que l’on peut tirer de ces énergies renouvelables est cependant limitée ; par exemple, il ne faudrait pas brûler les forêts à un rythme plus rapide que celui de leur croissance. Bien qu’elles constituent un appoint essentiel, les énergies renouvelables ne sauraient se substituer qu’en faible proportion aux énergies fossiles.
LES NUISANCES
La manipulation de toutes les formes d’énergie produit sur notre environnement des effets plus ou moins néfastes, qu’il importe de savoir apprécier cas par cas. Certains résidus de combustion du charbon, du pétrole, de l’essence, ou même du gaz s’il brûle mal, sont nocifs pour l’homme. Le principal gaz dégagé, le dioxyde de carbone, s’accumule dans l’atmosphère, ce qui risque d’influer sur notre climat, en accroissant l’effet de serre. Les réactions nucléaires génèrent des déchets radioactifs, qu’il est essentiel de traiter ou de réduire surtout lorsqu’ils ont une longue durée de vie. Les centrales hydroélectriques noient des vallées. Les éoliennes sont bruyantes, et n’assurent pas une production continue ; de plus, elles occupent beaucoup d’espace pour d’assez faibles puissances. Les photopiles solaires ont le même défaut et sont très chères, de sorte que la transformation d’énergie solaire en électricité n’est adaptée qu’à l’alimentation d’habitations isolées ou au fonctionnement de petits appareils portables comme des calculettes ; de plus, la fabrication des photopiles est très coûteuse en énergie.
La pollution thermique
La dégradation de l’énergie entraîne une conséquence commune à toutes les énergies non renouvelables, la pollution thermique. La majeure partie des énergies fossiles que nous utilisons se change en définitive en chaleur. Nous avons vu, par exemple, que le bilan global du fonctionnement d’une voiture consiste en une transformation de l’énergie chimique de l’essence en chaleur cédée à l’environnement. Même si la pollution thermique est trop faible pour influencer le climat, elle peut avoir des effets locaux : une centrale thermique ou nucléaire refroidie par l’eau d’une rivière augmente de façon appréciable la température de cette eau en aval et peut ainsi modifier son équilibre écologique. D’importantes économies pourraient être réalisées en récupérant cette chaleur perdue. La moitié de l’énergie que nous utilisons est en effet destinée au chauffage domestique ou industriel, réalisé à l’aide de charbon, de gaz, de fioul ou d’électricité. Ce type de consommations pourrait être réduit par un meilleur emploi de la chaleur issue des centrales. En fait, la consommation moyenne d’énergie par habitant reflète non seulement un niveau de vie, mais aussi un niveau de gaspillage. Cet exemple illustre un point essentiel : la multiplicité des sources d’énergie répond à la diversité des usages, et une approche globale des problèmes énergétiques est indispensable.
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Les 4 interactions fondamentales |
|
|
| |
|
| |

Les 4 interactions fondamentales
Publié le 19 juillet 2018
Quatre interactions fondamentales régissent l’Univers : l’interaction électromagnétique, l’interaction faible, l’interaction nucléaire forte et l’interaction gravitationnelle. Les interactions électromagnétique, forte et faible sont décrites par le modèle standard de la physique des particules, qui est en cohérence avec la physique quantique, tandis que l’interaction gravitationnelle est actuellement décrite par la théorie de la relativité générale. Quelles sont les propriétés de chacune de ces interactions ? Quel est leur impact sur notre quotidien ? Quels sont les enjeux de la recherche sur les interactions fondamentales ?
L’INTERACTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE (FORCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE)
L’interaction électromagnétique régit tous les phénomènes électriques et magnétiques. Elle peut être attractive ou répulsive : par exemple, deux pôles d’aimants de même signe (« nord » ou « sud ») vont se repousser alors que deux pôles d’aimants de signe opposé vont s’attirer.
Cette interaction est liée à l’existence de charges électriques et est notamment responsable de la cohésion des atomes en liant les électrons (charge électrique négative) attirés par le noyau de l’atome (charge électrique positive).
Le photon est la particule élémentaire associée à l’interaction électromagnétique.
Il est de charge électrique nulle et sans masse, ce qui fait que cette interaction a une portée infinie.
J.C. Maxwell écrit, vers 1864, la théorie de l’électromagnétisme qui explique l’existence d’ondes électromagnétiques (ondes radio, infra-rouge, lumière, ultra-violet, rayons X et gamma). Leur importance n’est plus à démontrer.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, cette théorie a été reformulée grâce notamment aux travaux du physicien Feynman sous la forme de l’électrodynamique quantique pour y introduire les concepts quantiques de façon cohérente et qui décrit l’interaction comme un échange de photons.
L’INTERACTION FAIBLE (FORCE FAIBLE)
L’interaction faible est la seule qui agit sur toutes les particules, excepté sur les bosons. Elle est responsable de la radioactivité Bêta, elle est donc à l’origine de la désintégration de certains noyaux radioactifs.
Le rayonnement Bêta est un rayonnement émis par certains noyaux radioactifs qui se désintègrent par l'interaction faible. Le rayonnement β+ (β-) est constitué de positons (électrons) et se manifeste lorsqu’un proton (neutron) se transforme en neutron (proton). Un neutrino (antineutrino) électronique est également émis. Ce rayonnement est peu pénétrant : un écran de quelques mètres d'air ou une simple feuille d'aluminium suffisent pour l’arrêter.
Les particules élémentaires associées à l’interaction faible sont le boson neutre (le Z0) et les deux bosons chargés (les W+ et W−). Ils ont tous une masse non nulle (plus de 80 fois plus massifs qu’un proton), ce qui fait que l’interaction faible agit à courte portée (portée subatomique de l’ordre de 10-17 m).
La datation au carbone 14 est possible grâce à l’interaction faible. Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone qui se transforme en azote 14 par désintégration Bêta moins. Sa période radioactive, temps au bout duquel la moitié de ses atomes s’est désintégrée, est de 5 730 ans.
La technique du carbone 14 permet de dater des objets de quelques centaines d’années à 50 000 ans environ.
LE NEUTRINO
Le neutrino, particule élémentaire du modèle standard, n’est sensible qu’à l’interaction faible.
Le neutrino est un lepton du modèle standard de la physique pouvant prendre trois formes (ou saveurs) : le neutrino électronique, muonique et tauique. Les neutrinos n'ont pas de charge électrique et ont une masse très faible dont on connaît seulement une borne supérieure. Ils se transforment périodiquement les uns en les autres selon un processus appelé "oscillation des neutrinos". N'étant sensibles qu'à l'interaction faible, les neutrinos n'interagissent que très peu avec la matière si bien que pour absorber 50 % d'un flux de neutrinos, il faudrait lui opposer un mur de plomb d'une année-lumière d'épaisseur.
L’INTERACTION NUCLÉAIRE FORTE OU INTERACTION FORTE (FORCE FORTE)
L’interaction forte permet la cohésion du noyau de l’atome. Elle agit à courte portée au sein du proton et du neutron. Elle confine les quarks, particules élémentaires qui composent les protons et neutrons, en couples "quark−antiquark" (mésons), ou dans des triplets de quarks (un ou deux autres (anti) quarks) (baryons). Cette interaction se fait par l'échange de bosons appelés "gluons".
Le gluon est la particule élémentaire liée à l’interaction forte. La charge associée à cette interaction est la "charge de couleur". Lors de l'échange d'un gluon entre deux quarks, ils intervertissent leurs couleurs. L’interaction entre deux quarks est attractive et d’autant plus intense que ceux-ci sont distants l’un de l’autre, et est quasi nulle à très courte distance.
La réaction primordiale de fusion de deux protons en deutéron (un isotope naturel de l’hydrogène dont le noyau contient un proton et un neutron) est un processus dû à l’interaction faible dont le taux gouverne la lente combustion des étoiles. C’est ensuite l’interaction forte qui est à l’œuvre dans les chaînes de réactions nucléaires qui suivent et qui produisent d’autres noyaux.
Cette interaction est notamment responsable des réactions nucléaires qui ont lieu au sein du Soleil.
Les quarks portent une charge de couleur qui est à l’interaction forte ce que la charge électrique est pour la force électromagnétique. Un quark peut avoir trois couleurs, appelées par convention rouge, bleu et vert. Un antiquark a l’une des « anticouleurs » correspondantes : antirouge, antibleu et antivert.
Les quarks forment des particules composites « blanches », c’est-à-dire sans charge de couleur. Il y a deux manières de former ces hadrons : soit en combinant un quark et un antiquark dont la couleur et l’anticouleur s’annulent (par exemple rouge et antirouge) ; on parle alors de « méson ». Soit en associant trois quarks porteurs chacun d’une couleur différente ; de telles particules sont appelées « baryons » – par exemple le proton et le neutron.
L'INTERACTION GRAVITATIONNELLE (FORCE GRAVITATIONNELLE)
Dans la vision de la loi de la gravitation universelle de Newton, l’interaction gravitationnelle est celle qui agit entre des corps massifs. La force est attractive. La pesanteur et les mouvements des astres sont dus à la gravitation.
Dans le cadre de la relativité générale, la gravitation n’est pas une force mais une manifestation de la courbure de l’espace-temps. La gravitation ne fait pas partie du modèle standard, elle est décrite par la relativité générale. Elle se définit par la déformation de l’espace-temps.
La gravitation est la plus faible des quatre interactions fondamentales. Elle s'exerce à distance et de façon attractive entre les différentes masses. Sa portée est infinie.
La première théorie la décrivant efficacement est celle de Newton en 1687. Pesanteur, mouvements planétaires, structure des galaxies sont expliqués par la gravitation. En 1915, elle est remplacée par la théorie de la relativité générale d’Einstein qui sert de cadre à la description de l’Univers entier et où les masses déforment l’espace-temps au lieu d’y exercer des forces à distance.
A ce jour, on ne sait pas décrire l’interaction gravitationnelle par la mécanique quantique, et on ne lui connaît aucun boson médiateur.
Au niveau théorique, la gravitation pose problème car on ne sait pas la décrire à l’aide du formalisme de la « théorie quantique des champs », utilisé avec succès pour les trois autres interactions. L’hypothétique graviton serait la particule médiatrice de la gravitation dans une description quantique de cette interaction.
PORTÉE DE L'INTERACTION ENTRE DEUX CORPS
La masse du boson vecteur (ou médiateur) va définir la portée de l’interaction. Imaginez deux particules en interaction comme deux personnes se lançant une balle, représentant le boson vecteur : plus la balle est légère, plus ils peuvent la lancer loin. Par analogie, plus le boson vecteur est léger, plus la portée de l’interaction est grande.
Type Particules médiatrices (bosons vecteurs) Domine dans :
Force forte Gluons Noyau atomique
Force électromagnétique Photon Électrons entourant le noyau
Force faible Boson Z0, W+, W- Désintégration radioactive bêta
Gravitation Graviton ? (pas encore observé) Astres
LA THÉORIE DU TOUT : VERS L'UNIFICATION DES INTERACTIONS FONDAMENTALES ?
L’objectif des recherches est de trouver une théorie qui expliquerait simultanément les quatre interactions fondamentales.
L’unification des quatre interactions fondamentales fait partie des axes de recherche principaux de la physique des particules. Une première étape a été franchie il y a une trentaine d’années avec l’unification de l’interaction faible et de la force électromagnétique dans un même cadre : l’interaction électrofaible. Celle-ci se manifeste à haute énergie – environ 100 GeV. La suite logique de ce processus est d’y ajouter l’interaction forte. Mais, si convergence il y a, elle ne devrait se manifester qu’à des échelles d’énergie encore bien plus élevées (1015 ou 1016 GeV), totalement hors de portée des expériences actuelles. L’étape ultime, l’ajout de la gravité à ce formalisme, est encore plus éloignée et se heurte à des problèmes mathématiques non résolus pour le moment.
La théorie des cordes et la théorie de la gravitation quantique à boucles sont les deux cadres théoriques les plus étudiés aujourd’hui.
Les théories de dimensions supplémentaires, dont la théorie des cordes, ont été initialement proposées pour résoudre le problème de l’extrême faiblesse de la gravité. L’une des réponses serait que seule une petite fraction de la force gravitationnelle n’est perceptible, le reste agissant dans une ou plusieurs autres dimensions. Ces dimensions, imperceptibles, seraient courbées et non plates comme les quatre connues de l’espace et du temps.
Les cordes seraient des petits brins d’énergie en vibration qui seraient reliées dans plusieurs « branes » (des cordes qui se seraient étirées et transformées en grandes surfaces). Les branes seraient comme des barrières entre plusieurs dimensions, jusqu’à 10, mais ces dimensions supplémentaires nous sont invisibles.
Toute la physique fondamentale serait unifiée, c’est-à-dire la mécanique quantique avec la relativité générale.
La gravité quantique à boucles a pour but de quantifier la gravitation. Elle a notamment pour conséquences que le temps et l’espace ne sont plus continus, mais deviennent eux-mêmes quantifiés (il existe des intervalles de temps et d’espace indivisibles). La gravité quantique à boucles cherche à combiner la relativité générale et la mécanique quantique directement, sans rien y ajouter.
Cependant, à ce jour, aucune théorie unique ne peut expliquer de façon cohérente toutes les interactions.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
