|
| |
|
|
 |
|
Les capteurs quantiques, des instruments de mesure à la précision inégalée |
|
|
| |
|
| |
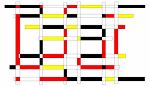
Les capteurs quantiques, des instruments de mesure à la précision inégalée
Si l’ordinateur quantique fait aujourd’hui figure de Graal à atteindre dans le domaine du quantique, il existe une autre branche beaucoup plus avancée qui exploite les mêmes propriétés : celle des capteurs quantiques. Ces derniers font d’ailleurs partie des solutions technologiques clés dans la quête de l’ordinateur quantique, pour détecter l’information encodée, mais pas seulement : prévision des séismes, sondage des sous-sols, télécommunications, mesures ultra-sensibles de champ électrique et magnétique, etc., leurs applications sont multiples. Explications.
PUBLIÉ LE 31 MARS 2022
Qu’est-ce qu’un capteur quantique ?
« Un capteur, par définition, est un outil qui permet de mesurer une ou plusieurs grandeurs physiques, explique Preden Roulleau, directeur de recherche au CEA-Iramis. Ils sont dits "quantiques" lorsqu’ils utilisent pour fonctionner des propriétés quantiques, comme le principe de superposition, l’interférence quantique ou l'intrication de leurs états quantiques ». Ces capteurs peuvent contenir différents types de particules (photons ou électrons), ou des atomes, que les physiciens sont capables de placer dans un état quantique donné. Ce dernier a la particularité d’être extrêmement sensible : la moindre perturbation dans l’environnement qui l’entoure peut l'altérer. D’où la précision et la sensibilité inégalée de ces capteurs.
Depuis quand cette idée de capteur quantique est-elle développée ?
L’origine des capteurs quantiques est assez ancienne : en effet, dès les années 1950, les horloges atomiques ont démontré l’intérêt de l’utilisation d’un système quantifié et parfaitement reproductible pour la réalisation des étalons de fréquence - une propriété à l’origine de la redéfinition de la seconde à partir d’une transition de l’atome de césium. Aujourd’hui, les horloges atomiques permettent de réaliser et de garder synchrones l’ensemble des échelles de temps réalisées dans le monde.
L'horloge atomique à fontaine d'atomes de Césium NIST-F1. Cette horloge est l'étalon primaire de temps et de fréquence des États-Unis, avec une incertitude de 5.10-16 (en 2005). © Domaine public
Quelles sont les applications de ces capteurs ultra sensibles ?
Du développement des horloges atomiques ont découlé de nombreuses applications dans les domaines des télécommunications, des transports, de la certification des transactions et bien sûr des systèmes de positionnement par satellite.
Par ailleurs, de nouveaux types de capteurs sont aussi issus de ces premières horloges : les capteurs à atomes froids, ou interféromètres. Leurs applications sont multiples : les gravimètres (mesurant la gravité) peuvent servir à prévoir les séismes ou prospecter les sous-sols. Certains sont d’ailleurs déjà commercialisés par la société française Muquans (la première et la seule entreprise au monde à le faire), qui fabrique des gravimètres utilisés pour sonder le sol, et détecter par exemple la formation d’une poche de magma dans un volcan. Les accéléromètres (qui mesurent l’accélération) peuvent être utilisés dans la mise au point de systèmes de navigation autonomes.
D’autres capteurs, fonctionnant grâce à un défaut contenu dans un cristal de diamant (le centre NV* du diamant), sont eux capables de « mesurer des champs magnétiques avec une résolution spatiale exceptionnelle, puisqu’on peut s’approcher extrêmement près d’une source de champ magnétique, à quelques nanomètres », souligne Patrice Bertet, chercheur au CEA-Iramis. Ils sont notamment utilisés pour caractériser les propriétés magnétiques de certains matériaux. Ces capteurs ont aussi l’immense avantage de pouvoir être utilisés dans des conditions de pression et de température ambiantes, ce qui facilite et élargit leur utilisation.
S’ils sont les plus développés actuellement, les interféromètres et les capteurs à diamant à centre NV ne sont pas les seuls types de capteurs quantiques existants. « Les propriétés quantiques de la lumière peuvent aussi être mises à profit pour améliorer la performance d’un interféromètre, explique Patrice Bertet. Les états quantiques « comprimés » sont notamment mis en œuvre depuis deux ans dans Lirgo et Virgo, les deux interféromètres à ondes gravitationnelles ». Une véritable prouesse car ces capteurs ont permis de détecter pour la première fois, en 2015, des ondes jusqu’alors restées indétectables, issues de la violente coalescence de deux trous noirs situés à 1,3 milliard d’années-lumière de la Terre.
Il existe également des capteurs reposant sur des circuits supraconducteurs, développés notamment par Patrice Bertet et son équipe. « Avec ces capteurs, nous effectuons de la détection ultra-sensible de la résonance magnétique, avec une sensibilité allant à quelques dizaines de spin et que nous espérons pousser au spin unique dans un avenir proche. Enfin, certains des capteurs développés au CEA sont autant de briques qui pourront un jour, en répondant à certains défis posés dans le cadre du traitement quantique de l’information, contribuer à la construction d'un ordinateur quantique.
MAG4HEALTH : DES CAPTEURS QUANTIQUES AU SERVICE DE L’IMAGERIE MÉDICALE DE POINTE
Créée tout récemment en 2021, la start-up Mag4Health issue du CEA-Leti a mis au point, à partir de capteurs quantiques développés au CEA-Leti, une nouvelle génération de magnétoencéphalographes (MEG) fonctionnant à température ambiante. La magnétoencéphalographie ou MEG est une méthode de neuro-imagerie qui consiste à enregistrer, en temps réel, l’activité électromagnétique du cerveau, améliorant ainsi le diagnostic de certaines maladies neuronales. On compte aujourd’hui une centaine de dispositifs MEG en milieu hospitalier du fait de leur coût, jusqu’à 2,5 millions d’euros l’unité, mais aussi de leur poids, plus de 5 tonnes. Mag4Health entend révolutionner l’accès à la MEG avec l’introduction d’un dispositif non invasif, cinq fois moins cher et pesant 300 kg environ. Cette démocratisation devrait permettre de faire émerger de nouveaux usages cliniques, tels que la rééducation après un AVC ou encore le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. La start-up déploie depuis 2021 ses prototypes à base de capteurs quantiques en milieu CHU.
Comment fonctionnent ces capteurs quantiques ?
Dans le cas des diamants à centre NV, on utilise un défaut contenu dans des diamants de synthèse – un atome d’azote et une lacune, qui remplacent un atome de carbone. Ce défaut, soumis à un laser, émet une lumière dont l’intensité dépend de l’état de spin des électrons qui l’entourent – un état de spin étant un état de rotation de l’électron purement quantique et sensible au champ magnétique. Ainsi, en présence d’un champ magnétique extérieur, ces états de spin vont se modifier, et modifier l’intensité de la lumière émise par le défaut. C’est comme cela que l’on peut remonter de manière très précise à la valeur du champ magnétique.
Les interféromètres fonctionnent un peu différemment : on utilise des atomes refroidis par laser à des températures très basses (à quelques microkelvins du zéro absolu, soit -273,15°C), ce qui a pour conséquence de les ralentir (leur vitesse s’approche de zéro). Cette faible vitesse des atomes refroidis permet de mesurer de manière extrêmement précise les forces auxquelles ils sont soumis. « Les interféromètres ainsi obtenus sont très sensibles à la rotation, à la gravité et à l’accélération », indique Patrice Bertet.
Quels sont les enjeux de R&D autour des capteurs quantiques ?
La très grande sensibilité des capteurs quantiques va de pair avec une très grande fragilité face aux sources de décohérence, ce qui explique que l’utilisation de la plupart de ces capteurs reste aujourd’hui encore limitée à des marchés très spécifiques. Les enjeux de R&D affirmés dans la stratégie nationale sur les technologies quantiques consisteront à consolider la position de la France sur les capteurs à atomes froids et à développer la prochaine génération de senseurs inertiels, de capteurs magnétiques et d’horloges atomiques.
En particulier, pour les capteurs quantiques développés au CEA, les axes de recherche consistent d’une part à explorer des systèmes qui permettraient de s'affranchir de la contrainte des très basses températures et d’autre part à développer la réalisation des circuits à plus grande échelle que l’échelle du laboratoire. Des pas se font dans ce sens, avec par exemple la réalisation d'un Qubit silicium au CEA-Leti, à Grenoble en 2016 - la technologie silicium très bien maitrisée pouvant permettre une réalisation plus aisée des circuits et faciliter le passage à l’échelle. La recherche se poursuit dans le cadre notamment du projet ERC Synergy QuCube, mené par des chercheurs du CEA et du CNRS, et du projet H2020 QLSI piloté par le CEA-Leti. Le plan quantique national offre à QuantAlps de belles opportunités dans le domaine avec des très beaux projets instruits dans le cadre du PEPR qui vont démarrer prochainement.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Quâest-ce que le boson de Higgs ? |
|
|
| |
|
| |

Qu’est-ce que le boson de Higgs ?
Dans la théorie quantique des champs, les particules sont considérées comme des ondes dans un champ. (Image: Piotr Traczyk/CERN)
Pour répondre à cette question, il faut plonger dans le monde quantique et comprendre comment les particules interagissent...
La particule que nous appelons aujourd’hui « boson de Higgs » a été mentionnée pour la première fois dans un article scientifique rédigé par Peter Higgs en 1964. À cette époque, des physiciens tentaient de décrire la force faible – l'une des quatre forces fondamentales de la nature – à l'aide d'un cadre appelé « théorie quantique des champs ».
Une particule, une onde ou les deux ?
D’après la théorie quantique des champs, le monde microscopique des particules est très différent du monde tel que nous le voyons. Les « champs quantiques » fondamentaux remplissent l’Univers et dictent ce que la Nature peut et ne peut pas faire. Selon cette description, chaque particule peut être représentée par une onde dans un « champ », comparable à une vaguelette formée sur la surface d’un vaste océan. Le photon est un bon exemple, car cette particule de lumière est une onde dans un champ électromagnétique.
Porteuses de force
Lorsque deux électrons interagissent, ils échangent un photon, la particule de la lumière. (Image: Ana Tovar/CERN)
Lorsque les particules interagissent entre elles, elles échangent des particules « porteuses de force ». Ce sont des particules, mais elles peuvent également être décrits comme des ondes dans leurs champs respectifs. Par exemple, lorsque deux électrons interagissent, ils le font en échangeant des photons – les photons sont les particules porteuses de force de l’interaction électromagnétique.
Symétrie
Une autre caractéristique importante des particules est la symétrie. Une forme peut être qualifiée de symétrique si elle reste identique lorsqu’on la fait pivoter ou qu’on la retourne ; cette propriété existe par analogie dans les lois de la nature.
Par exemple, la force électrique entre des particules ayant une charge électrique égale à 1sera toujours la même, qu’il s’agisse d’un électron, d’un muon ou d’un proton. Ces symétries constituent la base de la théorie et définissent sa structure.
Le mécanisme de Brout-Englert-Higgs
La théorie quantique des champs constituait déjà la base de l’électrodynamique quantique, qui offrait une description très efficace de l’interaction électromagnétique. Il était impossible, en revanche, d’appliquer cette approche à l’interaction faible, car alors, selon la théorie, les particules ne pouvaient pas avoir de masse.
En particulier, les particules porteuses de la force faible, connues sous le nom de bosons W et Z, devaient être dépourvus de masse, faute de quoi une symétrie fondamentale de la théorie serait brisée et cette dernière ne pourrait plus fonctionner. Or cette condition posait un problème de taille : les particules porteuses de la force faible devaient nécessairement avoir une masse pour que l’hypothèse de la portée très courte de l’interaction faible reste cohérente.
La solution à ce problème a été apportée par le mécanisme de Brout-Englert-Higgs. Ce mécanisme repose sur deux éléments principaux : un champ quantique entièrement nouveau et un ajustement ingénieux. Le nouveau champ en question est ce que nous appelons aujourd’hui le champ de Higgs. Quant à l’ajustement, il s’agit de la brisure spontanée de symétrie.
On envisage une symétrie, présente dans les équations d’une théorie, mais rompue dans le système physique. Imaginez un crayon posé à la verticale sur sa mine, au centre d’une table. Il s’agit d’une situation parfaitement symétrique, mais qui ne dure qu’un court instant, car le crayon va immédiatement briser la symétrie en tombant d’un côté ou d’un autre. Les lois de la nature, elles, restent inchangées, car le côté duquel tombera le crayon n’est pas prédéfini. Ainsi, le phénomène de rupture de la symétrie se produit sans remettre en question la symétrie de la physique.
La particule dans le champ de Higgs, en forme de « chapeau mexicain » (à gauche) et le crayon tenant sur sa mine (à droite) sont deux images représentant la rupture spontanée de symétrie – la symétrie existe, mais ne dure qu’un bref instant. (Image: Ana Tovar/CERN)
En ce qui concerne la masse des particules, voici ce qui se passe : à sa naissance, l’Univers était rempli du champ de Higgs dans un état instable, mais symétrique. Une fraction de seconde après le Big Bang, le champ a trouvé une configuration stable, mais la symétrie initiale s’est brisée. Dans cette configuration, les équations restent symétriques, mais la symétrie brisée du champ de Higgs confère leur masse aux bosons W et Z.
Comme cela s’est vérifié plus tard, d’autres particules élémentaires acquièrent également leur masse en interagissant avec le champ de Higgs, ce qui donne aux particules les propriétés que nous leur connaissons aujourd’hui.
Le boson de Higgs
Au CERN, le 4 juillet 2012, les collaborations ATLAS et CMS présentent des preuves dans les données du LHC pour une particule compatible avec un boson de Higgs, la particule liée au mécanisme proposé dans les années 1960 pour donner une masse aux particules W, Z et autres. (Image : Maximilien Brice/Laurent Egli/CERN)
C’est là qu’intervient le boson de Higgs. Si toutes les particules peuvent être représentées comme une onde dans un champ quantique, l’introduction d’un nouveau champ dans la théorie signifie qu’une particule associée à ce champ doit aussi exister.
La plupart des propriétés de cette particule sont décrites dans la théorie. Par conséquent, la découverte d’une particule correspondant à cette description constitue un indice probant susceptible de valider le mécanisme de Brout-Englert-Higgs. Dans le cas contraire, nous n’aurions aucun moyen confirmer l’existence du champ de Higgs.
Vous l’aurez deviné, cette particule, c’est le boson de Higgs ! Sa découverte en 2012 a permis de valider le mécanisme de Brout-Englert-Higgs et le champ de Higgs, offrant ainsi aux chercheurs la possibilité de poursuivre leur exploration de la matière.
Il est crucial d’étudier en détail les propriétés du boson de Higgs pour pouvoir tenter d’élucider les nombreuses énigmes de la physique des particules et de la cosmologie, qui vont de la grande disparité des masses des particules élémentaires au destin ultime de l’Univers.
DOCUMENT c e r n LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LES LASERS DE RECHERCHE |
|
|
| |
|
| |

LES LASERS DE RECHERCHE
Ultrapuissants et ultrarapides, les lasers sont utilisés par les chercheurs pour étudier la physique à très haute densité d'énergie ou pour étudier les phénomènes de physique à très haute intensité.
Publié le 30 juin 2015
Grâce à ses propriétés uniques, le laser peut concentrer des énergies (relativement) importantes à la fois dans l’espace (focalisation) et dans le temps (impulsions brèves) pour atteindre des intensités gigantesques, capables de changer l’état de la matière, et en dévoiler les secrets. Afin d’utiliser des lasers spécifiques à leurs recherches, les chercheurs jouent sur ces deux critères principaux : la brièveté des impulsions laser, jusqu’à la femtoseconde (10-15 s), pour étudier les phénomènes de physique à très haute intensité, et l’énergie des faisceaux pour la physique à très haute densité d’énergie (plasmas, fusion nucléaire…).
DES LASERS POUR LA FUSION
Pionnier dans ce domaine, le CEA a conçu et assemblé, sur le centre du Cesta à proximité de Bordeaux, le laser Mégajoule (LMJ) précédé par la Ligne d’intégration laser (LIL), pour étudier la fusion par confinement inertiel.
La Ligne d’intégration laser, un prototype
Le laser Mégajoule délivrera une énergie lumineuse pouvant atteindre 1,8 million de joules.
La Ligne d’intégration laser avait une longueur de 150 m, une largeur de 70 m et une hauteur de 23 m.
Prototype de quatre faisceaux laser du laser Mégajoule, la LIL a été développée et mise au point pour en valider les choix technologiques et physiques (optiques). Depuis sa mise en fonctionnement en 2002 et jusqu’à son arrêt en 2014, la LIL a permis d’optimiser l’ensemble de la chaîne laser en vue de son utilisation au sein du LMJ. La méthode d’alignement, le lissage des faisceaux de lumière ou encore la fiabilité des composants ont été évalués et améliorés en vue d’une utilisation, à coût minimal, dans la future installation. Les premiers diagnostics pour le contrôle des futurs faisceaux et ceux du dispositif de mesures pour les expériences de physique y ont été mis au point. Au départ prototype, la LIL est devenue, de par ses caractéristiques, un grand instrument de physique pour la recherche ; elle a été utilisée pour mener des expériences préfigurant celles qui seront réalisées avec le LMJ.
Caractéristiques de la ligne d'intégration laser LIL
Mode de fonctionnement impulsionnel
Durée de l'impulsion 1 nanoseconde (10-9 seconde)
Energie laser de sortie 30 000 joules
Puissance 15-60 térawatts (TW)
Milieux laser Milieux laser : verre dopé au néodyme
Longueur d'onde fondamentale infrarouge
Longueur d'onde de sortie ultraviolet
Le laser Mégajoule
Le laser Mégajoule (LMJ) est une installation majeure du programme Simulation de la Direction des applications militaires du CEA. Cette installation exceptionnelle, dimensionnée pour accueillir jusqu’à 240 faisceaux, sert à étudier, à toute petite échelle, les conditions extrêmes atteintes par les matériaux lors du fonctionnement des armes nucléaires.
Son utilisation doit permettre en particulier :
* de valider les modèles fondamentaux (équations de physique) décrivant la physique du fonctionnement des armes nucléaires, et de vérifier que la modélisation prend en compte tous les phénomènes ;
*
* de réaliser des expériences mettant en jeu l’enchaînement et l’imbrication de ces modèles. Ces expériences sont essentielles pour démontrer la maîtrise des chaînes de logiciels reproduisant par le calcul le fonctionnement des armes. La validation de la simulation repose sur de nombreuses catégories d’expériences ; les plus complexes conduisent à la combustion d’une microcible contenant un mélange deutérium-tritium porté à 70 millions de degrés (l’ignition).
Le laser Mégajoule délivrera une énergie lumineuse pouvant atteindre 1,8 million de joules. Pour amener l’énergie jusqu’à la cible, une impulsion laser de très faible énergie est amplifiée progressivement, sur une très grande distance (450 m). La chaîne laser se déploiera sur 300 m de longueur, 160 m de largeur, dans quatre halls de 128 m de longueur et 14 m de hauteur.
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Matériaux critiques : un enjeu de souveraineté |
|
|
| |
|
| |
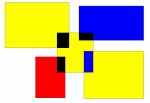
Matériaux critiques : un enjeu de souveraineté
Sans matières premières, pas de transition énergétique ni numérique. Or, la disponibilité de la plupart de ces métaux est soumise à de nombreux aléas. Un sujet éminemment stratégique où il est question de souveraineté économique, technologique, industrielle et environnementale. Luc Aixala, chef du programme Procédés de fabrication, recyclage et analyse du cycle de vie à la Direction des énergies du CEA et Guillaume Pitron, journaliste, reporter et réalisateur, font le point.
PUBLIÉ LE 17 JUIN 2021
Qu’entend-on par matériaux critiques ?
Guillaume Pitron : Un métal est considéré comme critique lorsque sa production est faible par rapport aux métaux abondants, et surtout lorsqu’elle est concentrée dans quelques pays producteurs. Par exemple, le Brésil produit plus de 90 % du niobium, les États-Unis plus de 90 % du béryllium, la Chine plus de 90 % de certaines terres rares. Si bien que l’Europe fait face à un risque de pénurie d’approvisionnement de certains métaux déterminants dans la transition énergétique.
Cette situation est identifiée depuis 2011 par la Commission européenne qui dresse tous les trois ans une liste de ces métaux critiques. En France, ils sont nommés métaux stratégiques par le comité du même nom parce qu’ils sont au cœur des filières industrielles d’un pays qui n’en maîtrise pas l’extraction.
Luc Aixala : La question de l’approvisionnement est cruciale car nous assistons à une explosion du marché des batteries, panneaux photovoltaïques (PV) et moteurs électriques. Les batteries des véhicules électriques contiennent par exemple du lithium, du cobalt et du nickel. Si le premier est relativement disponible, les deux autres le sont moins et sont onéreux (entre 20 et 70 € le kg). Or, des experts estiment que la demande de ces matériaux sera multipliée par six d’ici 2030 par rapport à 2010, ce qui reviendra à produire 150 000 tonnes par an de cobalt contre 25 000 tonnes. Les industriels européens commencent à évoquer leur difficulté d’approvisionnement, car le secteur est dominé par l’Asie. L’Europe cherche à retrouver sa souveraineté dans la fabrication des batteries en relocalisant leur fabrication dans des gigafactories. Il y a deux projets en France, ceux des entreprises ACC et Verkor, qui visent entre 500 000 et un million de batteries par an. Mais cela représente plusieurs milliards d’euros d’investissement.
En quoi le sujet des matériaux critiques est-il lié à celui de la souveraineté ?
Guillaume Pitron : On constate que la Chine a pensé sa souveraineté minérale au regard de sa souveraineté technologique, avec une vision à long terme. Elle contrôle ses ressources pour capitaliser sur toute la chaîne de valeurs en extrayant, développant et fabriquant batteries, aimants permanents, panneaux PV, etc. Un boulanger ne peut faire un bon pain s’il n’a pas de farine ! Et la Chine l’a bien compris, de la mine au laboratoire.
Luc Aixala : Les entreprises ont conscience de cette problématique, mais demeure le problème de la compétitivité. Par exemple, fabriquer les aimants des moteurs électriques et des éoliennes en mer coûte deux fois plus cher en Europe qu’en Chine. Nous devons faire face à une réalité industrielle difficile. La France et l’Europe s’emparent ainsi du sujet : le plan France Relance accorde 450 millions d’euros aux projets Résilience, dont une partie pour les matériaux critiques et l’alliance européenne des matériaux stratégiques regroupe 500 partenaires industriels pour réfléchir à des projets et plateformes pilotes dans le cadre du programme Horizon Europe.
Guillaume Pitron : Se pose aussi la question des souverainetés environnementale et sociale. Fabriquer une batterie ou un aimant dans un pays où l’on ne maîtrise pas le mix énergétique (par exemple dominé par le charbon et le pétrole), ni les conditions d’extraction du minerai (polluantes voire socialement déplorables), revient à perdre une partie de notre souveraineté en la matière.
Luc Aixala : L’analyse du cycle de vie (ACV) des produits, qui consiste en l’étude technico-économique et l’impact environnemental de l’ensemble des étapes de leur fabrication, est en effet un outil très important. L’utiliser dans les programmes Energie du CEA pour nos partenaires industriels permet de mieux concevoir les systèmes bas carbone, voire de générer parfois de réelles symbioses industrielles. Mais, dans les faits, l’ACV ne peut être le seul décideur car, à un moment donné, l’industriel doit pouvoir vendre ses produits. C’est important de le dire, tout comme il faut nuancer le discours du « on va tout recycler ».
Quelle solution d’avenir pour garantir la disponibilité de ces métaux critiques, si l’on ne peut pas tout miser sur le recyclage ?
Guillaume Pitron : Il est en effet candide de tout miser sur le recyclage. Car entre le moment où un produit rentre sur le marché et le moment où il en sort, il peut se passer dix ans. Or, sa consommation augmentant de 10 % par an, au bout de dix ans il aura fallu en produire encore plus. Et vous vous retrouvez toujours avec des mines à ouvrir. L’avenir sera un mix de matières primaires (extraites) et secondaires (recyclées).
Luc Aixala : En Europe, les réglementations actuelles, et celles se profilant, sont à la hauteur des enjeux environnementaux. Mais le problème est en partie ailleurs. La Direction générale des entreprises a pris les choses en main concernant les aimants permanents. Elle mène depuis plus d’un an des groupes de travail avec les acteurs du secteur qui ont fait émerger plusieurs projets structurants soutenus par France Relance. Mais, force est de constater que des sujets ont été désindustrialisés et qu’il y a des « trous » dans la chaîne de valeur. Il y avait notamment en France le recyclage des terres rares, mais l’usine de Solvay a fermé fin 2016, faute de rentabilité.
Autre exemple : demain, 100 % des batteries de la mobilité électrique devront être recyclées, il y a donc un marché conséquent. Mais bien que l’Europe ait de grandes capacités technologiques et industrielles en recyclage, elles sont sans commune mesure avec celles de la Chine : 160 000 tonnes par an pour plusieurs usines en cours de construction, quand nos acteurs, comme la SNAM en France, en recyclent 10 à 20 000 tonnes par an. De plus, cela peut vraiment coûter moins cher demain d’envoyer par containers des batteries usées et de les recycler en Chine. Mais cela serait dramatique, tant au niveau économique qu’environnemental. Ne va-t-il pas falloir à un moment aider ces industries stratégiques ?
Comment valoriser les matériaux recyclés par rapport à ceux extraits de la mine ?
Guillaume Pitron : Il y a déjà une question de prix des matières premières : si on intégrait dans le coût du néodyme ou de l’indium, celui de la construction de l’hôpital pour soigner les cancers induits par les méthodes d’extraction, et celui de la dépollution de tous les sols, il est certain que ce coût serait bien plus important. Mais les Chinois ne le feront pas, à moins que cela devienne socialement et politiquement intenable. Ce qui n’est pas encore le cas. On pourrait attendre longtemps avant d’être compétitif par les seules règles du marché, et que la matière secondaire soit aussi compétitive que la matière primaire. D’autant plus que les industriels sont soumis aux cycles très changeants des cours des matières premières, avec les difficultés de visibilité et de projections que cela induit pour la filière du recyclage. Nous avons besoin que la puissance publique crée artificiellement de la compétitivité.
Je crois beaucoup en la relocalisation de nos moyens d’extraction, avec la réouverture de mines en Europe et France. Car la production de ces matériaux dans des conditions environnementales et socialement acceptables est aussi un enjeu éthique. Si on veut une transition écologique et solidaire, du nom du ministère qui en a la charge, il faut qu’à un moment donné on prenne notre part de ce « fardeau » et qu’on ne compte plus sur un autre pour faire la « sale besogne ». Car dans nos systèmes énergétiques, y compris fossiles, tout commence par une cicatrice dans le sol.
Guillaume Pitron est l’auteur de l’ouvrage « La guerre des métaux rares ». Celui-ci a été adapté en BD, intitulée « Promethium » et parue le 22 avril 2021.
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
