|
| |
|
|
 |
|
LA MICROCIRCULATION CÃRÃBRALE (2000) |
|
|
| |
|
| |

LA MICROCIRCULATION CÉRÉBRALE (2000)
Réalisation : 3 janvier 2000 - Mise en ligne : 3 octobre 2007
* document 1 document 2 document 3
* niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Le laboratoire de Recherches cérébrovasculaires du CNRS a développé une méthode originale de visualisation de la circulation sanguine du cerveau qui utilise un microscope de fluorescence à effet confocal et à balayage laser. L'objet de ce film est de montrer les images de microcinéma obtenues par ce procédé sur un cerveau de rat en conditions physiologiques et lors d'une pathologie fréquente, l'ischémie. L'injection de fluorescéine dans le plasma permet de visualiser les micro-vaisseaux. Dans un deuxième temps, l'injection de globules rouges préalablements rendus fluorecents permet d'observer le flux sanguin dans les anastomoses fonctionelles entre deux vaisseaux du même type. La microscopie confocale rend ce type d'exploration possible jusqu'à 200 microns dans le tissu cérébral. Les conséquences microcirculatoires d'une ischémie cérébrale globale transitoire (c'est à dire d'un arrêt de la circulation dans l'ensemble de l'encéphale) et de la reperfusion consécutive sont visualisées. Deux durées d'ischémie sont présentées : vingt secondes et quinze minutes, mettant en évidence des différences de réactivité vasculaire et circulatoire. Cette méthode permet donc, lors de la simulation de différents types d'accidents cérébrovasculaires ou lors d'une activation physiologique, de visualiser de façon dynamique la microcirculation dans les couches superficielles du cerveau.
GénériqueAuteurs : Elisabeth Pinard, Jacques Seylaz Réalisation : Jean-François Ternay Producteurs : Laboratoire de Recherches Cérébrovasculaires - CNRS / CNRS Images/Media Diffuseur : CNRS Diffusion
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Iode et Thyroïde |
|
|
| |
|
| |
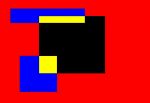
Iode et Thyroïde
Qu'est ce que la thyroïde ? A quoi sert-elle ? Qu'est-ce que l'iode ? Quel est son rôle ? A quoi sert l'iode radioactif en médecine ? Découvrez dans ce chapitre les réponses à ces questions.
Publié le 3 octobre 2012
"Qu'est-ce que la thyroïde ? A quoi sert-elle ?"
La thyroïde est une petite glande située à la base du cou, en avant de la trachée et en dessous du larynx. Elle est formée de deux lobes réunis par une partie étroite, resserrée, qu'on appelle isthme.
La thyroïde permet de synthétiser les hormones thyroïdiennes qui interviennent dans la régulation du métabolisme (fonction de toutes les cellules et des organes).
Chez l'enfant, ces hormones jouent un rôle fondamental sur la croissance et le développement, en particulier au niveau du système nerveux central.
L'iode étant un élément opaque aux rayons X, il présente un intérêt particulier en médecine pour le diagnostic médical.
L'iode 123 est notamment utilisé comme traceur pour des scintigraphies. © L.Medard/CEA
La distribution d'iode est organisée à proximité des centrales nucléaires afin de saturer la glande thyroïde en iode stable, en cas de risque de dispersion d'isotopes radioactifs de l'iode. © C.Dupont/CEA
"Qu'est-ce que l'iode ? Quel est son rôle ?"
L'iode est un oligo-élément essentiel pour l'organisme humain car il intervient dans le fonctionnement de la thyroïde, plus précisément, dans la fabrication des hormones thyroïdiennes.
De fait, une carence en iode peut entraîner des troubles plus ou moins graves du métabolisme. Les troubles sont d'autant plus importants que la carence est profonde et durable.
"A quoi sert l'iode ?"
L'iode étant un élément opaque aux rayons X, il présente un intérêt particulier en médecine pour le diagnostic médical : l'iode stable est inclus dans des molécules servant de produits de contraste. L'iode stable entre également dans la composition de certains médicaments, notamment pour la prévention de tachycardies (amiodarone®).
A l'état d'ion iodure, l'iode se concentre sélectivement, c'est-à-dire par affinité naturelle, dans les cellules de la thyroïde. C'est cette propriété de fixation dans les cellules thyroïdiennes normales, ou pathologiques, qui est mise à profit avec les isotopes radioactifs de l'iode, pour le traitement d'états pathologiques de la thyroïde (ex. hyperthyroïdie, cancers de la thyroïde, métastases de cancers de la thyroïde).
"A quoi sert l'iode radioactif en médecine ?"
Trois isotopes radioactifs de l'iode sont tout particulièrement utilisés en médecine : l'iode 131, l'iode 123 et l'iode 125.
* L'iode 131 est utilisé principalement en thérapie du cancer de la thyroïde. Il permet notamment de détruire les cellules thyroïdiennes restantes après ablation de la thyroïde s'il existe un risque de rechute , ou pour le traitement de métastases. Par ailleurs, dans le cas d'hyperthyroïdie résistant à un blocage médicamenteux, un traitement à l'iode 131 permet de détruire spécifiquement les cellules thyroïdiennes.
* L'iode 123 est réservé au diagnostic, il permet de faire des explorations fonctionnelles et morphologiques de la thyroïde.
* Enfin, l'iode 125 est utilisé en radio-immuno analyse, pour le diagnostic et la thérapie.
"Pourquoi distribue-t-on des comprimés d'iode aux personnes vivant près d'installations nucléaires ?"
Seul un accident très grave pourrait entraîner le rejet massif de poussières radioactives dans l'atmosphère. Du fait de la conception des sites nucléaires en France, ces rejets gazeux ne s'échapperaient dans l'environnement que passé un délai de quelques heures après la défaillance de l'installation.
Plusieurs corps radioactifs pourraient être libérés dans l'environnement dont l'iode 131* qui viendrait se fixer sur la thyroïde. Si un tel accident survenait en France, le préfet demanderait à la population environnante de prendre un comprimé d'iode stable (non radioactif) le plus tôt possible, afin que cet iode, en se fixant immédiatement dans la thyroïde, sature celle-ci et empêche la fixation ultérieure de l'iode radioactif inhalé.
La prise de 100 mg d'iodure juste avant l'exposition (pour une personne non carencée en iode) permet d'éviter 95% ou plus de la dose à la thyroïde, 90% si la prise est concomitante à l'incorporation, mais environ 50% si elle est réalisée 6 heures après. Si l'exposition aux iodes radioactifs se prolonge, la répétition de la prise d'iodure peut s'avérer nécessaire pour maintenir un blocage de la thyroïde suffisant. Ce sont les autorités compétentes qui décident de la prise d'iode unique ou répétée.
Pour les personnes les plus sensibles (jeunes de moins de 20 ans, femmes enceintes ou qui allaitent) des mesures spécifiques complémentaires peuvent être prises. Le traitement consiste en la prise unique d'un comprimé de 130 mg d'iodure de potassium, éventuellement renouvelée les jours suivants :
* adultes (y compris les femmes enceintes) et enfants de plus de 12 ans : un comprimé à dissoudre dans un verre (eau, jus de fruit),
* enfants de 3 à 12 ans : un demi comprimé,
* enfants de 0 à 3 ans : un quart de comprimé.
*
Les comprimés d'iode stable ont un statut de médicament depuis 1997. Leur durée de conservation est de 5 ans. La distribution est essentiellement effectuée par l'intermédiaire des officines de pharmacie.
* La radioactivité de l'iode 131 diminue de moitié tous les 8 jours.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
La pollution atmosphérique accélère le vieillissement oculaire |
|
|
| |
|
| |

La pollution atmosphérique accélère le vieillissement oculaire
18 Juil 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Santé publique
De nombreuses études font désormais état des effets néfastes de la pollution atmosphérique sur le système nerveux central (maladies neurodégénératives chez l’adulte, troubles neurodéveloppementaux chez l’enfant). Le glaucome, deuxième cause de cécité dans le monde, est une maladie neurodégénérative du nerf optique, dont la principale caractéristique est un amincissement de la couche des fibres nerveuses de la rétine. Dans une étude portant sur une cohorte composée de 683 personnes âgées bordelaises, dont le suivi a duré dix ans, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm et de l’université de Bordeaux, au centre de recherche Bordeaux Population Health, ont mis en évidence un amincissement accéléré de la couche des fibres nerveuses de la rétine chez les personnes plus exposées à la pollution atmosphérique, notamment celles qui avaient une plus grande exposition aux particules fines (particules d’un diamètre inférieur à 2,5 microns = PM2,5). Cette étude suggère donc une possible augmentation du risque de glaucome pour les habitants des zones polluées aux particules fines, et ce même à des niveaux inférieurs aux seuils réglementaires actuels de l’Union européenne (25 microgrammes/mètre cube). Les résultats sont publiés dans la revue Environmental Research.
La pollution atmosphérique constitue un enjeu de santé publique mondial. Les effets nocifs des polluants atmosphériques sur les fonctions respiratoires et cardiovasculaires ont été largement documentés dans la littérature scientifique. Il est aussi de plus en plus évident que l’exposition chronique à la pollution atmosphérique a des effets néfastes sur le système nerveux central avec notamment une augmentation du risque de maladies neurodégénératives chez l’adulte et de troubles neurodéveloppementaux chez l’enfant.
La couche des fibres nerveuses de la rétine (RNFL) fait partie du système nerveux central, et son amincissement représente la principale caractéristique du glaucome[1], une maladie de l’œil associée à la destruction progressive du nerf optique, le plus souvent causée par une pression trop importante à l’intérieur de l’œil. Cette pathologie constitue la seconde cause de cécité dans les pays développés.
Des chercheurs et chercheuses de l’Inserm et de l’université de Bordeaux ont étudié l’effet d’une exposition a des concentrations plus élevées de polluants de l’air (particules fines[1] et dioxyde d’azote) sur les processus neurodégénératifs au niveau oculaire. Ils ont pour cela suivi pendant dix ans une population bordelaise de 683 personnes âgées de plus de 75 ans au moment de leur inclusion dans la cohorte Aliénor[2]. Il s’agit de la première étude prospective réalisée sur ce sujet.
Dans le cadre de cette étude, les personnes ont bénéficié d’examens oculaires tous les deux ans entre 2009 et 2020, afin de mesurer l’évolution de l’épaisseur de la couche des fibres nerveuses de leur rétine.
Par ailleurs, leur exposition à la pollution atmosphérique au cours des 10 années précédentes a été déterminée à partir de l’adresse de leur domicile, à l’aide de cartographies d’exposition annuelle pour chaque polluant. Ces cartographies détaillées, ayant une résolution de 100 mètres, ont été réalisées à partir des mesures de stations de contrôle de qualité de l’air et de caractéristiques météorologiques et géographiques (proximité d’une route, densité de population, distance de la mer, altitude…)[4].
Selon les résultats de cette étude, les personnes ayant été exposées à des concentrations plus élevées de particules fines avaient au cours du temps un affinement plus rapide de la couche nerveuse rétinienne.
Ces résultats sont représentés sur la figure ci-dessus sur laquelle on peut voir que les participants exposés à une concentration de 25µg/m3 aux particules fines PM2,5 avaient une diminution plus rapide de l’épaisseur de cette couche en comparaison a ceux exposés à 20 µg/m3.
Ces résultats suggèrent que l’exposition à une forte concentration de polluants au cours du temps pourrait augmenter le risque de glaucome.
En ce qui concerne les particules fines PM2,5, les estimations de l’exposition moyenne sur 10 ans étaient inférieures au seuil annuel réglementaire de l’Union européenne (établi à un maximum de 25 μg/m3) pour tous les participants, mais supérieures aux valeurs limites recommandées par l’OMS en 2005 (10 μg/m3) encore abaissées en 2021 (5 μg/m3).
« Les résultats de cette étude confirment les observations précédentes sur les effets de la pollution atmosphérique sur les processus neurodégénératifs, ici au niveau oculaire. Ils constituent un argument supplémentaire en faveur de la baisse des seuils réglementaires européens[5], comme recommandé par l’OMS, ainsi que de la diminution de l’exposition effective de la population française, qui continue de dépasser par endroit les seuils réglementaires actuels », explique Laure Gayraud, doctorante en épidémiologie et première autrice de l’étude.
« De façon plus générale, notre étude documente les effets des polluants atmosphériques sur le vieillissement neurologique. En prenant l’exemple du vieillissement oculaire, elle suggère qu’une exposition à des concentrations élevées de polluants au cours du temps pourrait mener à une accélération du vieillissement neurologique, comme cela a été observé dans des études sur le vieillissement cérébral », explique Cécile Delcourt, directrice de recherche à l’Inserm, dernière autrice de ces travaux.
L’objectif est désormais pour les scientifiques d’élargir le terrain d’étude à l’échelle nationale, grâce à des données issues d’autres cohortes françaises, afin d’approfondir les connaissances sur les effets des polluants sur le vieillissement oculaire.
[1]Pour aller plus loin, consultez le dossier sur le glaucome.
[2]Les particules fines correspondent aux PM2,5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns.
[3]L’étude Alienor est une étude épidémiologique en population générale âgée qui explore les relations entre les maladies oculaires liées à l’âge et autres déterminants majeurs de ces maladies (facteurs génétiques, nutritionnels, environnementaux ou vasculaires).
[4]Ces cartographies ont été précédemment réalisées par l’équipe de Kees de Hoogh et Danielle Vienneau du Swiss Tropical and Public Health Institute (co-auteurs de la publication).
[5]Les députés de la commission de l’environnement au sein du Parlement européen ont récemment voté en faveur de l’abaissement des seuils de plusieurs polluants à l’horizon 2030, dont les particules fines.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Selon le sexe et lââge, les cellules immunitaires du cerveau réagissent différemment à des perturbations du microbiote |
|
|
| |
|
| |

Selon le sexe et l’âge, les cellules immunitaires du cerveau réagissent différemment à des perturbations du microbiote
21 Déc 2017 | Par Inserm (Salle de presse) | Biologie cellulaire, développement et évolution
Une étude conjointe entre des chercheurs Inserm de l’IBENS (Institut de biologie de l’Ecole Normale Supérieure – Inserm/CNRS/ENS Paris) à Paris et des chercheurs du SIgN (Singapore Immunology Network, A*STAR) de Singapour montre un rôle inédit du microbiote sur des cellules immunitaires du cerveau dès le stade fœtal. Ces cellules immunitaires, les microglies, jouent un rôle clé dans le développement et le fonctionnement cérébral et sont différemment perturbées par des modifications du microbiote chez les souris mâles et femelles à différents stades de la vie. Les résultats de ces travaux sont publiés dans la revue Cell.
Les microglies sont des cellules immunitaires qui répondent à des traumatismes ou des signaux inflammatoires pour protéger le cerveau, agissant comme des senseurs capables de détecter de nombreux signaux environnementaux. Ces cellules immunitaires sont également impliquées dans différentes étapes du développement et du fonctionnement cérébral. Ainsi, des dysfonctionnements de ces cellules sont associés à un large spectre de pathologies humaines, allant des troubles neuro-développementaux jusqu’aux maladies neurodégénératives. Les microglies jouent donc un rôle crucial dans le fonctionnement normal et pathologique du cerveau, ce qui laisse suggérer qu’elles constituent une interface régulatrice entre les circuits cérébraux et l’environnement.
Pour tester cette hypothèse, Morgane Thion et Sonia Garel, chercheuses Inserm, et leurs collaborateurs, ont utilisé une approche multidisciplinaire sur des modèles de souris axéniques, qui n’ont pas de microbiote (ensemble des bactéries présentes dans l’organisme) et des modèles de souris adultes traitées avec un cocktail d’antibiotiques (qui détruisent de façon aigue le microbiote). En combinant analyses génomiques globales et études histologiques, les chercheurs ont montré que les microglies sont profondément affectées par un dysfonctionnement du microbiote, dès les stades prénataux et ce, en fonction du sexe de l’animal : les microglies appartenant à des mâles semblent affectées au stade prénatal alors que les microglies issues de femelles le sont à l’âge adulte. Ce surprenant dimorphisme sexuel fait écho au fait que l’occurrence de nombreuses pathologies neurodéveloppementales est plus élevée chez les hommes alors que les maladies auto-immunes sont plutôt prévalentes chez les femmes.
Si les mécanismes impliqués et les conséquences fonctionnelles restent à découvrir, cette étude révèle un rôle clé des microglies à l’interface entre environnement et cerveau et montre que les mâles et femelles auraient des susceptibilités différentes à des altérations du microbiote. Pour les auteurs, ces éléments mériteraient maintenant d’être pris en considération au niveau clinique et ce, dès les stades fœtaux.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
