|
| |
|
|
 |
|
Comment les cellules souches du sang détectent un pathogène et orientent la réponse immunitaire |
|
|
| |
|
| |

Comment les cellules souches du sang détectent un pathogène et orientent la réponse immunitaire
20 Juin 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie

Le bon fonctionnement du système immunitaire dépend de l’approvisionnement constant en globules blancs issus des cellules souches qui résident dans la moelle osseuse : les cellules souches du sang – ou cellules souches hématopoïétiques. Des chercheuses et chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille, au sein du Centre d’immunologie de Marseille-Luminy, ont désormais découvert un rôle nouveau joué par ces cellules souches du sang dans la réponse immunitaire. Dans leur article publié dans le Journal of Experimental Medicine, ils décrivent comment elles parviennent à reconnaître et à interagir directement avec une bactérie appelée Brucella dans la moelle osseuse, grâce à un récepteur présent à leur surface. Il s’agit de la première démonstration de la reconnaissance directe d’un pathogène vivant par les cellules souches du sang, ce qui atteste de leur contribution très précoce à la réponse immunitaire.
Les cellules souches du sang ou cellules souches hématopoïétiques sont des cellules souches qui résident dans la moelle osseuse. Elles se multiplient et donnent naissance à toutes les cellules du sang, c’est-à-dire les globules rouges qui transportent l’oxygène et les globules blancs qui participent à la réponse immunitaire.
Jusqu’à présent, en ce qui concerne la réponse immunitaire, les cellules souches du sang n’étaient uniquement vues que comme les cellules à l’origine des globules blancs. Cependant, un ensemble croissant de preuves indiquent qu’elles peuvent également contribuer directement et activement à la réponse immunitaire : des données récentes ont par exemple montré qu’elles peuvent détecter directement les cytokines, protéines libérées lors d’une infection ou d’une inflammation.
Dans une nouvelle publication, une équipe de recherche de l’Inserm, du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille, placée sous la direction de Michael Sieweke, ainsi que de Jean-Pierre Gorvel[1], a souhaité approfondir les connaissances scientifiques à ce sujet. Les chercheurs ont réussi à décrire les mécanismes à l’œuvre au cours de la rencontre entre la cellule souche du sang et un agent pathogène précis : la bactérie Brucella qui est un microorganisme à déclaration obligatoire (MOT)[2].
Brucella est responsable d’une maladie infectieuse appelée brucellose (ou fièvre de Malte ou encore fièvre méditerranéenne), l’une des zoonoses les plus répandues qui représente une menace importante pour la santé humaine dans le monde entier[3]. Brucella est un pathogène intrigant et très intéressant à étudier pour les scientifiques en raison de sa capacité à établir des infections persistantes et chroniques et à échapper aux réponses immunitaires de l’hôte[4].
Les scientifiques ont découvert que les cellules souches du sang présentes dans la moelle osseuse étaient en mesure de détecter Brucella. Leurs observations indiquent qu’un récepteur spécifique à la surface des cellules souches du sang, connu sous le nom de CD150, interagit avec une protéine appelée Omp25 présente à la surface de Brucella.

Résumé graphique de la découverte. Grâce au récepteur CD150 à leur surface, les cellules souches du sang dans la moelle osseuse peuvent détecter la bactérie Brucella. Après avoir reconnu la bactérie, les cellules souches du sang commencent à produire davantage de globules blancs. © CIML
« Notre étude dévoile les mécanismes par lesquels ces cellules du sang parviennent à détecter les bactéries via un récepteur spécial. On peut considérer ceci comme une poignée de main directe entre la cellule souche et la bactérie. Jamais personne n’avait imaginé que la cellule souche du sang pouvait reconnaître une bactérie vivante », explique Sandrine Sarrazin, chercheuse Inserm, co-dernière autrice de l’étude.
Les scientifiques ont ensuite montré que cette « poignée de main » entraîne une réponse rapide des cellules souches du sang, qui commencent alors à produire plus de globules blancs. Il s’agit ici de la première démonstration d’une reconnaissance directe d’un pathogène vivant par les cellules souches du sang et atteste d’une contribution très précoce et inattendue de ces cellules à la réponse immunitaire.
Comment Brucella utilise les cellules souches pour « pirater » le système immunitaire
Dans la lignée de ces travaux, les scientifiques se sont demandé si ce mécanisme était plutôt bénéfique à l’hôte ou à la bactérie.
Grâce à des observations méticuleuses, les chercheurs ont découvert que Brucella ordonne à ces cellules souches de produire les globules blancs qu’elle privilégie pour l’infection. La bactérie parvient à envahir les globules blancs produits par les cellules souches du sang et à les utiliser pour se multiplier et s’installer dans l’organisme. Dans ce cas particulier, les cellules souches contribuent donc à la propagation de la bactérie.
« Cette recherche apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes sophistiqués que les agents pathogènes emploient pour échapper aux défenses du système immunitaire. Alors que la production accrue de globules blancs serait bénéfique s’ils pouvaient combattre efficacement l’infection, Brucella parvient à les exploiter pour se multiplier », explique Jean-Pierre Gorvel, co-dernier auteur de l’étude.
« Ce mécanisme peut être considéré comme une stratégie d’évasion exploitée par la bactérie pour faire progresser l’infection », résume Michael Sieweke, également co-dernier auteur de l’étude.
La publication de cette étude marque une étape importante dans la compréhension de la danse complexe entre Brucella et les cellules souches hématopoïétiques. Elle fournit non seulement des informations cruciales sur la pathogenèse de la brucellose, mais ouvre également de nouvelles voies pour le développement d’interventions thérapeutiques ciblées.
« En plus d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement de la réponse immunitaire, notre étude permet d’envisager à terme l’élaboration d’une thérapie ciblée capable d’empêcher les interactions entre Brucella et la cellule souche du sang, empêchant la propagation de la bactérie dans l’organisme, et aidant les patients atteints par la maladie de brucellose », conclut Jean-Pierre Gorvel.
[1] Ce travail est le fruit d’une collaboration entre deux équipes de recherche au Centre d’immunologie de Marseille-Luminy (CIML, CNRS/Inserm/Aix-Marseille Université) : l’équipe Biologie de la cellule souche et du macrophage de Michael Sieweke et l’équipe Immunologie et biologie des interactions hôte pathogène de Jean-Pierre Gorvel.
[2] L’expérimentation avec Brucella a été ainsi réalisée au Centre d’immunophénomique (CIPHE) en confinement de niveau 3.
[3] L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a identifié la brucellose comme l’une des sept zoonoses les plus négligées, contribuant à la pauvreté, entravant le développement et causant des pertes économiques substantielles dans les pays en développement.
[4] De précédentes études réalisées au sein du laboratoire de Jean-Pierre Gorvel avaient permis des découvertes cruciales dans le but d’élucider les mécanismes sous-jacents à ces phénomènes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les crises dâépilepsie dépendraient de lâhorloge biologique |
|
|
| |
|
| |

Les crises d’épilepsie dépendraient de l’horloge biologique
* PUBLIÉ LE : 05/11/2020 TEMPS DE LECTURE : 3 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE
*
Une étude internationale menée chez l’animal montre que l’hippocampe est caractérisé par d’importantes oscillations moléculaires au cours de la journée. Or cette structure cérébrale, qui joue un rôle important dans la mémorisation, est aussi impliquée dans la survenue des crises de la forme la plus fréquente d’épilepsie.
Les crises d’épilepsie peuvent survenir à des heures très variables de la journée mais, chez un même individu, elles se manifestent le plus souvent à des moments privilégiés. Cette rythmicité individuelle interroge : l’excitabilité de leurs neurones, prérequis à la crise, pourrait-elle dépendre de leur horloge biologique ? Pour le savoir un projet international associant des laboratoires français, américains, allemands et polonais s’est penché sur l’expression des gènes au niveau de l’hippocampe. Cette structure cérébrale est particulièrement impliquée dans la naissance des crises qui caractérisent l’épilepsie du lobe temporal, la forme d’épilepsie la plus courante chez l’adulte.
Réalisée chez la souris, cette étude a révélé que l’expression locale de plus de 1 200 gènes (évalués par quantification de leurs ARN ou « transcrits ») dépend d’un rythme circadien. Lorsque l’analyse est conduite chez des souris épileptiques, le nombre de gènes concernés par la rythmicité circadienne augmente de 30%, et seuls un tiers de ces transcrits sont communs à ceux présents chez les animaux sains. Ainsi, la nature, le rythme et l’amplitude des variations de l’expression génique au cours de la journée apparaissent très spécifiques de l’épilepsie. Si la même observation était posée chez l’humain, elle aiderait à mieux comprendre la maladie et prévenir les crises aux moments les plus à risque de la journée.
Christophe Bernard*, qui a encadré ce travail, explique : « L’‘architecture’ moléculaire qui régit le fonctionnement des neurones de l’hippocampe présente des différences fondamentales entre animaux contrôles et animaux épileptiques. Ces différences pourraient être à l’origine des crises : en injectant un médicament épileptogène à ces deux groupes d’animaux, on observe non seulement que le seuil de déclenchement de la crise est plus bas chez les animaux épileptiques, mais aussi que ce déclenchement survient à des moments différents de la journée que chez les animaux contrôles. »
Un pas vers la chronopharmacologie
« Les mécanismes de mémorisation qui siègent dans l’hippocampe suivent un rythme circadien. Il était donc légitime de rechercher une rythmicité de l’architecture moléculaire locale associée à l’épilepsie, poursuit le chercheur, Nos travaux montrent que les variations moléculaires au niveau de cette structure cérébrale sont à la fois très nombreuses, très importantes et très spécifiques de la situation, physiologique ou pathologique. Nous allons maintenant entrer dans le détail : nos prochains travaux visent à identifier quels sont les gènes et protéines clés dont l’oscillation est associée aux moments de vulnérabilité vis-à-vis des crises d’épilepsie. » Ces recherches pourraient ensuite être transposées chez l’Homme.
Mais les perspectives de ce travail sont plus larges, précise Christophe Bernard : « On peut supposer que d’autres pathologies cérébrales, comme la maladie d’Alzheimer ou la sclérose en plaques, sont également liées à des oscillations de l’expression de gènes qui leur soient spécifiques. » Étudier ces maladies à la lumière d’une rythmicité circadienne pourrait aider à mieux les comprendre, et sans doute mieux les traiter. « Dans l’épilepsie, on ne dispose pour l’heure que de traitements dont les mécanismes d’action sont peu spécifiques des causes de la crise, et dont les effets durent assez longtemps. En identifiant les gènes et protéines clés exprimés dans les moments favorables au déclenchement de la crise, on peut imaginer le développement de nouveaux traitements les ciblant, qui seraient administrés au patient selon l’heure à laquelle il est le plus vulnérable. »
Cette perspective reste relativement lointaine, mais elle pourrait être précédée de progrès thérapeutiques plus rapides : « 62 médicaments antiépileptiques ou anticonvulsifs disponibles sont connus pour agir sur des cibles moléculaires qui dépendent d’un rythme circadien. On peut donc imaginer potentialiser leur efficacité, ou réduire leurs effets secondaires, en identifiant le moment de la journée le plus approprié à leur administration. »
Note :
*unité 1066 Inserm/Aix-Marseille Université, Institut de neurosciences des systèmes, équipe Physiologie et physiopathologie des réseaux neuraux (PhysioNet), Marseille.
Source : KJ Debski et coll. The circadian dynamics of the hippocampal transcriptome and proteome is altered in experimental temporal lobe epilepsy. Science Advances, édition en ligne du 9 octobre 2020. DOI : 10.1126/sciadv.aat5979
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LA PLASTICITÃ HUMAINE OU LE SECRET DE LA PERFORMANCE |
|
|
| |
|
| |
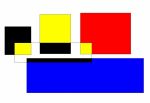
LA PLASTICITÉ HUMAINE OU LE SECRET DE LA PERFORMANCE
Réalisation : 20 juin 2002 - Mise en ligne : 20 juin 2002
* document 1 document 2 document 3
* niveau 1 niveau 2 niveau 3
*
Descriptif
Les thèmes suivants sont successivement abordés :
· Une description sommaire de la « machine animale »,
· Une brève analyse des termes : plasticité humaine et performance,
· Le concept de la préparation à la performance et de l'entraînement physique,
·Un exemple concernant les objectifs et les résultats de l'entraînement en endurance.
1) La machine animale est une machine : à « traiter l'information », « transformer l'énergie » et à « dupliquer le code génétique ». Traiter l'information consiste à capter les signaux provenant d'une part du monde extérieur : c'est le rôle des cinq sens et du système nerveux de la vie de relation ; d'autre part du monde intérieur : c'est le rôle du système neuro-endocrinien (système nerveux autonome et glandes endocrine) responsable de la régulation de la vie végétative et du maintien de l'homéostasie et, plus généralement du vaste système de communication intercellulaire qui fait qu'aucune cellule du corps n'est indifférente au fonctionnement de l'organisme dans son ensemble. Transformer l'énergie revient à transformer, stocker puis, en fonction des besoins, libérer l'énergie potentielle contenue dans les aliments afin que, notamment, puisse se développer les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire. Le rendement métabolique est assez faible car environ 80% de cette énergie potentielle est transformé en chaleur. L'ensemble des réactions chimiques qui, à partir des lipides (graisses) et des glucides (sucres), conduisent à produire de l'ATP (Adénosine Triphosphate) dont la dégradation fournit de l'énergie libre, peuvent se dérouler en présence d'oxygène (voies métaboliques aérobies) ou en son absence (voies métaboliques anaérobies). Plus la contraction musculaire est intense plus la consommation d'énergie est importante et plus le débit de renouvellement des molécules d'ATP doit être élevé. Dupliquer l'information génétique contenue dans les chromosomes permet d'orienter et d'accroître la synthèse des protéines de structure et/ou enzymatiques au niveau des organes ou des systèmes fonctionnels sur lesquels s'exercent les contraintes spécifiques de l'entraînement physique.
2) Plasticité et performance On peut définir la plasticité comme la capacité de l'individu à s'adapter à son environnement. Cette faculté d'adaptation possède des limites liées au patrimoine génétique c. à d. au génotype du sujet. La notion de performance dépend de l'activité considérée : du sport individuel (dont les performances sont très référencées) au sport d'équipe (dont le résultat collectif n'est pas le simple reflet des performances individuelles), l'importance accordée aux capacités : fonctionnelles énergétiques, de coordination motrice et mentales varie considérablement dans sa hiérarchie.
3) Dans le cadre de la préparation à la performance, l'entraînement physique a pour but, d'augmenter selon un plan bien déterminé, ces qualités : fonctionnelles (énergétiques), de coordination motrice (techniques), et mentale (lucidité, maîtrise de soi, sens de l'anticipation …). On distingue : - La préparation générale qui a pour objectif d'améliorer la force et l'endurance musculaire, la vitesse d'exécution du geste, la souplesse articulaire, l'efficacité du système cardio-vasculaire et la maîtrise de l'équilibre pondéral. - La préparation spécifique, d'autant plus prédominante que le sujet est expérimenté et la période de compétition proche, comprend la réalisation d'activités physiques analogues à celles pratiquées lors des compétitions. Une analyse détaillée et précise des différentes séquences qui composent ces activités physiques spécifiques ainsi que des qualités requises pour répondre le plus efficacement possible à leur réalisation font partie de l'élaboration d'un plan d'entraînement moderne. L'entraînement forme un tout composé de séances organisées d'exercices, entrecoupées de période de récupération d'une durée déterminée, pendant lesquelles se développent les processus d'adaptation. En fonction du phénotype considéré (par exemple amélioration de la capacité fonctionnelle énergétique aérobie) ces processus présentent des limites qui dépendent du génotype.
4) L'entraînement physique en endurance illustre cette démarche : Il est destiné aux sportifs réalisant des efforts de longue durée (marathon, cyclisme sur route, ski de fond …). Il peut s'agir d'un « entraînement par intervalles » (Interval training) fait d'une succession d'exercices de durée brève et d'intensité élevée ou d'un « entraînement par la distance » constituée d'effort d'intensité plus faible mais maintenus sur une longue durée. L'objectif est d'améliorer les capacités fonctionnelles énergétique aérobie des sujets. Celles-ci dépendent : de l'efficacité du transport de l'oxygène et de son utilisation par les muscles impliqués dans l'exercices considéré ; d'une réduction par ceux-ci, de la consommation du glycogène au profit de celle des lipides ; d'un perfectionnement des mécanismes de la thermorégulation corporelle ; d'une augmentation du rendement mécanique, c. à d. d'une diminution du coût énergétique du travail physique considéré. Ces modifications s'expriment : à la périphérie, par une modification des fibres musculaires concernées dont la vascularisation s'accroît ainsi que leur richesse en mitochondries qui contiennent d'importants enzymes oxydatifs alors que les protéines (notamment l'actine et la myosine) qui entrent dans la composition de leur appareil contractile changent de nature ; au niveau central, par une augmentation du volume cardiaque dont les parois et les cavités ventriculaires s'accroissent. Sur le plan de la coordination motrice des améliorations techniques apparaissent qui dans le cas, par exemple, de la course à pied, tendent à réduire son coût énergétique. La part de l'hérédité dans les capacités adaptatives de l'individu soumis à un entraînement physique est discutée en conclusion de l'exposé.
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Des organoïdes de tissus adipeux humains développés pour traiter lâobésité |
|
|
| |
|
| |

Des organoïdes de tissus adipeux humains développés pour traiter l’obésité
27 Sep 2023 | Par Inserm (Salle de presse) |
Physiopathologie, métabolisme, nutrition | Technologie pour la sante
In Vivo. L’utilisation d’agrégats cellulaires de tissu adipeux humain et d’un environnement matriciel adapté permet la génération d’organoïdes vascularisés de tissu adipeux beige. © Laboratoire Restore
Longtemps perçus comme inexistants chez l’humain, les tissus adipeux bruns et beiges jouent un rôle clé dans l’homéostasie énergétique de notre corps. Néanmoins, ils sont en faible quantité dans notre organisme et les observer in situ n’est pas aisé. Une équipe scientifique française1 de l’Inserm, de l’ESF, et de l’université Toulouse III – Paul Sabatier menée par le professeur Louis Casteilla (Institut Restore CNRS/EFS/Inserm/UT3), et l’équipe ELiA du Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS – CNRS) a développé un procédé unique afin de les générer en laboratoire sous forme d’organoïdes. Leur étude a été publiée dans Advanced Science le 21 septembre.
Si le gras n’a pas bonne presse, il reste néanmoins essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Depuis 2009 et la découverte de nouveaux types de tissus adipeux chez l’humain, bruns et beiges, les recherches biologiques dans ce domaine se sont accélérées. Le tissu adipeux blanc représente plus de 95% des masses graisseuses dans un corps. C’est lui qui participe à la régulation du métabolisme énergétique en stockant et en libérant l’énergie dont nous avons besoin pour vivre.
Le tissu adipeux brun a un rôle tout autre : il participe à la thermogénèse adaptive. Autrement dit, il permet de dissiper l’énergie stockée sous forme de chaleur et régule ainsi la température corporelle. Or, il a été constaté qu’il dysfonctionnait chez les patients atteints d’obésité mais aussi parfois durant le vieillissement. Il apparaît alors comme un objet d’études et une cible thérapeutique majeure.
Étant donné sa faible quantité dans l’organisme, stimuler la conversion des tissus adipeux blancs en tissus beiges, dont les propriétés sont très proches de celles des bruns, est la piste privilégiée des scientifiques. Jusqu’à maintenant, les modèle d’études in vitro étaient limités à des cultures cellulaires classiques en deux dimensions, dans des boîtes de Pétri, très loin de reproduire le contexte tri-dimensionnel et complexe du tissu in vivo. D’un autre côté, les modèles basés sur des animaux ne présentent pas la même physiologie de ces tissus que les humains.
La collaboration multidisciplinaire des équipes impliquées dans l’étude scientifique a permis le développement d’un procédé unique d’ingénierie tissulaire pour générer des organoïdes pré-vascularisés de tissu adipeux beige humain de dimensions variables. Les organoïdes sont de plus en plus utilisés dans la recherche médicale pour fabriquer des modèles capables de mimer la physiologie des tissus humains en reproduisant leur complexité structurelle et leur variété cellulaire. Ils peuvent servir aussi bien pour le développement des tests in vitro comme alternative à l’expérimentation animale que pour leur transplantation à des fins thérapeutiques.
Par la mise au point d’un microenvironnement biochimique et biomécanique approprié grâce à l’utilisation d’hydrogel et de facteurs de croissance inducteurs définis, les scientifiques ont mis au point un procédé d’ingénierie unique nécessaire à l’émergence d’organoïdes de tissus adipeux de taille millimétrique, comme de micro-tissus de taille centimétrique. Ce travail a fait l’objet d’un dépôt de deux brevets.
1 Collaboration de l’institut Restore (CNRS/EFS/Inserm/UT3), du Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS-CNRS) et de l’institut de biologie de Valrose (iBV, CNRS/Inserm/Université côte d’azur).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
