|
| |
|
|
 |
|
Ãviter le rejet de greffe rénale grâce à la biopsie liquide ? |
|
|
| |
|
| |

Éviter le rejet de greffe rénale grâce à la biopsie liquide ?
21 Juin 2024 | Par Inserm (Salle de presse) | Physiopathologie, métabolisme, nutrition
Les équipes du département de transplantation rénale de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, de l’Inserm et de l’université Paris Cité, dans le cadre du Paris Translational Research Center for Organ Transplantation (PARCC), coordonnées par le docteur Olivier Aubert et le professeur Alexandre Loupy, ont mené une étude sur l’intérêt de la biopsie liquide (cfDNA) en tant que technique pour prédire le rejet de greffe rénale. Celle-ci consiste à détecter, dans le sang des patients ayant subi une greffe, l’ADN de leur donneur, dans l’objectif de prédire de manière non invasive le rejet de l’organe greffé.
Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’une publication parue le 2 juin 2024 dans la revue Nature Medicine, accompagnée d’un éditorial.
Les allogreffes sont les greffes les plus couramment pratiquées, entre deux individus d’une même espèce génétiquement différents. On parle d’allogreffe lorsque le patient (ou receveur) est greffé avec les cellules provenant d’un sujet sain. Le rejet d’allogreffe constitue un enjeu de santé publique majeur, qui peut avoir de nombreuses conséquences sur la qualité de vie du patient, jusqu’à même provoquer sa mort. Les rejets d’allogreffe concernent près de 20 % des patients dans l’année qui suit.
L’objectif de cette étude est de montrer l’utilité, pour les patients greffés du rein, d’une biopsie liquide. Cette technique consiste à détecter, dans le sang des patients ayant subi une greffe, l’ADN de leur donneur, dans l’objectif de prédire et de manière non invasive le rejet de l’organe greffé.
Cette étude a inclus près de 3 000 patients greffés rénaux provenant de 14 centres de transplantation en Europe et aux États-Unis, tous âgés d’environ 55 ans, avec une majorité d’hommes (61 %). Le cfDNA est intégré dans un algorithme multimodal de prédiction1. Les niveaux de cfDNA2 se sont révélés fortement liés aux différents types de rejet de greffe, incluant le rejet médié par les anticorps et le rejet cellulaire médié par les lymphocytes T.
Grâce à cette méthode, les chercheurs pourront être en capacité de déterminer, pour chaque patient et de manière non invasive sur une simple prise de sang, la probabilité d’avoir un rejet de l’organe greffé. De plus, les analyses ont révélé que l’ajout du cfDNA aux modèles de surveillance existants améliore non seulement la détection des rejets cliniques, mais aussi des rejets infracliniques (non détectables avec les outils disponibles actuellement), ce qui permet des interventions thérapeutiques plus précoces et plus efficaces.
La biopsie liquide, combinant les paramètres de suivi usuels de la greffe avec le cfDNA, permet d’éviter les biopsies inutiles et invasives tout en détectant les rejets plus rapidement avec une meilleure précision.
Cette approche peut également diminuer les coûts de santé tout en simplifiant considérablement le parcours de soin des patients transplantés. Cette méthode non invasive offre une nouvelle voie pour le suivi des patients greffés.
Aujourd’hui, l’approche de biopsie liquide s’étend également aux greffés cardiaques, pulmonaires et hépatiques.
1. Un type d’intelligence artificielle dans lequel plusieurs sources de données et de nombreux algorithmes de traitement intelligents sont combinés pour résoudre des problèmes complexes et obtenir une plus grande précision.
2. Les niveaux de cfDNA indiquent l’intensité de l’inflammation et du rejet de l’organe greffé.
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Stress post-traumatique : la plasticité cérébrale, un mécanisme clé de la résilience au trauma |
|
|
| |
|
| |

Stress post-traumatique : la plasticité cérébrale, un mécanisme clé de la résilience au trauma
08 Jan 2025 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie

Le projet Remember apporte de nouvelles pistes pour comprendre le trouble de stress post-traumatique © Inserm
À la suite d’une expérience choquante, dangereuse ou effrayante, comme par exemple un attentat, de nombreuses personnes développent un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Afin d’améliorer sa prise en charge, de nombreux travaux scientifiques se penchent sur les processus neurobiologiques qui sous-tendent le développement de ce trouble. L’étude Remember, dirigée par Pierre Gagnepain et dont l’Inserm est promoteur, a été mise en place dans les mois qui ont suivi les attentats du 13 Novembre. Elle s’intéresse plus particulièrement aux facteurs de protection et aux marqueurs cérébraux qui sont associés à la résilience au traumatisme. Dans un nouvel article scientifique publié dans Science Advances, l’équipe de recherche au sein du laboratoire Inserm Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine (Inserm/Université de Caen Normandie/École pratique des hautes études/CHU Caen/GIP Cyceron) met en évidence la plasticité des mécanismes cérébraux permettant de faire face au trauma. Ceux-ci se transforment avec le temps, et leur reconfiguration aboutit à une diminution des symptômes de stress post-traumatique.
Les attentats de Paris et Saint-Denis, le 13 novembre 2015, ont laissé des marques durables, non seulement sur les survivants et les proches des victimes, mais aussi sur la société française dans son ensemble.
L’étude Remember, menée dans le cadre du programme transdisciplinaire 13-Novembre[1], est une étude qui compare les résultats d’imagerie cérébrale menée chez 120 participants exposés aux attentats et 80 non-exposés qui ont été suivis depuis 2015.
L’équipe de recherche explore les effets d’un événement traumatique sur les structures et le fonctionnement du cerveau, identifiant des marqueurs neurobiologiques du stress post-traumatique mais également de la résilience au trauma. À terme, l’objectif est que ces travaux puissent déboucher sur de nouvelles pistes thérapeutiques, complémentaires à celles existant déjà, pour les personnes qui souffrent de TSPT.
« Pourquoi certaines personnes ayant vécu un traumatisme souffrent-elles de stress post-traumatique, alors que d’autres ne développent jamais ce trouble ? Qu’est-ce qui, au niveau cérébral, explique que certaines personnes se remettent après avoir souffert de TSPT et que d’autres en sont atteintes de manière chronique ? Voilà le type de questions auxquelles nous tentons de répondre avec nos travaux », explique Pierre Gagnepain chercheur Inserm et responsable scientifique de Remember.
Mécanismes de contrôle de la mémoire
Parmi les symptômes les plus caractéristiques du TSPT, l’intrusion fréquente du souvenir des images, des odeurs et des sensations associées au traumatisme vécu. Ces mémoires intrusives, qui arrivent souvent sans crier gare et bouleversent la vie quotidienne, sont source de grande détresse.
Dans de précédents travaux, l’équipe a montré que les personnes souffrant de TSPT présentent un dysfonctionnement au niveau des réseaux cérébraux de contrôle qui régulent normalement l’activité des régions de la mémoire, et notamment l’activité de l’hippocampe.
Chez les individus atteints de ce trouble, ces « mécanismes de contrôle » de la mémoire ne parviennent pas à inhiber l’activité de l’hippocampe, ce qui permet aux souvenirs intrusifs de resurgir. À l’inverse, le fonctionnement de ces mécanismes est très largement préservé chez les individus sans TSPT, qui parviennent à lutter efficacement contre les souvenirs intrusifs.
Dans la continuité de ces résultats, Pierre Gagnepain et ses collègues ont voulu comprendre dans leur nouvelle étude[2] si les mécanismes de contrôle de la mémoire pouvaient se refaçonner et s’améliorer avec le temps, contribuant à la guérison du trouble.
Au total 100 personnes, qui avaient été exposées aux attaques terroristes du 13 novembre 2015, ont participé à ce travail. Parmi elles, 34 souffraient de TSPT chronique, alors que 19 s’étaient remises d’un trouble initial. L’étude comptait également 72 participants non exposés aux attentats, servant de groupe contrôle.
Toutes ces personnes ont été invitées à participer à deux reprises à des études d’imagerie cérébrale (en 2016/2017 puis en 2018/2019) afin d’étudier les évolutions structurelles et fonctionnelles de leur cerveau au cours du temps. Elles ont également répondu à un questionnaire sur leurs éventuels symptômes de TSPT en 2020/2021.
À partir de ces données, l’équipe de recherche a pu mettre en évidence la plasticité des réseaux cérébraux impliqués dans le contrôle de la mémoire, qui régulent la résurgence des souvenirs intrusifs.
Les chercheurs montrent en effet que, chez les personnes remises du TSPT, ces « mécanismes de contrôle » de la mémoire se refaçonnent au cours du temps et finissent par se « normaliser », pour ressembler à ceux des personnes « contrôles ». Concrètement, cela se traduit en imagerie cérébrale par une action plus efficace des régions préfrontales pour inhiber l’activité hippocampique et empêcher l’accès aux souvenirs intrusifs.
Chez les participants qui souffrent de TSPT chronique, ces phénomènes sont toujours altérés. Néanmoins, l’apparition d’un début de plasticité des mécanismes de contrôle de la mémoire, observée lors de la seconde étape d’imagerie chez certains d’entre eux, prédit une future réduction des symptômes intrusifs rapportés dans la troisième partie de l’étude, dans le questionnaire.
Enfin, au niveau structurel, cette normalisation des mécanismes de contrôle de la mémoire est aussi associée à une interruption de l’atrophie de l’hippocampe, contribuant ainsi à limiter les effets négatifs du stress sur le cerveau.
« Notre étude permet de montrer que rien n’est inscrit dans le marbre. La résilience humaine aux traumatismes est caractérisée par la plasticité des circuits de contrôle de la mémoire, notamment ceux qui régulent l’activité de l’hippocampe et la résurgence des souvenirs intrusifs. Elle souligne également que l’altération des mécanismes de contrôle, que nous avions identifiés lors de notre précédente étude comme centraux pour comprendre la variation dans la réponse au trauma, sont bien plus probablement la cause que la conséquence du TSPT », souligne Giovanni Leone, premier auteur de l’étude.
D’un point de vue clinique, cette étude pourrait avoir des implications intéressantes.
« On pourrait imaginer de nouvelles thérapies, complémentaires à celles qui sont déjà utilisées, pour venir stimuler les mécanismes de contrôle de la mémoire, et encourager la plasticité. L’avantage de cette approche serait d’agir sur les réseaux cérébraux sans agir sur le système émotionnel et sans faire revivre les émotions traumatiques au patient », précise Pierre Gagnepain.
L’équipe poursuit les travaux sur le sujet : la prochaine étape consistera à étudier le rôle d’un récepteur cérébral particulier (appelé « GABA alpha 5 »), principalement localisé au sein de l’hippocampe. Les scientifiques pensent en effet que ce récepteur pourrait être impliqué dans l’oubli et la mise sous silence des souvenirs. Ils souhaitent creuser cette piste, qui leur permettrait à la fois de mieux comprendre les mécanismes du TPST mais aussi d’envisager ce récepteur comme une nouvelle cible thérapeutique potentielle.
[1]Vaste programme de recherche transdisciplinaire, le programme 13-Novembre bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-10-EQPX-0021. Le programme est codirigé par le neuropsychologue Francis Eustache, directeur d’étude à l’EPHE, et l’historien Denis Peschanski, directeur de recherche au CNRS. L’objectif : étudier la construction et l’évolution de la mémoire, individuelle et collective, de ces événements traumatiques, mais également mieux comprendre les facteurs protégeant les individus du stress post-traumatique.
[2] Cette étude a bénéficié d’un financement de la Région Normandie dans le cadre du Réseau d’Intérêt normand (RIN) Label d’excellence.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Lâinfection de certains neurones par le SARS-CoV-2 pourrait être à lâorigine de symptômes persistants |
|
|
| |
|
| |
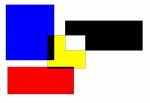
L’infection de certains neurones par le SARS-CoV-2 pourrait être à l’origine de symptômes persistants
15 Sep 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Image illustrant l’infection par le SRAS-CoV2 (immunoréactivité pour la protéine S en blanc) dans les neurones olfactifs exprimant la protéine marqueur olfactive (OMP, en rouge) dans l’épithélium nasal humain. ©Vincent Prévot/Inserm
Les conséquences sur le cerveau d’une infection par le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19 sont de plus en plus documentées par la littérature scientifique. Des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, du CHU de Lille et de l’Université de Lille, au sein du laboratoire Lille neuroscience et cognition, en collaboration avec leurs collègues de l’Imperial College London, se sont intéressés plus spécifiquement aux conséquences de cette infection sur une population précise de neurones connue pour réguler la reproduction sexuelle via l’hypothalamus (les neurones exprimant l’hormone GnRH). Leurs résultats, suggèrent que l’infection peut entraîner la mort de ces neurones et être à l’origine de certains symptômes qui persistent dans le temps. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue eBioMedicine.
De nombreuses études scientifiques ont documenté les conséquences sur le cerveau d’une infection au SARS-CoV-2. Parmi les effets qui ont été identifiés, une proportion significative d’hommes présente des taux de testostérone faibles qui persistent dans le temps. Au-delà de quatre semaines, on peut parler alors de « Covid long ».
Une équipe de recherche de l’Inserm, du CHU et de l’Université de Lille, étudie depuis de nombreuses années le rôle de certains neurones exprimant une hormone appelée GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone). Ces neurones contrôlent depuis l’hypothalamus tous les processus associés aux fonctions reproductrices : la puberté, l’acquisition des caractères sexuels secondaires et la fertilité à l’âge adulte.
Ces mêmes scientifiques avaient par exemple précédemment identifié qu’un dysfonctionnement des neurones à GnRH dans un modèle animal de la trisomie 21, pouvait avoir des conséquences sur l’altération des fonctions cognitives associées à cette maladie.
Dans une nouvelle étude, ils ont voulu tester l’hypothèse selon laquelle une infection par le SARS-CoV-2 peut avoir des conséquences délétères sur cette population de neurones régulateurs de la reproduction.
Le virus pénètre les neurones à GnRH et altère leurs fonctions
En s’appuyant sur les dosages hormonaux (testostérone et LH) réalisés trois mois et un an après l’infection chez un petit groupe de 47 hommes[1], les scientifiques ont constaté que le contact avec le virus pouvait altérer les fonctions des neurones à GnRH, entraînant une chute du taux de testostérone chez certains patients quelques temps après l’épisode infectieux.
Les scientifiques ont ensuite voulu vérifier si l’infection des neurones à GnRH et les anomalies hormonales observées après l’infection pouvaient être associées à des déficits cognitifs. Ils ont pour cela répertorié les symptômes cognitifs rapportés par les patients de la cohorte, qui ont subi des tests approfondis à 3 mois, puis 1 an après l’infection.
Résultats : la proportion de patients signalant des troubles de la mémoire ou de l’attention, quelle que soit leur fréquence ou leur gravité, mais aussi des difficultés de concentration, avait tendance à être légèrement plus élevée chez les patients qui présentaient des dosages hormonaux anormaux, caractérisés par une baisse du taux de testostérone.
« Bien qu’il s’agisse de mesures effectuées sur un petit échantillon de patients et uniquement masculins, ces résultats sont très intéressants et mériteraient d’être approfondis dans le cadre d’autres études menées à plus grande échelle », explique Waljit Dhillo, professeur à l’Imperial College London, co-dernier auteur de cette étude.
Pour compléter leurs analyses, les chercheurs ont enfin étudié le cortex de patients décédés des suites de la Covid-19. Ils ont identifié la présence du virus au niveau de l’hypothalamus et ont constaté la mort d’une partie de la population de neurones à GnRH.
« Ces résultats peuvent être inquiétants sur plusieurs points au regard du rôle de ces neurones dans la reproduction et de leur implication dans certaines fonctions cognitives. Ils pointent la nécessité d’optimiser et de généraliser le suivi médical des personnes atteintes de symptômes persistants suite à une infection par la Covid-19 », conclut Vincent Prévot, directeur de recherche à l’Inserm, co-dernier auteur de cette étude.
L’étude incite aussi à poursuivre les travaux sur les conséquences neurologiques du Covid long.
Ce projet de recherche a bénéficié d’un financement de l’ANRS-MIE.
[1]Ces données ont été collectées dans le cadre d’une étude plus large évaluant les fonctions surrénaliennes et thyroïdiennes après une infection par le Sars-CoV-2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34008009/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Troubles de lâaudition â Surdités |
|
|
| |
|
| |

Troubles de l’audition – Surdités
Comment préserver et restaurer notre ouïe
PUBLIÉ LE : 07/11/2023
TEMPS DE LECTURE : 16 MIN
La surdité affecte 6 % des 15–24 ans, et plus de 65 % des 65 ans et plus. Des troubles de l’audition peuvent exister dès la naissance, mais le nombre de personnes concernées progresse inexorablement avec l’âge. Face à cette déficience sensorielle, la recherche est particulièrement active : au cours de la dernière décennie, des avancées spectaculaires ont été réalisées dans la compréhension des mécanismes et des facteurs génétiques qui en sont responsables. Les récents progrès technologiques devraient permettre d’améliorer les performances des aides auditives et des implants existants. Grâce à la thérapie génique, les scientifiques espèrent même parvenir à régénérer des cellules de l’oreille interne dont la destruction est à l’origine de nombreuses surdités.
Dossier réalisé en collaboration avec Jean-Luc Puel (unité 1298 Inserm/Université de Montpellier, Institut des neurosciences de Montpellier)
TABLE DES MATIÈRES
Comprendre les troubles de l’audition
En France, chaque année, une surdité bilatérale est détectée chez près de 800 nourrissons, soit environ un nouveau-né sur 1 000. Dans 45 % des cas, le trouble est sévère et profond, avec de lourdes conséquences sur l’acquisition du langage oral et sur le développement socio-affectif. Mais les surdités moyennes ont également un impact négatif sur les apprentissages scolaires, le développement cognitif et l’adaptation sociale.
Passé l’enfance, le nombre de personnes concernées par une déficience auditive ne cesse de progresser avec l’âge : la surdité touche environ 6 % des 15–24 ans, 9 % des 25–34 ans, 18 % des 35–44 ans et plus de 65 % des plus de 65 ans. Ainsi, environ un quart des 18–75 ans présente une déficience auditive, avec des conséquences variables sur la vie sociale. Chez les personnes de plus de 65 ans, une perte d’audition est associée à un déclin cognitif (altération de la mémoire, des capacités d’attention ou encore de l’utilisation de certains éléments de langage), sans pour autant favoriser la survenue d’une démence de type maladie d’Alzheimer. Ce déclin est sans doute lié à un isolement social progressif.
Les surdités acquises sont assez fréquemment accompagnées d’acouphènes, une perception auditive (battements, grésillements, sifflements) en l’absence de tout stimulus externe, qui peut être très invalidante. En savoir plus sur les acouphènes
L’audition : des sons convertis en signaux électriques
L’audition résulte du couple oreille-cerveau : les ondes sonores captées par l’oreille sont transformées en signaux transmis au cerveau pour nous permettre de localiser la source sonore, déterminer la nature du son (bruit, langage, danger…), puis l’interpréter et la mémoriser.
Pour assurer ses fonctions, l’oreille est divisée en trois parties : l’oreille externe se compose du pavillon (la partie visible) et du conduit auditif qui mène jusqu’au tympan. Son rôle est de capter, amplifier et focaliser les sons vers l’oreille moyenne. Lorsque les ondes sonores frappent le tympan, celui-ci se met à vibrer. Ces vibrations parviennent jusqu’à l’oreille moyenne constituée de petits os articulés. Ces osselets les transmettent jusqu’à une membrane appelée « fenêtre ovale », située à l’entrée de l’oreille interne.
Cette dernière renferme la cochlée, une structure en forme de spirale, composée de 15 000 cellules ciliées, des cellules sensorielles capables de transformer les vibrations transmises par les osselets en signaux électriques qui sont transmis au cerveau par le nerf auditif. La destruction des cellules ciliées et du nerf auditif, brutale ou progressive, provoque un déficit auditif irrémédiable.
Fréquence et intensité du son
Un son correspond donc à une onde sonore captée par l’oreille et qui fait vibrer le tympan. Sa fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde qu’il génère et s’exprime en Hertz. Si elle est faible, le son est grave. Et à l’inverse, plus elle est élevée, plus le son est aigu. Les fréquences captées par les humains varient de 20 à 20 000 Hz. L’intensité d’un son, exprimée en décibels, dépend quant à elle de l’amplitude des vibrations. Plus elle est importante, plus le son est fort. L’oreille humaine capte des intensités comprises entre 0 et 120 dB. À partir 85 dB les structures de l’oreille interne peuvent être irréversiblement détruites.
Surdité : des causes génétiques, environnementales et liées au vieillissement
Chez le nouveau-né
La majorité des surdités néonatales sont d’origine génétique. Près de 130 gènes impliqués ont déjà été identifiés : leur mutation provoque des anomalies du système auditif qui entraînent le déficit. Une mutation du gène GjB2 est par exemple retrouvée chez près de la moitié des nourrissons concernés (surdités de type DFNB1). Et une altération de la séquence du gène STRC expliquerait au moins 10 % de cas supplémentaires (surdités de type DFNB16). Ces deux gènes permettent la synthèse de protéines de la cochlée.
Les surdités néonatales peuvent aussi être liées à une infection pré, péri ou post-natale, ou à l’administration de molécules otoxiques (toxiques pour les structures de l’oreille interne) à la mère au cours de la grossesse, par exemple celle de certains antibiotiques ou de chimiothérapies.
Au cours de la vie
Les surdités acquises au cours de la vie sont liées à des traumatismes acoustiques, mais aussi à des maladies (otites chroniques dans environ 20 % des cas, tumeurs…), des accidents (plongée) ou encore des toxicités médicamenteuses (liées à des antibiotiques comme les aminoglycosides, des chimiothérapies notamment le cisplatine…). L’exposition régulière et prolongée à des niveaux sonores élevés dans la vie quotidienne est également responsable. Musique au casque plusieurs heures par jour, cinéma, concerts, bruits de la circulation… contribuent à la destruction progressive des cellules ciliées qui jouent un rôle central dans les mécanismes de l’audition.
Le vieillissement peut également être responsable de ce phénomène et conduire à une perte auditive qui apparaît le plus souvent à partir de 50–60 ans. On parle alors de presbyacousie.
Surdité légère ou profonde ?
Plusieurs degrés de pertes auditives sont observés :
* légères (perte auditive de 20 à 40 dB par rapport à l’intensité réelle du son),
* moyennes (perte auditive de 40 à 70 dB),
* sévères (perte auditive de 70 à 90 dB),
* profondes (perte auditive de 90 à 120 dB).
Prévention majeure : réduire l’exposition aux bruits excessifs
L’exposition au bruit est une cause première de troubles de l’audition. Des niveaux sonores élevés détruisent de façon irréversible les cellules ciliées et altèrent les fibres nerveuses auditives.
C’est le cas de nombreux bruits associés à des activités de loisirs (concerts, boîtes de nuit, musique au casque...). Un décret de 2017 fixe à 102 dB pendant 15 min le volume sonore maximal pouvant être diffusé dans un lieu public.
La législation du travail a également fixé des seuils d’exposition dans le cadre professionnel :
* Au-delà de 80 dB, une exposition de plus de huit heures nécessite la mise en place de mesures de protection, avec en particulier le port de protections individuelles de type casque anti-bruit, des périodes de repos ou encore des limitations de durée d’exposition.
* Les valeurs limites d’exposition sont de 87 dB pour une exposition quotidienne au bruit ou 140 dB pour un bruit bref.
À titre d’illustration une perceuse émet environ 85 dB, un marteau piqueur environ 100 dB et un avion au décollage environ 140 dB.
Il existe cependant une grande variabilité individuelle face au bruit. Certains gènes semblent influer sur la sensibilité au traumatisme sonore.
Le dépistage, à tous les âges
Depuis 2014, la surdité permanente bilatérale néonatale est dépistée chez près de 95 % des nourrissons dans les jours qui suivent leur naissance dans le cadre d’un programme national de dépistage déployé dans les maternités. L’examen indolore et rapide consiste à recueillir des données sur le fonctionnement de l’oreille moyenne et de l’oreille interne à l’aide d’oreillettes et d’électrodes placées sur la surface du crâne des bébés. L’objectif est de repérer très précocement les enfants déficients auditifs pour limiter les conséquences délétères de ce déficit. Par la suite, la médecine scolaire ou l’entourage peuvent déceler un déficit. Chez les enfants, les répercussions d’une surdité seront différentes selon qu’elle apparaît avant ou après l’acquisition du langage.
Chez l’adulte, le dépistage est proposé dès l’âge de 45–50 ans dans le cadre de la médecine du travail, et plus précocement et régulièrement dans les situations à risque (travail en milieu bruyant, militaires...).
Lorsque le dépistage décèle un risque de déficience, des tests spécialisés permettent de définir le type de surdité dont un patient est atteint, ainsi que son importance :
* Les otoémissions acoustiques sont des vibrations générées par les cellules ciliées externes de la cochlée suite à une stimulation sonore. Leur enregistrement permet de vérifier que ces cellules et l’oreille moyenne fonctionnent correctement. Il s’agit d’un bon outil de dépistage néonatal,
* Les potentiels évoqués auditifs automatisés s’enregistrent grâce à des électrodes placées sur le cuir chevelu, en stimulant les oreilles avec une intensité sonore. Ce test permet de vérifier le fonctionnement de la cochlée et du nerf auditif.
* L’audiométrie tonale est le test le plus courant. Il consiste à rechercher des réflexes ou des réactions en réponse à des émissions de sons, pour des fréquences allant le plus souvent de 125 Hz (graves) à 8 000 Hz (aiguës).
* L’audiométrie vocale permet d’évaluer la compréhension. Le sujet doit répéter correctement des mots simples et courants qui leur sont énoncés à différentes intensités.
Les tests classiques ne permettent pas toujours de repérer une atteinte partielle des fibres des nerfs auditifs, la présence de fibres résiduelles étant suffisante pour analyser les sons. Ainsi, face à des tests normaux mais à une plainte persistante d’un patient, correspondant notamment à une mauvaise compréhension dans un environnement bruyant, il est nécessaire d’effectuer une audiométrie vocale en environnement bruyant.
Des traitements de plus en plus sophistiqués
Les traitements classiques
Les traitements chirurgicaux permettent de rétablir l’audition lorsque la surdité est liée à un défaut de fonctionnement de la chaîne tympano-ossiculaire, comme une perforation du tympan, une destruction ou un blocage des osselets. Il est aujourd’hui courant de réaliser une greffe de tympan ou remplacer un osselet.
Lorsque l’oreille interne est endommagée, à la suite d’une surdité brusque ou d’un traumatisme acoustique aigu par exemple, une hospitalisation avec administration de corticoïdes par voie générale est préconisée pour réduire l’inflammation et protéger les cellules ciliées. Dans l’idéal, ces médicaments doivent être administrés à fortes doses et dans les quelques heures qui suivent la survenue de la surdité. Leur utilisation est parfois associée à des traitements destinés à restaurer la vascularisation ou l’oxygénation de l’organe : substances vasodilatatrices et/ou oxygénothérapie hyperbare qui permet de délivrer une grande quantité d’oxygène et/ou « hémodilution normovolémique » qui consiste à prélever du sang pour en modifier la viscosité. Toutefois l’efficacité de ces traitements complémentaires n’est pas validée en raison de l’absence de données comparatives issues de groupes témoins non traités.
Les aides auditives
En cas de déficits auditifs légers à modérés, des aides auditives conventionnelles, dites « en conduction aérienne », sont proposées aux patients. Leur fonctionnement repose sur la captation du son par un ou plusieurs microphones. Le signal capté est traité par un microprocesseur, amplifié puis réémis via un écouteur placé dans le conduit auditif externe. Depuis 2021, certains modèles sont accessibles sans reste à charge financier pour les patients.
Des aides en conduction osseuse peuvent également être utilisées. Elles permettent de stimuler directement l’oreille interne à travers les os du crâne : les vibrations sonores sont captées par un microphone et transmises à l’os temporal par un vibrateur placé derrière l’oreille. Les vibrations de la paroi osseuse autour de la cochlée sont alors transférées aux cellules ciliées.
Les implants
Pour les surdités très sévères, voire totales, des implants sont recommandés. Il en existe deux types : l’implant d’oreille moyenne et l’implant cochléaire.
L’implant d’oreille moyenne fonctionne à l’image des aides en conduction osseuse. Il est fixé sur un osselet ou à proximité de l’oreille interne, capte les vibrations et les transmet à l’oreille interne.
L’implant cochléaire permet de restituer une audition quand les cellules sensorielles auditives ont totalement disparu. Son fonctionnement passe par l’excitation électrique de la cochlée pour stimuler sélectivement les terminaisons nerveuses qui correspondent à diverses fréquences de son. Une chirurgie est nécessaire pour implanter des électrodes dans la cochlée. Concrètement, un processeur externe fixé à la surface du crâne capte les sons et les numérise. Les signaux sont alors transmis au travers la peau à la partie interne de l’implant. Cette dernière transforme le signal numérique en stimulations électriques et le distribue sur les électrodes implantées dans la cochlée en fonction de leur fréquence.
Cette technique donne de très bons résultats, mais une période d’apprentissage supervisé par une orthophoniste spécialisée est nécessaire pour que le patient en retire un bénéfice maximal. Globalement, comprendre dans le silence est relativement aisé pour la grande majorité des patients implantés, mais une conversation dans le bruit ou l’écoute de la musique reste encore difficile. Chez les enfants atteints de surdité profonde, l’implantation cochléaire précoce (entre 12 et 24 mois) a montré d’excellents résultats sur l’acquisition du langage. En outre, une étude française a montré que les implants cochléaires avaient un effet bénéfique sur le déclin cognitif.
Une nouvelle tendance consiste à associer aides auditives conventionnelles et implants chez certains patients qui souffrent de surdités sévères mais chez lesquels il existe un reliquat auditif : les implants vont alors stimuler leur cochlée pour les aider mieux percevoir les sons, particulièrement les fréquences aiguës, alors que les aides auditives augmentent leur perception des sons graves.
Les enjeux de la recherche
Vers une meilleure connaissance des mécanismes auditifs
Certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres au bruit, ou connaissent une perte des cellules ciliées ou des fibres nerveuses auditives liée à l’âge plus rapide : les chercheurs tentent de comprendre cette variabilité interindividuelle. Parmi leurs hypothèses : l’implication de fibres nerveuses dans la sensibilité au bruit. Il existe en effet deux types de fibres nerveuses connectées aux cellules ciliées dans la cochlée : 95 % des fibres transmettent l’information sonore au cerveau, alors que les 5 % restantes sont des fibres différentes (non myélinisées) dont la fonction a été découverte récemment. Elles s’avèrent spécialisées dans la transmission d’un signal d’alerte en cas de bruit trop intense qui malmène les cellules ciliées. Concrètement, au-delà d’un certain seuil d’inconfort, ces fibres sont activées et envoient au cerveau un message de douleur (ou de sensation désagréable). Ce système prévient qu’il est nécessaire de trouver un environnement plus calme et pourrait jouer un rôle dans la vulnérabilité individuelle au bruit. Des travaux sur ce sujet sont en cours, pour confirmer cette hypothèse.
Des avancées en génétique
Les scientifiques continuent à rechercher des mutations génétiques responsables de surdités. Ces mutations affectent des gènes qui permettent la synthèse de protéines impliquées dans le développement ou le fonctionnement de la cochlée. Leur identification permet de réaliser des diagnostics moléculaires et du conseil génétique pour les familles concernées. Dans certains cas, elle contribue également au choix de la méthode de réhabilitation de l’audition.
Des thérapies géniques à l’étude
Grâce à ces avancées, des équipes développent en outre des thérapies géniques pour traiter des surdités d’origine monogénique, avec certains résultats positifs chez l’animal.
Une collaboration internationale qui inclut des chercheurs Inserm a testé avec succès une thérapie génique dans un modèle murin de surdité profonde d’origine génétique DFNB9. Les sujets atteints de cette surdité sont dépourvus du gène de l’otoferline, une protéine essentielle à la transmission de l’information sonore au niveau des synapses des cellules ciliées. Grâce à l’injection intracochléaire de ce gène, les chercheurs sont parvenus à rétablir la fonction de la synapse auditive et les seuils auditifs des souris traitées à un niveau quasi-normal.
Un autre essai de thérapie génique, impliquant également des chercheurs Inserm, a permis de restaurer l’audition de souris qui modélisent le syndrome de Usher de type 1G (USH1G). Grâce à l’injection locale du gène USH1G codant pour la clarine, les chercheurs ont réussi à rétablir le fonctionnement du signal de transduction mécano-électrique des cellules sensorielles de l’oreille interne.
Une équipe américaine a quant à elle empêché l’apparition d’une surdité d’origine génétique (DFNA36) grâce à l’édition génomique, toujours dans un modèle murin. Grâce à l’outil Crispr/Cas9 et à un vecteur adénoviral, les chercheurs ont remplacé in vivo quelques nucléotides du gène Tmc1 qui permet la synthèse d’une protéine impliquée dans le fonctionnement des cellules ciliées, et dont la mutation est responsable de l’apparition de cette surdité. Les animaux ont conservé leur ouïe au moins un an après la naissance.
Régénérer des cellules ciliées
Des chercheurs travaillent en outre sur la régénération des cellules ciliées à partir d’autres types cellulaires présents dans la cochlée, appelées cellules de soutien. En y insérant le gène Atoh1 grâce à un vecteur viral, ils les forcent à acquérir les propriétés de cellules ciliées dans le but de remplacer les cellules mortes. Les données disponibles indiquent qu’il suffirait d’obtenir quelques dizaines de cellules sensorielles pour améliorer considérablement les performances des implants cochléaires.
Améliorer les aides auditives et les implants
Des progrès technologiques devraient permettre d’améliorer les performances des aides auditives et des implants. À ce jour, les personnes équipées d’implants cochléaires rencontrent de grandes difficultés en cas de sources sonores multiples ou en présence de sons complexes tels que de la musique. Avec une vingtaine d’électrodes implantées, l’excitation électrique des fibres auditives est peu précise : la résolution et le nombre de fréquences de sons traitées sont limités. Les chercheurs expérimentent l’augmentation du nombre d’électrodes, du nombre d’impulsions électriques par seconde, ou encore la prise en compte des variations rapides de fréquences.
D’autres types d’implants sont très prometteurs pour faciliter la compréhension dans des environnements sonores complexes (musique, soirée…) : il s’agit d’implants optogénétiques, développés à l’Institut de neurosciences auditives, à Göttingen en Allemagne. Leur principe est de stimuler très précisément les fibres auditives avec des signaux lumineux. Cette technique permettrait de multiplier le nombre d’électrodes par 10 (pour atteindre 200). Pour cela plusieurs défis techniques sont relevés : modifier génétiquement les cellules de la cochlée pour y introduire le gène de l’opsine destiné à les rendre sensibles à la lumière, puis faire en sorte que l’implant convertisse les vibrations sonores en signaux lumineux acheminés dans une fibre optique insérée dans la cochlée. De premiers résultats ont été obtenus chez des rats sourds qui ont récupéré leur audition. Des essais chez l’Homme sont prévus à priori à horizon 2025.
Enfin, l’intelligence artificielle devrait s’inviter dans la conception des aides auditives. Des appareils permettent déjà certains traitements du signal afin de réduire le bruit de fond. Les algorithmes d’intelligence artificielle permettront, dans l’avenir, de distinguer la parole du bruit. Et, à terme, des dispositifs plus performants pourraient analyser l’activité cérébrale pour identifier les sources sonores d’intérêt et effectuer un réglage en temps réel.
Vers des traitements médicamenteux
La meilleure connaissance des mécanismes de mort des cellules ciliées et des cellules du nerf auditif permet de proposer de nouvelles pistes thérapeutiques. Ainsi, l’équipe Inserm de l’Institut des neurosciences de Montpellier a montré que la perte des cellules ciliées résulte en grande partie d’un programme actif de mort cellulaire appelé apoptose qui fait intervenir différents acteurs moléculaires selon la nature du stress qui le déclenche (traumatisme acoustique, médicament ototoxique...). En outre, il est maintenant démontré que les fibres du nerf auditif sont très sensibles à une libération excessive de glutamate déclenchée par un traumatisme sonore ou lors du vieillissement de la cochlée. Ce phénomène appelé excitotoxicité est responsable de la perte des synapses auditives et de la dégénérescence des fibres du nerf auditif. Aussi, différentes substances sont testées pour protéger ces tissus :
Injecté à travers le tympan, un anti-apoptotique (le D‑JNKI‑1) prévient la mort des cellules sensorielles et les pertes auditives induites par la néomycine (un antibiotique) ou un traumatisme sonore. Un essai clinique impliquant 35 centres européens a été mené chez 210 patients qui présentaient une surdité brusque. Les résultats montrent une amélioration significative de la compréhension et une diminution des acouphènes avec cette molécule, par rapport à ce qui observé après l’injection d’un placebo. Et une autre étude menée auprès de 256 patients atteints de surdité soudaine idiopathique (apparue au cours des 72 dernières heures, généralement en raison d’une infection ou d’un trouble circulatoire de la cochlée), montre également une efficacité.
Autre piste, l’administration de molécules qui modulent le métabolisme des mitochondries, de petits organites qui produisent de l’énergie dans les cellules. Elles protègent en effet l’audition de souris exposées à la néomycine ou au bruit, et atténuent les pertes auditives liées à l’âge. Chez l’Homme, une de ces molécules (la coenzyme Q10 – Ter) administrée sous forme de compléments alimentaires pendant 30 jours favorise la récupération auditive après une exposition au bruit.
Des chercheurs imaginent aussi cibler le stress oxydant, un mécanisme qui endommage les cellules via la production de radicaux libres en excès. Ces derniers peuvent être neutralisés par des agents antioxydants et certains d’entre eux sont testés pour prévenir ou guérir des pertes auditives : la N‑acétylcystéine, l’acide alpha-lipoïque, l’aspirine, les vitamines E, C et D, et le bêta-carotène.
Enfin, l’utilisation de molécules qui miment l’effet des neurotrophines est testée pour protéger les neurones du système auditif et favoriser la repousse de leurs prolongements (neurites). Les neurotrophines sont des facteurs favorables à la survie, la croissance et la différenciation neuronales. Découvrir des substances thérapeutiques qui produisent les mêmes effets et les tester chez les patients est l’un des objectifs du projet Audiocampus porté par l’Institut des neurosciences de Montpellier, une plate-forme participative d’excellence en audiologie clinique sur le site du CHU incluant start-ups, patients, cliniciens, enseignants-chercheurs, étudiants et industriels.
Un centre de recherche dédié
En France, l’Institut de l’audition est un centre de recherche dédié à l’audition. Il est composé de membres de l’Institut Pasteur, de l’Inserm et du CNRS qui collaborent avec les services ORL des CHU de l’AP-HP à Paris et de plusieurs villes en région (Lyon, Clermont-Ferrand, Bordeaux…), ainsi qu’avec des audioprothésistes. Les axes de recherche sont fondamentaux et translationnels : élucider le fonctionnement du système auditif et l’influence du génome et de l’environnement, mais aussi améliorer la prise en charge des patients en caractérisant les différentes surdités, en développant des outils de diagnostic et des approches thérapeutiques innovantes chez l’enfant et chez l’adulte, et en élaborant des méthodes de rééducation auditive fondées sur des connaissances scientifiques fondamentales.
Nos contenus sur le même sujet
Actualités
* 29/08/22 Surdité : identification d’un nouveau facteur de risque génétique
* 21/12/17 Le cortex moteur aide à mieux entendre
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
