|
| |
|
|
 |
|
Restaurer la conscience grâce à une stimulation profonde du cerveau : une piste pour la recherche sur le coma |
|
|
| |
|
| |
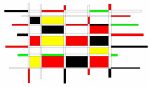
Restaurer la conscience grâce à une stimulation profonde du cerveau : une piste pour la recherche sur le coma
PRESS RELEASE | 21 MAR 2022 - 8H47 | BY INSERM PRESS OFFICE
NEUROSCIENCES, COGNITIVES SCIENCES, NEUROLOGY AND PSYCHIATRY
Une équipe de de recherche associant des chercheurs en neurosciences et des cliniciens du CEA, de l’Hôpital Foch, de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de l’Inserm et du Collège de France apporte la preuve que la stimulation cérébrale profonde (deep brain stimulation, DBS) peut rétablir la conscience lorsque celle-ci est altérée. Ce résultat, fruit de plus de 5 ans de travail mené chez l’animal, ouvrirait la voie à des essais cliniques chez les patients qui ne recouvrent pas la conscience et a fait l’objet d’une publication dans la revue Science Advances.
La conscience est un processus dynamique et complexe qui coordonne l’activité de différentes régions du cerveau, particulièrement le tronc cérébral, le thalamus et le cortex.
Il existe deux niveaux hiérarchiques de conscience. Le premier est celui de l’éveil, ou vigilance, caractérisé par l’ouverture sur le monde. Il correspond à l’activation de structures très profondes du cerveau nichées dans le tronc cérébral. Le deuxième est « l’accès conscient », caractérisé par la perception consciente de telle ou telle information. À chaque fois que nous prenons conscience d’une information, par exemple une note de musique, ce contenu de conscience est codé par l’activation simultanée de groupes de neurones distribués dans différentes aires du cortex (l’« écorce » plissée, composée de six couches de neurones, qui tapisse les deux hémisphères). Un lien a été établi entre la perte de conscience et une forte perturbation des communications entre les différentes aires du cortex cérébral, et entre le cortex et le thalamus, une région du cerveau à mi-chemin entre le tronc cérébral et le cortex.
Les études d’imagerie cérébrale suggèrent que le rétablissement de ces communications entre cortex et thalamus pourrait être la clé de la récupération des troubles chroniques de la conscience. Plusieurs équipes à travers le monde ont eu l’idée de les rétablir par des stimulations électriques.
Si de premiers résultats avaient déjà montré qu’une telle stimulation pouvait permettre de rétablir le premier niveau de conscience (l’état d’éveil), aucune n’avait pu démontrer si une telle stimulation pouvait aussi rétablir le deuxième niveau de conscience, « l’accès conscient ».
Et si le centre du thalamus était la bonne cible à stimuler pour rétablir les deux niveaux hiérarchiques d’une conscience altérée ? C’est l’hypothèse testée par l’équipe de recherche française à l’origine de ce travail publié dans Science Advances et associant le CEA, l’Hôpital Foch, l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Inserm et le Collège de France.
La stimulation électrique du thalamus permet de restaurer une conscience perdue
Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont appliqué une anesthésie générale à un primate non-humain, et ce afin de supprimer les deux composantes de la conscience, à savoir l’éveil et l’accès conscient. Une électrode de stimulation cérébrale profonde, un dispositif équivalent à celui utilisé chez des patients atteints de la maladie de Parkinson avait préalablement été implanté chez ces animaux. Résultat : pendant l’anesthésie générale, la stimulation électrique de la partie centrale du thalamus a permis de réveiller les primates anesthésiés.
La stimulation électrique a induit immédiatement l’observation clinique de l’ouverture des yeux, la reprise d’une respiration spontanée, et des mouvements des membres. L’arrêt de la stimulation par la coupure du courant électrique a fait immédiatement replonger le primate dans un état de sédation profonde, celui de l’anesthésie générale. Cette expérience a ainsi pu démontrer dans un premier temps que la stimulation cérébrale profonde peut restaurer le premier niveau de la conscience.
Grâce à la technologie de l’imagerie cérébrale par IRM fonctionnelle et également d’un examen par électroencéphalographie, les chercheurs sont parvenus pour la première fois à mesurer finement, durant la stimulation du thalamus, les deux niveaux de la conscience (éveil et accès conscient). Ils ont observé de près les activations cérébrales de l’animal, pendant l’anesthésie et pendant les périodes de « réveil » induit par la stimulation. De plus, un casque permettait de faire écouter au primate une série de sons différents réalisant une composition complexe. Alors qu’il avait perdu sa capacité à intégrer la complexité de la composition sonore sous l’effet de l’anesthésie profonde, le cerveau a retrouvé cette capacité dès la mise en route de la stimulation cérébrale. Une analyse algorithmique appliquée au signal IRM fonctionnelle de repos (en dehors des périodes d’application des compositions sonores) a pu démontrer que la stimulation cérébrale ramenait au cerveau une richesse d’activité perdue sous anesthésie générale. Ainsi, la stimulation cérébrale du thalamus a pu restaurer les deux dimensions fondamentales et hiérarchiques de la conscience. Ce travail scientifique apporte une pièce maîtresse pour envisager de futurs essais cliniques chez les patients souffrant de troubles chroniques de la conscience.
Après un traumatisme crânien grave ou un accident vasculaire cérébral sévère, il arrive que des patients ne recouvrent jamais un état de conscience normal. Du coma initial soigné en réanimation, le patient passe à un état chronique de conscience altérée pour lequel il n’existe aucun traitement validé. L’espoir pourrait venir des neurosciences qui, depuis une vingtaine d’années, ont considérablement fait progresser la compréhension du phénomène neurobiologique de la conscience.
Ce travail a bénéficié du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, de la Fondation pour la Recherche Médicale, de la Fondation de France, du Human Brain Project et du Collège de France.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Cardiologie : comment le cÅur s'est adapté aux milieux pauvres en oxygène |
|
|
| |
|
| |

Cardiologie : comment le cœur s'est adapté aux milieux pauvres en oxygène
Par Sciences et Avenir avec AFP le 05.08.2015 à 11h38, mis à jour le 05.08.2015 à 11h38
La mise en évidence d'un gène ayant permis l'adaptation du cœur aux hautes altitudes dans des populations éthiopiennes pourrait constituer une nouvelle piste contre l'insuffisance cardiaque.
Le muscle cardiaque de certaines populations a su s'adapter à des milieux très pauvres en oxygène.
CARDIOLOGIE. Des chercheurs ont identifié un mécanisme biologique permettant au cœur, et à l'organisme d'une manière générale, de mieux s'adapter à la raréfaction de l'oxygène dans l'atmosphère, selon une étude publiée lundi 3 août 2015. "C'est la première fois qu'on découvre un gène responsable de l'adaptation à la haute altitude essentiel pour protéger les fonctions cardiaques même au niveau de la mer", a souligné Gabriel Haddad, professeur de pédiatrie à l'hôpital des enfants Rady à San Diego. Une découverte qui pourrait permettre la mise au point de médicaments contre l'insuffisance cardiaque, selon les chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Californie, dont l'étude paraît dans les Comptes-Rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS).
Une hypothèse enfin validée
Les scientifiques ont étudié le génome de populations des hauts plateaux éthiopiens (1.000 à 3.000 mètres d'altitude). Comme celles des Andes et de l'Himalaya, elles ont subi au cours des millénaires d'importants changements physiologiques et génétiques affectant leurs systèmes respiratoires et sanguins, contrairement à la population vivant à basse altitude. En février 2014, dans une étude parue dans Genome Biology, le séquençage du génome des Ethiopiens avait révélé des variations du gène EDNRB apparemment liées aux fonctions cardiaques et susceptibles d'expliquer leur capacité d'adaptation. C'est cette hypothèse que les chercheurs californiens ont désormais démontré. Ces derniers ont en effet travaillé sur des souris génétiquement modifiées afin de reproduire cette variante de l'EDNRB, qui entraîne une réduction de la production de la protéine endothéline. Résultat ? Ces rongeurs ont beaucoup mieux résisté à une hypoxie modérée ou forte, présentant de meilleures performances cardiaques et une plus grande oxygénation des organes vitaux que les souris normales.
Résistance à des conditions d'hypoxie extrême
Conclusion des auteurs : l'abaissement du niveau d'endothéline, un puissant vasoconstricteur, résultant de cette variante génétique aide à préserver les fonctions cardiaques dans une hypoxie modérée à sévère. Et ceci à haute altitude, comme au niveau de la mer. Ainsi, même dans des conditions d'hypoxie extrême avec seulement 5% d'oxygène - moins qu'au sommet du Mont Everest - les souris dotées du gène mutant et produisant donc moins d'endothéline, avaient des fonctions cardiaques et respiratoires nettement meilleures que les autres rongeurs. Elles ont pu maintenir une tension artérielle et un rythme cardiaque dans la normale, et ont été davantage capables de maintenir le flux d'oxygène dans leurs organes vitaux. Mais à ce niveau de raréfaction d'oxygène, la capacité respiratoire des souris normales a baissé de 40 à 50%, et elles n'ont pu maintenir leur tension artérielle. Aucune n'a survécu.
"Abaisser le niveau d'endothéline fait des miracles chez des souris placées dans un environnement faible en oxygène ce qui suggère que le gène EDNRB joue un rôle clé dans l'adaptation des humains à la haute altitude", a relevé M. Haddad. Selon lui, ce mécanisme biologique paraît contribuer à la dilatation des vaisseaux sanguins et à la prolifération des cellules sanguines.
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Maladies neurodégénératives : Dansez ! Bougez ! |
|
|
| |
|
| |

Maladies neurodégénératives : Dansez ! Bougez !
PUBLIÉ LE : 06/01/2020
ACTUALITÉ SCIENCE
Deux pas en avant, trois pas sur le côté… C’est au rythme de la danse et des arts martiaux que les patients atteints de troubles cognitifs tels que les maladies d’Alzheimer et de Parkinson pourraient trouver un certain soulagement alors que les traitements tardent à voir le jour.
Un article à retrouver dans le n°45 du magazine de l’Inserm
Si les maladies neurodégénératives touchent au moins un tiers de la population européenne, très peu de solutions médicamenteuses sont proposées. À ce jour, aucun traitement n’existe pour stopper l’évolution des deux plus fréquentes, la maladie d’Alzheimer et celle de Parkinson. En attendant, les chercheurs se tournent vers des solutions originales pour améliorer la prise en charge des patients, préserver leurs fonctions le plus longtemps possible et leur apporter une petite source de plaisir.
Danser pour mieux penser
Avec près de 900 000 personnes souffrant de démences de type Alzheimer en France, cette maladie est aujourd’hui au centre des préoccupations. La dégénérescence lente des neurones provoque dans un premier temps une perte importante de la mémoire. La recherche s’est longtemps focalisée sur cet angle et ce n’est que récemment que l’impact de la maladie sur les fonctions motrices est étudié. France Mourey, de l’unité Cognition, action et plasticité sensorimotrice* à Dijon, identifie très tôt dans la pathologie des troubles du mouvement et de la posture, en particulier au niveau des ajustements de l’équilibre.
Vient donc l’idée de proposer une activité physique adaptée capable de favoriser implicitement le mouvement et de pallier ces troubles moteurs. Et c’est sur une danse, le tango, que le choix s’est porté. « Le tango a été une révélation pour moi. C’est une danse qui, dans la mémoire de chacun, évoque à la fois le rythme, la vie, la passion, l’émotion qui ne peuvent qu’activer le mouvement », explique la chercheuse. Le tango permet de travailler la rotation de la tête, la dissociation des épaules et du bassin, les déplacements latéraux, et les changements en rythme. « On y retrouve tous les éléments essentiels à l’activation de l’équilibre dynamique et certains composants abordés en rééducation. » Sous l’influence du tango et de la musique, les déplacements compliqués dans la maladie se fluidifient, les pas se transforment, s’allongent, et le rythme de la marche évolue. Même à des stades très avancés de la maladie, les améliorations de la mobilité sont parfois immédiates. Reste à savoir si les progrès se pérennisent dans le temps. Grâce à de petits accéléromètres sous forme de bracelets de cheville qui captent les accélérations des mouvements des patients, les scientifiques ont donc cherché à mesurer les effets de la danse après une période d’entraînement de 6 semaines. Les analyses sont encore en cours. « Notre objectif est de comprendre en amont ce qui se passe dans ces mouvements pour proposer des programmes de prévention plus efficaces. » Si les chercheurs arrivent à démontrer que les patients se synchronisent beaucoup mieux et conservent des capacités d’apprentissage, le tango pourrait être utilisé comme source thérapeutique et comme outil de prévention à des stades précoces aussi bien qu’avancés de la maladie. « De mon point de vue, il est moins important de considérer les lésions causées par la maladie que les symptômes fonctionnels. Il vaut mieux connaître où sont les réserves fonctionnelles des patients plutôt que ce qu’ils ont perdu », avoue France Mourey.
Mouvement, danse, tango et réhabilitation – Reportage et interview de France Mourey – 4 min – extrait de la série Les allegros d’Alzheimer, une coproduction ABB Reportages / Inserm (2013)
Tomber pour mieux se relever
Si plusieurs travaux montrent que l’activité cérébrale et physique a une influence positive sur le déroulement de la maladie d’Alzheimer, peu d’informations et d’études s’intéressent aux mêmes effets dans celle de Parkinson. Les symptômes de la maladie impactent visiblement la motricité et on pense donc naturellement que la kinésithérapie est utile voire indispensable. Beaucoup d’ateliers proposent des solutions rythmiques pour pallier les problèmes moteurs des malades, mais rares sont ceux correctement évalués. Peu d’études scientifiques montrant un bénéfice réel appuient ces propos. « C’est dommage. On imagine que c’est le cas, mais on ne sait pas si c’est purement symptomatique, si les bénéfices disparaissent à l’arrêt de l’activité, ou s’il y a une plasticité qui s’installe et qui retarde la maladie », explique Olivier Blin**, directeur de Dhune, un programme de l’hôpital de la Timone à Marseille, labellisé centre d’excellence pour les maladies neurodégénératives et le vieillissement (Coen). Ce professeur de pharmacologie et neuropsychiatre est capoeiriste. Il décide alors d’évaluer le contrôle du mouvement et du déplacement des patients parkinsoniens après 6 mois de participation à un atelier de capoeira.
Cet élégant art martial afro-brésilien demande en effet de l’improvisation sur la musique et le rythme, et implique un travail important sur l’équilibre, les chutes et la façon de se relever. « La capoeira apprend des techniques pour se sortir de toutes situations. Tomber sur les fesses, les genoux, le dos, sur le côté et amortir, réagir tout de suite, profiter du mouvement et de la vitesse pour se rétablir et arriver à se remettre debout », décrit le chercheur. Ce sport rythmé fait travailler la motricité, la vitesse, et l’amplitude des mouvements mais pas seulement. D’autres symptômes de la maladie peuvent évoluer comme les troubles de l’humeur ou de l’anxiété. Et les barrières sociales finissent également par tomber. « La capoeira est à l’origine une activité structurante et assez formelle proposée aux enfants des favelas du Brésil afin de leur donner un cadre de valeurs humaines très fort. Elle aide ainsi à déconstruire la maladie de Parkinson sous tous ces angles et à se reconstruire dans un cadre social différent. » La recherche implique donc autant les sciences humaines et sociales que le contrôle du mouvement. Après les 6 mois, les chercheurs ont évalué, grâce à une tablette graphique, la progression de la motricité fine et la précision du geste en fonction de la vitesse, un facteur important, déterminant et positif dans le maintien de l’équilibre et de la motricité. Les patients montrent des améliorations sur tous les points. Cependant, Olivier Blin insiste sur le fait que l’étude n’en est qu’à ses débuts. « Ce sont des prétests encourageants mais on manque encore de connaissances pour aider les patients. Nous espérons mesurer d’autres facteurs physiologiques mais à ce jour le financement de la recherche sur des activités entièrement dédiées aux patients reste très difficile. Nous manquons cruellement de fonds alors que l’évaluation de l’utilité de ces activités sur le plan médical semble incontournable pour faire bénéficier les patients pleinement et potentiellement de cette expérience. »
En attendant, comme le dit si bien la fourmi de la fable de La Fontaine : « Eh bien, dansez maintenant ! »
Notes :
* unité 1093 Inserm/Université de Bourgogne – CHU de Dijon
** CIC Marseille, Inserm/Aix-Marseille Université
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Une toxine à lâorigine de dommages à lâADN retrouvée chez des patients souffrant dâinfections urinaires |
|
|
| |
|
| |
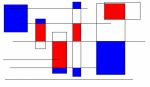
Une toxine à l’origine de dommages à l’ADN retrouvée chez des patients souffrant d’infections urinaires
COMMUNIQUÉ | 25 FÉVR. 2021 - 20H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
Les infections urinaires touchent plus de 50 % des femmes, dans certains cas de manière récurrente. La bactérie E. coli est très souvent impliquée dans le développement de ces infections. Pour la première fois, des scientifiques de l’Inserm, du CHU de Toulouse, d’INRAE, de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier et de l’École nationale vétérinaire de Toulouse ont identifié la présence d’une toxine produite par ces bactéries dans les urines de patientes, qui aurait pour effet d’endommager l’ADN des cellules de la vessie. Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles réflexions pour affiner la prise en charge des patientes sujettes à infections urinaires récurrentes. L’étude est publiée dans le journal Plos Pathogens le 25 février 2021.
Tous les ans, 150 millions de personnes sont touchées par les infections urinaires. Celles-ci sont plus fréquentes chez les femmes : plus d’une sur deux en connaîtra une au cours de sa vie. Ces infections constituent donc un problème de santé publique majeur, d’autant que la prise d’un traitement antibiotique est souvent nécessaire, favorisant l’émergence d’antibiorésistances.
Les infections urinaires surviennent lorsque la région urogénitale est contaminée par des bactéries issues du microbiote intestinal. Les bactéries Escherichia coli (E. coli) sont ainsi impliquées dans 80 % de ces infections[1] et font l’objet de travaux de recherche menés depuis plusieurs années par Eric Oswald et son équipe à l’Institut de recherche en santé digestive (Inserm/INRAE/Université de Toulouse III Paul Sabatier/École nationale vétérinaire de Toulouse) dans le cadre d’une collaboration avec plusieurs équipes de recherche de Toulouse.[2]
Les scientifiques s’intéressent notamment aux facteurs de virulence de ces bactéries, c’est-à-dire à leur capacité à infecter ou endommager les tissus de l’hôte. Ils avaient déjà montré que dans certaines conditions, les E. coli présentes dans le tractus intestinal peuvent produire une toxine, la colibactine, qui est associée à un risque accru de cancer colorectal. Dans cette nouvelle étude, l’équipe a analysé les prélèvements urinaires de 223 adultes avec une infection urinaire liée à la présence d’E. coli et prise en charge aux urgences du CHU de Toulouse.
Ils ont ainsi identifié un biomarqueur témoignant de la présence de colibactine produite par les bactéries E. coli dans au moins 25 % des urines collectées. C’est la première fois que cette toxine est identifiée dans le contexte d’une infection urinaire et que des chercheurs apportent une preuve directe de sa production lors d’une infection chez l’Homme.
ADN endommagé chez la souris
Pour essayer de mieux comprendre et de caractériser les effets de la colibactine dans le contexte des infections urinaires, les chercheurs se sont tournés vers des modèles animaux. Ils montrent que chez la souris, la toxine est produite lors d’une infection urinaire par E. coli et qu’elle induit des dommages à l’ADN dans les cellules de la muqueuse de la vessie.
« Ces expérimentations nous permettent de sortir d’un cadre très théorique et de montrer que lors d’une infection urinaire, la colibactine peut avoir un effet génotoxique : les dommages causés à l’ADN ne se réparent pas complètement et des mutations génétiques peuvent survenir. Si on ne peut pour le moment que spéculer sur l’impact de ces mutations, il est probable qu’elles soient associées à un risque accru de cancer de la vessie », précise Eric Oswald.
Si ces résultats portant sur des modèles animaux ne peuvent en l’état être appliqués aux humains, le chercheur et son équipe estiment qu’ils pourraient néanmoins inciter à une surveillance plus importante et plus ciblée des personnes sujettes à infections urinaires récurrentes.
Par ailleurs, mieux comprendre les liens entre microbiote intestinal et infections urinaires à répétition est considéré comme une priorité. « On pourrait imaginer mettre en place une prise en charge plus spécifique des patientes souffrant régulièrement d’infections urinaires, avec une recherche systématique des marqueurs de la colibactine dans leurs urines. Et de manière plus proactive, proposer des approches thérapeutiques visant à moduler la composition de leur microbiote intestinal, qui représente le réservoir principal des bactéries E. coli mises en cause dans ces infections urinaires », souligne Eric Oswald.
L’équipe travaille notamment sur plusieurs projets de recherche autour des probiotiques et du réservoir intestinal pour limiter les populations nocives d’E. coli dans le microbiote et favoriser l’émergence de « bonnes bactéries ». Ils ont ainsi breveté avec Inserm-Transfert une souche d’E. coli non pathogène, capable de mener une « guerre biologique » aux souches uropathogènes.
[1] On parle alors d’Escherichia coli uropathogènes (UPEC).
[2] En particulier la coordination d’un projet ANR avec comme partenaires la société VibioSphen et une équipe de l’institut travaillant sur le métabolisme du fer.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
