|
| |
|
|
 |
|
Hyperglycémie : vers une meilleure compréhension de son impact délétère sur la peau |
|
|
| |
|
| |
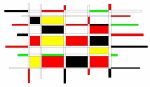
Hyperglycémie : vers une meilleure compréhension de son impact délétère sur la peau
30 Avr 2025 | Par Inserm (Salle de presse) | Génétique, génomique et bio-informatique | Physiopathologie, métabolisme, nutrition
Une dégradation de la qualité de la peau, de sa capacité à cicatriser, et de son vieillissement normal, est souvent observée chez les personnes présentant une hyperglycémie chronique. Une équipe de chercheuses et chercheurs de l’Inserm, de l’université de Bordeaux et de LVMH Recherche, s’est intéressée à la façon dont l’hyperglycémie altère le derme humain et en particulier les cellules impliquées dans sa cicatrisation, les fibroblastes. Ses travaux, parus dans Redox Biology, montrent qu’une trop forte concentration en glucose dans le derme vient perturber une mécanique complexe et finement régulée de production de l’énergie par les fibroblastes, avec des impacts sur leur capacité à maintenir l’intégrité de la peau.
Le glucose est un sucre vital pour les cellules des mammifères : il permet notamment la synthèse de nombreuses molécules essentielles à l’organisme, comme l’ADN, ainsi que la transformation d’énergie par les mitochondries, les « centrales énergétiques » du corps humain, via le mécanisme dit de « respiration mitochondriale ». Bien que les concentrations en glucose dans le derme (l’une des trois couches constituant la peau, située entre l’épiderme – la couche externe – et l’hypoderme) reflètent celles retrouvées dans le sang, le métabolisme du glucose dans la peau reste peu étudié et mal connu.
Au sein du derme, on retrouve les fibroblastes, des cellules, impliquées notamment dans la régénération de l’épiderme et dans la cicatrisation de la peau, grâce à leur capacité à produire du collagène et à se déplacer sur le site d’une blessure. Ces fibroblastes cutanés subissent directement le stress métabolique causé par l’hyperglycémie[1], une conséquence des régimes alimentaires riches en sucres.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Décrypter le langage des neurones pour mieux soigner grâce au cerveau virtuel |
|
|
| |
|
| |

Décrypter le langage des neurones pour mieux soigner grâce au cerveau virtuel
23 Avr 2025 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie | Technologie pour la sante
?©Adobestock
Comment prédire la réaction du cerveau lors d’une lésion localisée ou d’une intervention thérapeutique ciblée ? Une équipe de chercheuses et chercheurs de l’Inserm, du CNRS et d’Aix-Marseille Université est parvenue à créer un modèle innovant, permettant de visualiser chez la souris l’impact d’interventions ou de lésions ciblées sur le fonctionnement global du cerveau. Ce modèle intègre des données d’IRM pour créer un modèle informatique de cerveau virtuel. Les résultats, parus dans PNAS, montrent comment l’activité globale du cerveau est réorganisée, même après des interventions à une échelle très localisée. Ils montrent en outre, que le modèle de cerveau virtuel développé permet aussi de prédire, à l’échelle de l’individu, des effets spécifiques et parfois inattendus d’interventions ciblées. Ces travaux amènent un éclairage nouveau sur les mécanismes qui sous-tendent certains troubles neurologiques et la façon de les traiter.
Le cerveau humain est constitué de réseaux de neurones qui communiquent entre eux et dont les modifications peuvent expliquer l’apparition des troubles neurologiques. Par exemple, lorsque survient une lésion cérébrale endommageant l’activité neuronale d’une zone spécifique du cerveau (comme dans le cas d’un AVC), un déficit fonctionnel peut être observé sur des régions cérébrales éloignées de la zone lésée. De la même façon, pour traiter certaines pathologies neurologiques comme la maladie de Parkinson, on fait appel à des techniques permettant une stimulation en profondeur d’une zone ciblée du cerveau, afin d’obtenir un effet à distance sur l’activité des neurones d’une autre zone cérébrale.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Quand les neurones s’inspirent des virus pour communiquer |
|
|
| |
|
| |
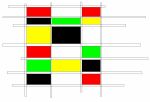
Quand les neurones s’inspirent des virus pour communiquer
13.03.2018, par Alexandra Gros (post-doctorante à l’université d’Edimbourg) et Antoine Besnard (post-doctorant au Massachusetts General Hospital de Boston)
Viendrait-on de découvrir un nouveau mode de communication entre neurones ? En janvier, des chercheurs ont montré qu’un gène impliqué dans l’apprentissage et la mémorisation était capable de former des capsides virales pour transmettre une information. Deux de ces scientifiques nous parlent de leur découverte dans le blog « Aux frontières du cerveau ».
? ?En janvier dernier, deux articles publiés dans la revue Cell créaient une onde de choc dans le monde des neurosciences en montrant qu’un gène particulièrement important dans les processus d’apprentissage et de mémorisation est capable de former des capsides* virales pour transmettre une information aux cellules voisines ! Serait-ce une nouvelle forme de communication entre neurones ? Les chercheurs Jason Shepherd (J. S.), neuroscientifique et spécialiste du gène Arc de l’université de l’Utah, et Cédric Feschotte (C. F.), généticien et spécialiste des transposons* de l’université de Cornell, nous racontent leur découverte.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT CNRS LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Mémoire Une affaire de plasticité synaptique |
|
|
| |
|
| |
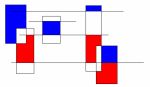
Mémoire
Une affaire de plasticité synaptique
MODIFIÉ LE : 13/05/2025 PUBLIÉ LE : 23/06/2017 TEMPS DE LECTURE : 22 MIN
La mémoire permet d’enregistrer des informations issues d’expériences et d’événements divers, de les conserver et de les restituer. Cette faculté dépend de différents réseaux de neurones impliqués dans de multiples formes de mémorisation. Grâce aux progrès réalisés dans la compréhension de ces processus, celle de certains troubles mnésiques s’améliore aussi, ouvrant la voie à des interventions auprès des patients et de leur famille.
Dossier réalisé en collaboration avec Francis Eustache, membre de l’unité Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine (unité 1077 Inserm/EPHE/Université de Caen-Normandie).
Comprendre le fonctionnement de la mémoire
La mémoire est la fonction qui nous permet d’encoder, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble nos savoir-faire, nos connaissances, nos souvenirs. Indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur, elle fournit la base de notre identité.
Cinq systèmes interconnectés
La mémoire se compose de cinq systèmes interconnectés, qui impliquent des réseaux neuronaux en partie distincts :
La mémoire de travail (à court terme) est à l’intersection de toutes les autres réseaux neuronaux,
La mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont deux systèmes de représentation consciente à long terme.
La mémoire procédurale permet des automatismes inconscients.
La mémoire perceptive est liée aux différentes modalités sensorielles.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
